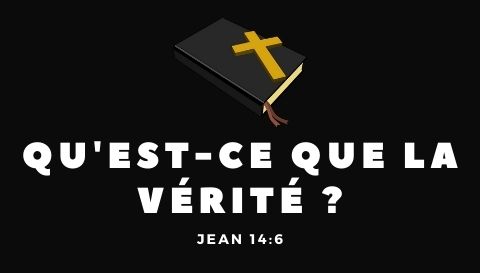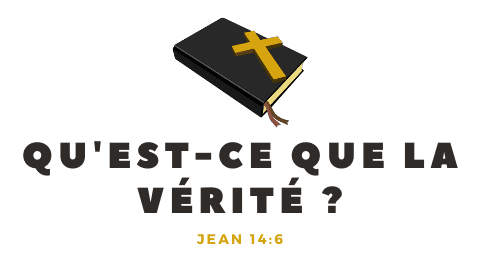De la collégialité des Evêques à la Papauté Impériale
Nous continuons ici avec notre troisième article sur la papauté et son développement au fil des siècles. Pour cela il faut parler de Léon 1er.
Voici le premier article pour ceux qui ne l’ont pas encore lu:
Léon Ier
Léon 1er a été Pape de 440 à 461 après J.-C. Il est considéré par l’Église catholique comme un Docteur de l’Église. Il a été le premier pape à affirmer clairement et systématiquement que l’évêque de Rome possédait une autorité universelle sur toute l’Église chrétienne, en vertu du mandat donné à Pierre.
Léon a affirmé que :

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
- Pierre était le « chef » des apôtres,
- Pierre était établi par Jésus-Christ comme fondement de l’Église (interprétation de Matthieu 16:18),
- Les pouvoirs donnés à Pierre étaient transmis à ses successeurs, c’est-à-dire les évêques de Rome.
Avant Léon il existait une reconnaissance générale d’un certain prestige de l’Église de Rome. Mais ce prestige était fondé sur des raisons pratiques (Rome = capitale impériale) et spirituelles (Rome = lieu du martyre de Pierre et Paul), pas sur une doctrine théologique forte.
Avec Léon pour la première fois il y a une véritable théologie structurée de la primauté romaine. Il enseignait que:
- Pierre avait reçu des pouvoirs uniques de Jésus-Christ (Matthieu 16:18-19 : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église »).
- Pierre était resté vivant dans l’Église de Rome à travers ses successeurs.
- Chaque pape était l' »héritier spirituel » de Pierre, transmettant son autorité apostolique (mais Pierre n’avait pas d’autorité personnelle à transmettre, uniquement l’enseignement du Christ).
Dans une de ses lettres il écrit :
« Ce que le Christ a conféré à Pierre seul passe par lui à ses successeurs. »
C’est donc Léon qui a posé clairement l’idée que le pape romain héritait directement de l’autorité de Pierre, autorité sur toute l’Église universelle. C’est sous ce Pape qu’est formulée l’idée que l’autorité donnée à Pierre continue de manière directe et ininterrompue par la lignée des papes. Cette conception monarchique, comme l’héritage d’un roi à son fils futur roi, se substituait à l’autorité biblique et à la collégialité des évêques. Cela n’existait pas clairement avant lui. C’est une construction doctrinale nouvelle au Ve siècle. Léon Ier a transformé le rôle de l’évêque de Rome :
- De primus inter pares (premier parmi les égaux),
- Vers primus super omnes (premier au-dessus de tous).
À l’époque de Léon, plusieurs grandes Églises avaient une énorme importance dans la chrétienté :
- Antioche (où les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois — Actes 11:26),
- Alexandrie (grand centre théologique et intellectuel en Égypte),
- Constantinople (nouvelle capitale impériale, fondée en 330).
Ces Églises avaient des patriarches influents et parfois rivaux. Le danger pour Rome était que Constantinople revendique un rang égal à Rome, étant la « Nouvelle Rome ». La réaction de Léon a été de:
- s’appuyer sur l’argument théologique : seule Rome détenait l’héritage de Pierre.
- refusé que Constantinople soit son égal simplement pour des raisons politiques.
- d’affirmer que l’autorité spirituelle venait du Christ par Pierre, pas de l’empereur ni d’une ville impériale.
Il est le grand architecte initial de la vision papale qui culminera beaucoup plus tard avec la domination totale de l’Église par la papauté médiévale.
Le concile de Chalcédoine (451) est un exemple intéressant à consulter. Il a confirmé la doctrine christologique du « Tome de Léon » (Jésus pleinement Dieu et pleinement homme). Rome sortait renforcée doctrinalement. Mais lors du Concile, les évêques orientaux ont aussi adopté le Canon 28, qui accordait à Constantinople la deuxième place d’honneur après Rome, parce qu’elle était la Nouvelle Rome. Léon a refusé ce canon. Il protestait dans ses lettres. Pour lui, Rome devait garder la primauté non pour des raisons politiques, mais parce qu’elle était l’Église de Pierre. Ici encore, Léon opposait une argumentation théologique à une argumentation politique. Malgré ses efforts, le schisme entre Rome et Constantinople s’est lentement creusé, aboutissant au Grand Schisme de 1054.
Le Grand Schisme de 1054
Il s’agit basiquement de la séparation officielle entre :
- L’Église d’Occident (Rome → future Église catholique romaine),
- et l‘Église d’Orient (Constantinople → Église orthodoxe).
Ce schisme est l’aboutissement de plusieurs siècles de tensions doctrinales, culturelles, politiques, notamment autour de la question de la primauté papale.
Les papes romains insistaient progressivement sur une primauté universelle de juridiction (pouvoir de commander toute l’Église). Constantinople et les patriarcats d’Orient considéraient que le pape devait être primus inter pares (« premier parmi les égaux »), mais pas un souverain absolu. Les Églises d’Orient reconnaissaient l’importance d’honneur de Rome, mais refusaient toute soumission obligatoire. C’est exactement ce que Léon Ier avait initié, et que les Orientaux n’ont jamais vraiment accepté !
En 1054, plus de 1000 ans après le Christ, le pape Léon IX a envoyé le cardinal Humbert à Constantinople pour imposer la reconnaissance de la primauté du pape sur toute l’Église et d’autres points de doctrine. Le patriarche Michel Cérulaire de Constantinople a refusé. Le résultat est qu’Humbert a excommunié Michel Cérulaire au nom du pape. Michel Cérulaire a en retour excommunié Humbert et son entourage. La rupture était consommée.
Les Églises d’Orient ont toujours refusé l’idée que le pape de Rome puisse être le chef suprême de toute l’Église. Dans l’esprit biblique et de l’Église primitive, les évêques étaient égaux, et Rome n’était qu’un parmi d’autres patriarcats. Dans l’Apocalypse, chacune des 7 Églises reçoit un message direct de Jésus-Christ. Chaque message est adapté à l’état spirituel spécifique de l’Église :
- Louanges,
- Reproches,
- Appels à la repentance,
- Promesses au vainqueur.
Il n’est jamais question d’une soumission des Églises les unes aux autres.
- Aucune Église n’est présentée comme supérieure.
- Aucune figure humaine centrale (pas de pape, pas d’évêque universel) n’est mentionnée.
- Christ lui-même est le seul Chef qui adresse les messages directement.
Chaque Église locale est responsable devant Christ personnellement.
Rappelons encore que la primauté de Rome dans les écrits d’Irénée au 2ème siècle (voir 2ème article de la série sur la papauté) était due à la conservation de la tradition apostolique (dans le contexte des hérésies du 2ème siècle où d’autres églises avaient chuté). On peut déduire que si cette tradition devait ne plus être maintenue dans le futur, d’autres églises pouvaient récupérer le rang de Rome si celles-ci conservaient fidèlement à leur tour l’enseignement apostolique. Le commentaire d’Irénée, encore valide au 2ème siècle, compte tenu de la situation à Rome, ne l’était plus nécessairement 4 siècles plus tard. La boussole ici est la fidélité aux écrits apostoliques. Il ne s’agit pas de transmettre le pouvoir rigidement, surtout avec les hauts et les bas avec lesquels il faut s’attendre avec les hommes.
Par ailleurs, Pierre a chuté de temps à autre et il n’y a aucune logique à penser que ses successeurs à Rome, en tant qu’évêque au début puis pape plus tard, ont été irréprochables tout au long des siècles qui ont suivi. Ce qui compte c’est la tradition apostolique. Bien que Pierre et Paul aient fondé l’église de Rome et qu’ils ont été exemplaires, cela ne signifie pas que cette même église soit restée parfaite longtemps après eux, juste parce qu’ils en sont à l’origine. Une église est exemplaire et légitime, non parce qu’elle se réclame de tel ou tel apôtre, mais parce qu’elle enseigne et applique la Parole du Christ relatée par les apôtres. On ne peut pas valider un enseignant ou un responsable chrétien sous prétexte qu’il revendique une affiliation aux apôtres mais parce qu’il est en accord avec la Parole de Dieu. Quelle est donc la valeur de ce responsable chrétien, qui se réclame des apôtres, mais qui est en contradiction avec la Parole de Dieu?? Enfin les apôtres Pierre et Paul nous ont appris le principe de la collégialité, de l’horizontalité et non du leader suprême infaillible! Il n’y a pas d’intermédiaire entre Dieu et les hommes, pas de pape, mais uniquement le Fils de Dieu:
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme,
1 Timothée 2:5
Le principe fondamental des orthodoxes : la collégialité
Les Églises orthodoxes affirmaient que tous les évêques étaient égaux en dignité sacramentelle. L’organisation normale de l’Église était collégiale : les décisions étaient prises ensemble par l’ensemble des évêques, réunis en conciles (synodes en grec). Chaque Église locale (patriarcat, métropole) était autocéphale (autonome) sous son propre évêque ou patriarche. Il n’y a pas un seul évêque au-dessus de tous les autres.
Sur quels fondements théologiques et historiques se basaient-ils ? Le modèle biblique.
- Matthieu 18:20 : « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
- Actes 15 (Concile de Jérusalem) :
- Les apôtres se réunissent ensemble pour décider de la question des païens.
- Pierre est présent, mais ne préside pas seul.
- Jacques (frère du Seigneur) semble jouer un rôle de modérateur.
Les décisions dans l’Église primitive sont conciliaires, collégiales, et non imposées par Pierre. C’est l’exemple qu’il faut suivre. La même idée se dégageait des pères de l’église:
Pour lire la suite de l’article veuillez vous inscrire ou vous connecter si vous avez déjà un compte:

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!