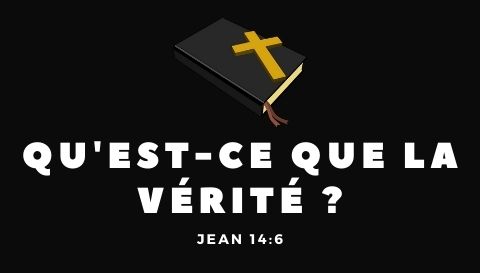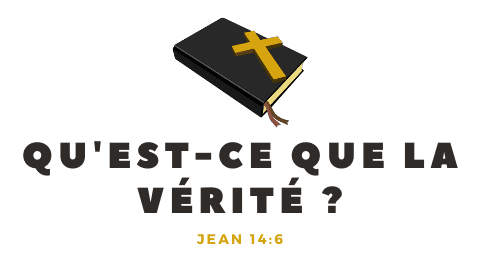La Sélection Naturelle: une expression critiquée par des … évolutionnistes
Plusieurs scientifiques non créationnistes, et souvent évolutionnistes, remettent en question l’expression « sélection naturelle » et voire même le concept en entier. Cela en dit longs pour les créationnistes, qui ne doivent en aucun cas l’intégrer dans leur modèle biologique.
Jerry Fodor, philosophe et cognitiviste, critique l’illusion darwinienne de la “sélection naturelle”
« Quelle est donc la morale de tout cela? D’abord, que le récit darwinien classique de l’évolution, centrée sur la sélection naturelle, est en difficulté sur les plans conceptuel et empirique. Darwin était trop “environnementaliste”. Il semble avoir été séduit par l’analogie avec la sélection artificielle, en imaginant que la sélection naturelle jouait le rôle de l’éleveur. Mais cette analogie est manifestement fausse: la sélection artificielle est réalisée par des êtres dotés d’un esprit, ce que la sélection naturelle n’a pas. »
tirée de sa célèbre critique Why Pigs Don’t Have Wings (2010). London Review of Books no. 20:19-22, p.20.
Darwin personnifie la nature en lui donnant le rôle d’un éleveur mais l’élevage implique un esprit, une intention, un but. Or, la nature n’a ni conscience ni volonté: elle ne “sélectionne” pas au sens propre. Fodor rejoint ici des critiques comme celles de William Dembski ou de Randy Guliuzza (ICR):
parler de “sélection” est trompeur si l’on parle d’un processus inconscient sans capacité de choix.
« L’alternative à la théorie de Darwin, c’est que la direction du changement phénotypique est largement déterminée par des variables endogènes. La littérature scientifique actuelle suggère que les modifications du calendrier des processus de développement génétiquement contrôlés constituent souvent la variable endogène privilégiée. »
tirée de sa célèbre critique Why Pigs Don’t Have Wings (2010). London Review of Books no. 20:19-22, p.20.
Fodor propose ici une vision internaliste de l’évolution (proche du modèle CET ou de l’évo-dévo moderne):
- Ce n’est pas l’environnement extérieur (comme le veut Darwin) qui dicte les formes du vivant,
- Ce sont les mécanismes internes à l’organisme (gènes du développement, timing, auto-organisation…) qui orientent le changement.
Il met donc en avant un modèle où l’organisme n’est pas façonné de l’extérieur, mais déploie son potentiel selon une logique interne.
| Darwin (externaliste) | Fodor (internaliste) |
|---|---|
| L’environnement trie, sélectionne, sculpte | Les mécanismes internes guident la variation |
| Nature ≈ éleveur inconscient | Pas de choix sans conscience |
| Sélection naturelle = agent principal | Processus de développement = moteur réel |
Fodor, sans être créationniste, offre une critique rationnelle puissante du cœur du darwinisme, et ouvre la voie à d’autres explications, plus cohérentes avec ce que l’on observe.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
William Dembski: la biologie évolutive a besoin d’un substitut au concepteur
« En résumé, la biologie évolutive a besoin d’un substitut au concepteur pour coordonner les changements aléatoires transmis de génération en génération. Et il n’y a qu’un seul candidat naturaliste sur la table: la sélection naturelle. Il n’est d’ailleurs pas fortuit que les mots sélection et intelligence soient étymologiquement liés — le lec de sélection a la même racine que le lig de intelligence. Tous deux dérivent d’une racine indo-européenne signifiant “rassembler”, et donc, “choisir”. »
tirée de The Design Revolution (2004, p. 263)
Dembski souligne ici un problème fondamental du darwinisme. Pour que l’évolution fonctionne sans Dieu, il fallait remplacer le concepteur. Darwin a tenté de le faire avec la “sélection naturelle” mais cela pose un gros problème. Pourquoi? Parce que le mot sélection implique un acte volontaire: choisir, c’est rassembler avec intention une chose plutôt qu’une autre. Et donc parler de “sélection” sans intelligence, c’est déjà une contradiction étymologique. La nature ne réfléchit pas, ne compare pas, ne projette pas, elle ne choisit rien.
« Ce qui a rendu Darwin célèbre, c’est d’avoir affirmé que des forces naturelles, sans finalité ni anticipation, possédaient néanmoins le pouvoir de choisir, via la sélection naturelle. En attribuant ce pouvoir de choix à des forces naturelles non intelligentes, Darwin a perpétué la plus grande escroquerie intellectuelle de l’histoire des idées. La nature n’a aucun pouvoir de choisir. »
tirée de The Design Revolution (2004, p. 263)
Dembski est ici radical et précis. Il accuse Darwin d’avoir commis un détournement de sens fondamental: faire croire que la nature pouvait choisir sans esprit.
- Pour les darwiniens la sélection naturelle “choisit” les traits bénéfiques.
- Pour Dembski (et les créationnistes) cela revient à prêter une intention à un processus aveugle, ce qui est philosophiquement et scientifiquement incohérent.
| Sélection artificielle (éleveur) | Sélection naturelle (nature) |
|---|---|
| Choix conscient, objectif, dirigé | Processus inconscient, aveugle, aléatoire |
| Fait partie d’un plan intentionnel | Aucun plan, aucun but, aucune réflexion |
| Requiert une intelligence | Nature n’a pas de volonté ni de pensée |
Lewontin: la force motrice de l’évolution des pratiques des éleveurs de plantes et d’animaux
« Darwin a très explicitement tiré sa compréhension de la force motrice de l’évolution des pratiques des éleveurs de plantes et d’animaux, qui choisissent consciemment des individus avec des caractéristiques désirées pour les reproduire. La “sélection naturelle” est donc, selon lui, une transposition à grande échelle de la sélection humaine. »
publiée dans le New York Times Book Review (2010).
Lewontin reconnaît ici que Darwin s’est inspiré directement de l’action des éleveurs (sélection artificielle), pour forger le concept de sélection naturelle. Mais cette analogie pose un problème fondamental:
L’éleveur est conscient, intentionnel, orienté vers un but.
La nature, elle, ne pense pas, ne choisit pas.
C’est une projection anthropomorphique, une confusion entre volonté humaine et processus aveugle.
« Mais bien sûr, peu importe ce qu’est la “nature”, ce n’est pas une créature consciente dotée d’une volonté,
et toute tentative de comprendre les véritables mécanismes de l’évolution doit être libérée de ce fardeau métaphorique. »publiée dans le New York Times Book Review (2010).
Lewontin critique ici le langage trompeur de la théorie darwinienne. On parle de nature qui “sélectionne”, de “choix” de la nature… Or, cela suppose une volonté, une conscience. Mais la nature ne choisit rien, c’est une illusion linguistique.
Ce que Lewontin appelle le “metaphorical baggage” (fardeau métaphorique), c’est précisément ce que Dembski ou Fodor dénoncent aussi: l’usage abusif de mots liés à l’intelligence pour décrire des processus mécaniques et non dirigés.
Neil Thomas – une nature dépourvue d’intelligence
« Darwin — contre les objections de Wallace et d’autres collègues, qui lui faisaient remarquer qu’il n’existait aucune comparaison valable entre ce que faisaient les éleveurs d’animaux par ingéniosité humaine et la manière dont agissait une nature dépourvue d’intelligence — a néanmoins affirmé une analogie entre les méthodes d’élevage artificiel (comme celles des éleveurs de pigeons) et la prétendue “sélection” effectuée par la nature elle-même. »
tirée de son article “Natural Selection: A Conceptually Incoherent Term” publié sur evolutionnews.org le 1er décembre 2021.
Neil Thomas souligne ici une critique historique forte: même les collègues de Darwin, dont Alfred Russel Wallace (co-découvreur de la sélection naturelle), n’étaient pas d’accord avec l’analogie centrale du darwinisme. Ils estimaient, à juste titre, que l’élevage artificiel est conscient, volontaire, finalisé (ex. : produire un pigeon au plumage particulier). La nature, elle, est aveugle, sans volonté, sans intention. Assimiler les deux, comme Darwin l’a fait, n’a pas de base logique ou philosophique cohérente.
Darwin savait que son analogie était fragile. Ses pairs l’ont averti que nature ≠ éleveur. Pourtant, il a persisté, en faisant de la “sélection naturelle” une sorte de substitut inconscient de l’intelligence humaine. C’est donc une analogie trompeuse, que Darwin a imposée malgré les avertissements.
Neil Thomas montre que même au sein du camp de Darwin, il y avait des réserves. Mais Darwin a quand même bâti toute sa théorie sur une confusion sémantique, en transformant un choix humain en une force naturelle inconsciente.
Réponse de Pierre Flourens (1794 – 1867)secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences française:
« Enfin l’ouvrage de M. Darwin a paru. On ne peut qu’être frappé du talent de l’auteur. Mais que d’idées obscures, que d’idées fausses! Quel jargon métaphysique jeté mal à propos dans l’histoire naturelle, qui tombe dans le galimatias dès qu’elle sort des idées claires, des idées justes! Quel langage prétentieux et vide! Quelles personnifications puériles et surannées! O lucidité! 0 solidité de l’esprit Français, que devenez-vous?«
réponse à L’Origine des espèces de Darwin par le secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences française M. Pierre Flourens.
Une « sélection naturelle » intraduisible en allemand?
Lorsqu’il fallut traduire On the Origin of Species de Charles Darwin en allemand, un problème majeur s’est posé immédiatement: comment fallait-il rendre fidèlement l’expression « natural selection » ?
En anglais, le mot “selection” évoque un choix actif, souvent conscient, associé à un sujet rationnel (un éleveur, un juge, un stratège). Mais la nature, dans la vision darwinienne, est dépourvue de volonté, de but ou d’intelligence. Il s’agissait donc d’un concept intrinsèquement contradictoire. Les traducteurs allemands ont été frappés par cette incohérence:
comment parler de “Naturauswahl” (sélection par la nature) alors que la nature ne choisit rien?
Il n’y a pas de verbe allemand neutre qui puisse désigner un choix non conscient sans que cela sonne absurde ou personnifiant.
L’anglais a cette particularité d’être tolérant aux métaphores floues. Mais dans une langue comme l’allemand, plus rigoureuse conceptuellement, où les mots doivent coller au réel, cette contradiction saute aux yeux.
C’est pourquoi même certains intellectuels allemands de l’époque ne comprenaient pas comment une “force naturelle” pouvait sélectionner, alors qu’en allemand le verbe auswählen (sélectionner) implique nécessairement un sujet agentif.
Traduire “natural selection” revenait donc à importer en allemand une erreur conceptuelle contenue dans l’anglais, à légitimer un choix sans volonté, un éleveur fantôme.
Si même une traduction est impossible sans contradiction, c’est peut-être le concept même qui est erroné. Ce n’est pas simplement une difficulté linguistique. C’est un indice puissant que la sélection naturelle, en tant qu’agent causal, est une fiction rhétorique, une tentative de faire faire à la nature ce que seul un esprit peut accomplir.
Roger Lewin
Dans ses commentaires sur un nouveau mécanisme de l’évolution postulé par Edward Wiley et Daniel Brooks, Roger Lewin (Science 217:1239-1240, 1982) déclare:
« La sélection naturelle, élément central du néo-darwinisme, est prise en compte dans la théorie de Brooks et Wiley, mais seulement comme une influence mineure. “Elle peut affecter la survie”, dit Brooks. “Elle peut éliminer une partie de la complexité et ainsi ralentir la dégradation de l’information qui aboutit à la spéciation. Elle peut avoir un effet stabilisateur, mais elle ne favorise pas la spéciation. Ce n’est pas une force créatrice comme beaucoup l’ont suggéré.” »
Beaucoup de créationnistes pensent que la sélection naturelle c’est « simple »
Beaucoup de créationnistes considèrent que le concept de sélection naturelle est simple, selon eux, il ne s’agirait que d’un constat de « survie différentielle » ou de « reproduction différentielle« . Mais si tout cela se résumait à une simple description statistique, pourquoi donc les évolutionnistes eux-mêmes débattent-ils depuis 160 ans de ce concept? Pourquoi les définitions varient-elles autant? Pourquoi des figures comme Jerry Fodor, Stephen Jay Gould ou Richard Lewontin, pourtant évolutionnistes, ont-ils remis en question sa cohérence conceptuelle?
Même Alfred Russel Wallace, co-découvreur de l’idée de sélection naturelle, avait demandé à Darwin de renoncer à ce terme, le jugeant trompeur. Mais Darwin ne pouvait pas l’abandonner, car ce terme servait un but central dans sa démarche philosophique.
Le projet de Darwin était clair: remplacer Dieu par la Nature. Là où les croyants parlaient de création, Darwin parlait de nature. Mais ce mot n’est pas neutre. Il efface le Créateur en attribuant à « la nature » des rôles qui ne peuvent revenir qu’à une intelligence consciente: choisir, trier, orienter, façonner.
Pour que la nature puisse “sélectionner”, elle devrait être dotée d’une volonté, de valeurs, d’un jugement de ce qui est préférable. Or, la nature n’a ni conscience, ni intention, ni objectif. Darwin a tenté alors de rendre l’analogie crédible en parlant de l’éleveur mais à y regarder de près, l’analogie est vide : l’éleveur agit selon un but, la nature non.
C’est précisément cette confusion que les traducteurs allemands ont perçue lorsqu’ils ont tenté de traduire « natural selection » : comment peut-on parler de sélection sans sélectionneur?
Enfin, du point de vue biblique, le mot “nature” désigne souvent notre nature pécheresse (cf. Romains 7:5, 2 Pierre 1:4). Il est donc doublement trompeur. Pour un chrétien, parler de création nous rappelle qu’il y a un Créateur. Substituer le mot “création” par “nature”, c’est adoucir la conscience du Créateur, et c’est justement ce que Darwin voulait faire: donner à la nature le rôle de Dieu.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!