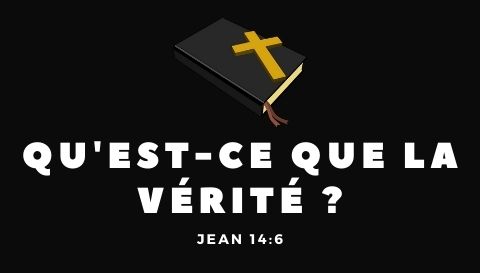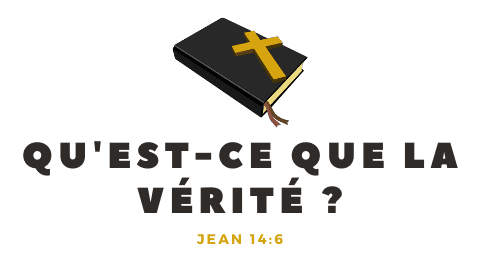Réponse aux commentaires sur « Examen des preuves de l’évolution – les preuves anatomiques – EP 01 »
La première vidéo réponse aux « 8 preuves de l’évolution » de Passe-Science a été publiée le 17/09/2025 et a produit quelques commentaires intéressants de la part d’évolutionnistes. Je vous invite à regarder cette vidéo pour bien comprendre les propos. Je vais traiter ici les commentaires qui nécessitent une réponse développée.
Je liste ici quelques liens utiles qui traitent des arguments de l’abiogenèse et de l’évolution théiste (ou autre tentative de compromis évolution+création) puisqu’ils sont furtivement évoqués dans les échanges.
- Réflexion sur l’Abiogenèse, le fondement de toute théorie de l’évolution
- Sélection Naturelle et Créationnisme peuvent-ils faire bon ménage? EP 02
- Pourquoi la Genèse est cruciale pour comprendre Jésus
Je tiens tout d’abord à remercier tous les évolutionnistes qui ont une approche constructive et respectueuse, malgré des désaccords profonds. Mon but est de proposer une réflexion saine et respectueuse de chacun et de chaque camp. Cela pourrait aider et guider notamment les gens neutres et encore indécis sur le sujet des origines.
Pour ceux qui veulent comprendre ma manière d’aborder la biologie, voici une playlist récente et importante de la chaîne YouTube QQLV où j’aborde le sujet en long et en large:

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
- Objection sur les similarités structurelles et le concepteur en commun
- 1) Il n’existe pas « une » solution optimale unique
- 2) Les contraintes de système diffèrent radicalement
- 3) Le pentadactyle n’est pas “inutile” chez le cétacé
- 4) Un design modulaire n’est pas une monoculture
- 5) Convergence externe, divergence interne
- 6) “Déformer une patte” n’est pas un bricolage
- 7) Diversité fonctionnelle et écologie
- En somme
- Le biais du « j’aurais fait mieux »
- Argument sur l’évolution « non magique »
- Pourquoi autant d’ailes différentes?
- Sur les os pelviens de baleine
- Sur le nerf laryngé récurrent
Dans les encarts gris, les commentaires des internautes.
Objection sur les similarités structurelles et le concepteur en commun
Si les similarités structurelles étaient le résultat d une conception optimisée, alors pourquoi plusieurs solutions techniques différentes pour des nageoires de reptiles fossiles, de différents types de poissons, de cétacés et autres mammifères marins, voire d oiseaux. Une nageoire classique de poisson est capable de parfaitement assurer cette fonction de nageoire sans avoir la structure d aucune de ces autres nageoires, en particulier les cinq doigts. Si vous aviez raison, alors l ingénieur aurait optimisé une fonction et l aurait utilisée autant chez le dauphin que chez le requin, plutôt que d aller déformer une patte plus du tout adaptée à la nage.
Donc votre argument des quatre roues utilisées sur plusieurs voitures ne fonctionne pas. Si c était un ingénieur qui choisissait les diverses sous structures, il utiliserait la meilleure pour tout le monde, car il saurait laquelle c est, et il est infiniment bon.
C’est une objection pertinente et elle mérite une réponse structurée.
1) Il n’existe pas « une » solution optimale unique
En ingénierie réelle, on n’optimise jamais une seule variable: on a plusieurs objectifs (traînée, portance, manœuvrabilité, accélération, endurance, silence, robustesse, coût tissulaire, contrôle neurologique…). On obtient une frontière de Pareto de solutions toutes optimales… pour des compromis différents. Un Concepteur rationnel peut donc choisir plusieurs optima selon les contraintes de système.
2) Les contraintes de système diffèrent radicalement
Les poissons ont un squelette cartilagineux/osseux, une respiration branchiale, une propulsion latérale de la queue (requins/actinoptérygiens) et des nageoires rayonnées très efficaces. Ces nageoires avant servent à la stabilité, la portance (sinon le requin coulerait) et parfois même en propulsion secondaire (raies, labres…).
Les cétacés qui sont des mammifères ont une respiration aérienne, une colonne, des muscles et commande neurologique de mammifère et une propulsion dorso-ventrale avec la queue horizontale. Les membres antérieurs deviennent des ailerons de contrôle permettant la stabilité et les virages, non propulsifs.
Les reptiles marins fossiles (ichtyosaures, plésiosaures) et oiseaux plongeurs ont des objectifs et profils d’usage encore différents (vol battu sous l’eau, vol plané, “rowing” vs “flapping”, lift-based vs drag-based, etc.).
Ils ont une même “fonction” globale (se mouvoir dans l’eau) mais pas les mêmes exigences système. D’où des architectures différentes logiques, il n’y a pas d’“erreur”.
3) Le pentadactyle n’est pas “inutile” chez le cétacé
Les nageoires antérieures des cétacés ne sont pas des propulseurs, ce sont des surfaces de contrôle (trim, roulis, tangage, stabilité à haute vitesse). Le module pentadactyle (avec hyperphalangie chez plusieurs groupes) permet:
- un allongement/raidissement progressif de l’aileron,
- une distribution des charges et de la torsion,
- un contrôle fin du bord d’attaque et du vrillage,
- une fabrication via un programme embryonnaire robuste et réutilisable (même “bibliothèque” de développement, sortie différente).
4) Un design modulaire n’est pas une monoculture
L’argument “un ingénieur parfait choisirait la même meilleure solution pour tout le monde” confond modularité et uniformité. En pratique, les ingénieurs réutilisent des modules communs (interfaces, patterns) mais varient l’architecture selon la mission (ex. hélices, jets, turbopropulseur, voiles qui sont toutes “optimales” dans leur niche).
Dans un cadre créationniste, la réutilisation de modules (comme le plan pentadactyle):
- réduit la complexité génomique (mêmes plans, réglages différents),
- accroît la robustesse (tolérance aux perturbations),
- facilite l’adaptabilité (principe CET/“engineered adaptability”: paramétrage différent, mêmes briques).
5) Convergence externe, divergence interne
L’hydrodynamique nécessite des formes externes convergentes (fusiforme), mais la mécanique interne suit les contraintes propres à chaque “plateforme” (poisson vs mammifère). Qu’un même Designer produise une coque hydrodynamique similaire (convergence “prévisible”) et des mécaniques internes différentes (cohérentes avec le reste du système), est précisément ce qu’on attend d’une conception système.
6) “Déformer une patte” n’est pas un bricolage
Dans un cadre créationniste, ce n’est pas un “bricolage”, c’est l’emploi d’un module polyvalent qui une fois re-paramétré, devient un aileron stabilisateur. De plus, le propulseur principal des cétacés n’est pas ce membre antérieur, c’est la nageoire caudale. L’analogie des “quatre roues partout” est assez général, on peut aussi parler “ailerons d’avion adaptés à chaque cellule de mission” (planeur, chasse, cargo, hydravion).
Dauphin et requin fonctionnent manifestement très bien avec leurs outils respectifs. On a pas l’impression pour le dauphin d’une patte « plus du tout adaptée à la nage ». Bien au contraire.
Que ce soit un dauphin, un oiseau ou un insecte, chaque système est parfaitement fonctionnel dans son contexte écologique.
On ne trouve pas de cétacé “boîteux” qui échoue à nager ou de chauve-souris incapable de voler, ils sont opérationnels et spécialisés.
7) Diversité fonctionnelle et écologie
Un monde de “meilleure solution unique” appauvrit la diversité des niches et la résilience des écosystèmes. La variété de solutions (nageoires rayonnées, nageoires pentadactyles, palettes reptiliennes, ailes d’oiseaux plongeurs) remplit des niches différentes, stabilise les réseaux trophiques1 et permet des stratégies de vie variées (chasse à haute vitesse, virages serrés en bancs, plongée profonde, vol sous-marin, etc.).
En somme
- Il n’y a pas une seule “meilleure” nageoire, il y a des optima différents selon les contraintes système.
- Les cétacés n’utilisent pas leurs membres antérieurs comme propulseurs mais comme surfaces de contrôle: le module pentadactyle est donc pertinent (bien que d’autres systèmes puissent exister).
- Un Concepteur qui vise robustesse, adaptabilité et diversité n’emploierait pas une monoculture de solutions, mais des architectures variées fondées sur des modules communs.
- Enfin, l’objectif du Concepteur n’était pas simplement « fonctionnel » mais aussi « artistique », créer une variété de formes diverses et variées pour aboutir à une création riche, variée, époustouflante (comme avec la traîne du paon).

Le biais du « j’aurais fait mieux »
Tout ingénieur sait que concevoir c’est faire des compromis (robustesse vs légèreté, puissance vs endurance, etc.). Quand on dit: « Moi, j’aurais choisi une seule solution optimale », on ignore les contraintes multiples auxquelles doit répondre un système biologique. C’est un biais rétrospectif où on juge le design d’après nos propres priorités (efficacité brute, simplicité apparente), mais sans voir toutes les autres variables.
Personne ne peut créer un “dauphin avec nageoires de poisson” et mesurer s’il aurait survécu mieux ou moins bien dans tous les environnements. On est donc dans une critique spéculative (“ça aurait pu être mieux”), mais pas dans une preuve.
Il est facile de critiquer et de proposer un autre design en imaginant un “meilleur monde”. Mais c’est compliqué, parce qu’on ne peut ni tester ces alternatives, ni juger sans voir toutes les contraintes. Le fait est que les organismes fonctionnent efficacement, ce qui est déjà un argument fort pour un design intentionnel et robuste.
Argument sur l’évolution « non magique »
L évolution, quand à elle, n est pas magique, le plan d organisation à cinq doigts s est simplement établi et stabilisé chez un ancêtre des tétrapodes. Dans cette lignée, l évolution pourra déformer des structures, en faire disparaître d autres (tous les tétrapodes actuels n ont pas 5 doigts, vous devez avoir tous les nombres de doigts de 6 à zéro), elle s applique sur un matériel préexistant. Il n y a pas eu de mutation ( stable) qui ait amené à sept doigts chez les tétrapodes, je crois. Il faut aller chercher des mollusques pour avoir sept “ doigts” ou plus.
1) « L’évolution n’est pas magique, elle déforme un plan préexistant »
Exactement, nous sommes d’accord que les organismes « travaillent » sur un plan préexistant. Mais pour nous créationnistes, ce plan n’est pas le fruit du hasard, c’est un design de base modulaire conçu pour être adaptable.
Les tétrapodes ont reçu dès l’origine un module pentadactyle polyvalent. Le fait qu’il puisse être réduit, modifié, fusionné ou hyper-développé (cheval à 1 doigt, oiseaux avec fusion/ossification, les cétacés avec hyperphalangie, etc.) correspond parfaitement à une conception d’ingénierie flexible.
Un standard industriel (USB, rails de montage, plan châssis) est conçu pour être décliné, réduit, étendu, mais toujours à partir du même module de base.
2) « Il n’y a pas eu de mutation stable qui ait amené 7 doigts »
Justement la stabilité du pentadactyle malgré des millions de générations est un argument en faveur d’une contrainte interne forte et non d’une liberté évolutive illimitée.
On peut dire si on veut qu’il n’y a pas eu de mutation stable qui ait amené 7 doigts mais on peut aussi dire que cela a été conçu ainsi.
Dans le modèle CET, cela correspond à des frontières de design: le module est calibré pour rester entre 0 et 5 (avec exceptions pathologiques polydactyles), mais pas au-delà.
Ce n’est donc pas un hasard, c’est le signe que le système est conçu avec des limites (avec contrainte et sécurité).
Pourquoi autant d’ailes différentes?
De la même façon, pourquoi aurait il crée autant d ailes différentes? Les structures ( en particulier osseuses) des ailes d oiseaux, de reptiles, de chauves souris ( et ne parlons pas des insectes) sont très différentes. Ne prenez pas les anatomistes pour des imbeciles, cela fait bien longtemps qu ils avaient remarqué. L évolution convergente est une prédiction de l évolution, pas du créationnisme, et on la constate.
Là encore, on confond « même fonction » et « mêmes contraintes ».
- Les oiseaux ont des ailes optimisées pour le vol actif + légèreté + plumes portantes.
- Les chauves-souris ont ailes pour le vol nocturne + manœuvrabilité extrême + contrôle sensoriel par doigts.
- Les ptérosaures avaient ailes tendues sur un doigt géant, adaptées à d’autres niches écologiques.
- Les insectes ont un système totalement différent (non homologue), basé sur un exo-squelette et muscles indirects.

Dans le modèle CET, cette diversité est le résultat d’un design modulaire commun (le vol) décliné en solutions indépendantes, chacune optimisée pour un écosystème/niche différent. Comme dit plus haut, il est facile de critiquer un travail accompli en disant qu’on pourrait le faire autrement, que d’autres choix auraient pu être fait, sans doute que le Concepteur aurait pu concevoir de bien des manières mais à la fin, des choix ont été faits. Oiseaux, chauves-souris, ptérosaures et insectes fonctionnent ou fonctionnaient parfaitement dans leur rôle et leur écologie particulière.
1) « L’évolution convergente est une prédiction de l’évolution, pas du créationnisme »
Le modèle darwinien classique met l’accent sur la divergence à partir d’un ancêtre commun :
- l’ancêtre commun a une structure X,
- les descendants modifient X dans des directions différentes.
La « convergence » implique que lignes séparées inventent plusieurs fois de façon indépendante la même solution complexe. Ce n’est pas évident à prédire à partir du simple principe de “descendance avec modification”, surtout quand il s’agit de structures complexes (ailes, yeux, sonar).
L’évolution explique la convergence par le fait que « l’environnement sélectionne des formes similaires » c’est une explication circulaire et externe. En fait, il existe des formes très diversifiées d’organismes dans les mêmes environnements, preuve que l’environnement ne façonne pas une forme plus qu’une autre. La dernière partie de la vidéo détaille tout le raisonnement.
Le modèle CET explique la convergence par des systèmes intégrés qui sont préprogrammés pour détecter certaines conditions environnementales et répondre par des solutions prédictibles (comme des capteurs + algorithmes internes).
La convergence n’est ainsi pas une « surprise expliquée après coup », c’est ce qu’on attend d’un système conçu avec un catalogue de solutions adaptatives.
Deux constructeurs automobiles différents produisent indépendamment des SUV aérodynamiques fuselés. Pourquoi? Parce que les contraintes routières/aérodynamiques sont connues, et parce que l’ingénierie fournit des solutions similaires quand on veut répondre aux mêmes besoins.
Nous aurons l’occasion de parler de ce qui était prédit par l’évolution et par le créationnisme dans l’épisode 2 sur les preuves développementales.
Sur les os pelviens de baleine
Vous n avez pas bien saisi l argument de passe science sur les os vestigiaux des baleines. Il vous parle de l articulation, qui n est pas fonctionnelle, et il n y a aucun lien ( ni attache) entre les organes sexuels et cette articulation, dont la baleine a d autant moins besoin qu elle n est pas appelé à faire son job d articulation. Il n y a donc aucune raison technique de mettre un système aussi complexe qu une articulation bloquée pour attacher des muscles. Par contre, ça s explique très bien par l évolution.
Certains os des hanches des mammifères ont les mêmes fonctions que celles qui semblent subsister sur les os des hanches vestigiales des baleines. L hypothèse de Randy Giuiuzza est que ces os subsistent par sélection sexuelle. On peut voir ça comme ça. La reproduction serait alors la dernière pression sélective sur les os des hanches des baleines, ce qui expliquerait qu ils subsistent, même encore inutilement complexes. Toutes ces histoires de contrôle de penis que vous nous racontez si bien, ça concerne les os pelviens, pas la fameuse articulation.
La communication non verbale par les micro mouvements des oreilles, il fallait oser! Je regarderai mieux vos oreilles dans les prochaines videos’ j ai peut être raté quelque chose.
1) « Articulation inutile » vs. rôle reproductif réel
Les os pelviens des cétacés ne sont pas reliés à la colonne, ils n’articulent pas un fémur mais ils ne sont pas « gratuits » car ils servent d’ancrages musculaires à des muscles qui contrôlent le pénis (ischiocaverneux, bulbo-spongieux, rétracteurs, etc.). Plusieurs équipes ont montré que la taille et la forme de ces os corrèlent avec l’intensité de la compétition sexuelle (proxys par la taille relative des testicules), plus la compétition est forte, plus les os pelviens sont grands/complexes pour attacher des muscles plus puissants et raffiner le contrôle pénien. Autrement dit il y a une fonction établie (contrôle génital), ce n’est pas un vestige.
Je ne comprends pas avec certitude la partie du commentaire « il vous parle de l articulation, qui n est pas fonctionnelle, et il n y a aucun lien ( ni attache) entre les organes sexuels et cette articulation« . De quelle articulation parle t-on? Chez les cétacés (baleines, dauphins, marsouins), il n’y a pas d’acétabulum, pas de tête de fémur, et donc pas d’articulation coxo-fémorale.
Chez les baleines ce qu’on observe, ce sont de petits os pelviens qui servent de points d’ancrage à la musculature reproductive. C’est pourquoi parler d’une « articulation bloquée inutile » est inexact car il n’y a pas d’articulation, mais un système osseux pleinement fonctionnel.
L’évolutionniste, certainement bien intentionné dans les commentaires, est probablement induit en erreur par la déclaration de Cabaret dans sa vidéo qui déclarait ceci:
« Par exemple l’os pelvien chez les baleines entièrement noyé dans une masse musculaire et sur lequel on peut parfois même identifier une ancienne articulation sphérique, comme celle de la hanche. Si certains peuvent encore argumenter l’utilité de l’ensemble, ceci devient plus douteux en ce qui concerne cette rotule, ne pouvant ici clairement plus tenir son rôle d’articulation omnidirectionnelle. »
Les os affichés dans la vidéo de Cabaret et tirés d’une étude de Thewissen2, montre un os présenté comme un acetabulum sur un spécimen de baleine boréale juvénile. Mais ce n’est pas un véritable acetabulum au sens strict, mais plutôt une zone déprimée ou parfois une anomalie morphologique (que les évolutionnistes appellent atavisme). En fait l’étude dit elle-même:
« In modern bowhead whales (pictured here is the pelvis of an adult male, Balaena mysticetus, NSB-98B5), the acetabulum and obturator foramen are lost, and the ilium is reduced. »
« Chez les baleines boréales modernes (ici, le bassin d’un mâle adulte, Balaena mysticetus, NSB-98B5), l’acétabulum et le foramen obturateur sont perdus et l’ilion est réduit. »

Les os pelviens des baleines sont souvent considérés par les évolutionnistes comme étant principalement dérivés de l’ischium et/ou du pubis. Il est donc très improbable de pouvoir y identifier la forme caractéristique d’un acétabulum (la cavité sphérique), car cette structure a, selon les évolutionnistes même, été perdue. L’os est généralement une simple tige osseuse.
Dans un bassin de mammifère terrestre, on distingue bien l’ilion, l’ischion et le pubis qui forment ensemble l’acetabulum et le foramen obturé. Chez les baleines modernes, le bassin est réduit à 1 ou 2 bâtonnets osseux isolés. Ces éléments sont tels que même les évolutionnistes ne peuvent pas dire avec certitude s’il s’agit de reliquats de l’ilium, de l’ischion, du pubis, ou d’une fusion indifférenciée.
L’évolution repose sur le principe que l’on peut tracer des homologies (une même structure héritée d’un ancêtre commun). Or, ici, les structures sont si réduites et indifférenciées que même les spécialistes ne peuvent pas s’accorder sur l’homologie exacte. Cela affaiblit encore la force de l’argument évolutif car si on ne sait pas ce que c’est, comment être sûr que c’est « le reste » d’un os précis?
Certains (comme Johannes Slijper à l’époque) voyaient encore des “restes d’acetabulum ou de fémur” mais les recherches modernes concluent plutôt à une absence totale de ces repères donc il ne reste qu’un os flottant, de forme indéterminée. En pratique, chacun interprète selon son modèle.
L’articulation de la hanche, au sens classique du terme (une articulation entre le bassin et le fémur permettant le mouvement d’un membre), n’est pas observée chez la baleine. Les baleines développent des bourgeons externes sur leurs membres postérieurs dans le ventre de leur mère. Ceux-ci se réduisent généralement et disparaissent avant la naissance du baleineau, mais il arrive rarement qu’ils soient conservés jusqu’à l’âge adulte. Ce cas d’atavisme sera traité dans l’épisode 2 de la review sur les preuves développementales.
L’argument évolutionniste de base était que l’os pelvien entier des baleines était vestigial, un reliquat sans utilité. Pendant des décennies, l’argument phare était : “Les baleines gardent un bassin inutile, preuve qu’il s’agit d’un vestige d’ancêtres terrestres.” L’os pelvien entier était présenté comme sans fonction.
De manière plus générale, en ingénierie, lorsqu’on dérive une nouvelle version d’un objet à partir d’une plateforme commune, certains détails de design hérités subsistent, même sans rôle actif, ce n’est pas un bricolage, mais un effet de modularité.
Les baleines fonctionnent superbement bien aujourd’hui, elles ne sont pas entravés ou gênés par quoi que ce soit. Elles sont parfaitement fonctionnelles dans leur milieu:
- nage efficace,
- reproduction réussie,
- diversité et abondance dans les océans.

Si on veut pointer « un mauvais design », il faut montrer qu’un élément particulier « réel » pénalise la performance de l’organisme (énergie gaspillée, maladie, handicap, vulnérabilité…). Or, chez les baleines, on observe aucune gêne à la nage, aucun problème reproductif, aucune pathologie particulière.
3) « Muscles auriculaires vestigiaux: micro-mouvements, sérieusement ? »
Côté humain, des travaux électrophysiologiques récents montrent que les muscles auriculaires (dit vestigiaux selon l’évolution) s’activent quand on focalise l’attention auditive et que leur activité code la direction de la source, il y a donc une fonction (faible mais mesurable), il n’y a donc rien de vestigial et d’inutile.
Les muscles auriculaires humains s’activent pendant l’écoute dirigée, ils montrent une fonction mesurable. Ils sont les acteurs discrets d’un mécanisme d’orientation qui révèle, pour qui sait le mesurer, la direction secrète de notre écoute. L’activité neuromusculaire subtile des muscles auriculaires humains est corrélée avec le focus de l’attention auditive.3
Notre système auditif « pointe » nerveusement l’oreille dans la direction d’où provient le son qui captive notre attention, même si le mouvement n’est pas visible à l’œil nu.
Sur le nerf laryngé récurrent
Je ne connaissais pas ces arguments sur le nerf laryngé. Une petite fibre musculaire locale aurait joué le même rôle, concernant l artère en étant bien plus économe et ingénieuse. Détourner un nerf si important ( vous le rappelez) avec tous les inconvénients ( dont une plus grande vulnérabilité), ce n est pas une bonne idée. Quant aux terminaisons annexes, il n y a pas non plus d intérêt particulier à détourner le nerf principal et lui imposer un aller retour pour raccourcir quelques terminaisons annexes…
Vous ne devriez pas dire du mal de l exaptation, c est votre meilleure carte au sujet des organes vestigiaux. Il suffit qu ils aient encore une utilité, même si ce n est plus l initiale, pour que vous invoquiez une subtile conception optimisée, alors que ça ressemble plutôt à de la recup…
1) « Une petite fibre locale ferait mieux »
C’est un faux dilemme. Le nerf laryngé récurrent (NLR) n’innerve pas « un point », il distribue sur tout le trajet des branches trachéales, œsophagiennes et cardiaques (via le vague). Une “petite fibre locale” au larynx ne remplacerait pas cette intégration neurovégétative le long du cou.
C’est aussi une question de contrôle intégré. Le chemin long permet de synchroniser larynx–trachée–cœur (réflexes tussigènes, déglutition, modulation parasympathique). Dans le modèle CET, c’est un design multi-objectif où plusieurs contraintes sont desservies par un seul « bus » neural.
2) « Le détour augmente la vulnérabilité »
Toute architecture a des compromis. Certes, un trajet long est plus exposé, mais en échange on obtient multifonction, redondance et coordination cardio-respiratoire.
Les atteintes du NLR sont surtout iatrogènes (thyroïde/chirurgie), ils ne sont pas la preuve d’un « mauvais design », de même qu’un faisceau de câbles centralisé en avion n’est pas « mal conçu » parce qu’on peut l’abîmer en maintenance si on ne fait pas attention.
3) Rôle « sangle » fœtale et ductus arteriosus
Des travaux morphologiques montrent le soutien mécanique du ductus arteriosus par le vague + NLR durant le développement, avec une différence tissulaire locale compatible avec ce rôle. Dans une perspective créationniste, c’est typique d’un usage transitoire prévu (échafaudage/guide).
4) Exaptation: « votre meilleure carte ? »
En CET, on parle de pré-adaptation planifiée / de réutilisation modulable: un même sous-système peut avoir plusieurs usages (fœtus vs adulte) sans que l’un « récupère » l’autre par hasard.
Trouver une fonction actuelle à un organe naguère déclaré “vestigial” n’est pas un sauvetage ad hoc, c’est au contraire ce qu’on attend d’un design robuste et polyvalent.
Le Dr Guliuzza a correctement analysé l’argument de l’exaptation, aucun chercheur n’observe une exaptation, c’est une histoire rajoutée par dessus les faits pour maintenir le scénario de départ.
- Un réseau trophique est l’ensemble des relations alimentaires entre les êtres vivants d’un écosystème.
- Cetacean Evolution: Copulatory and Birthing Consequences of Pelvic and Hindlimb Reduction – Lisa Noelle Cooper, Robert Suydam, and J. G. M. Thewissen.
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7334025/.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!