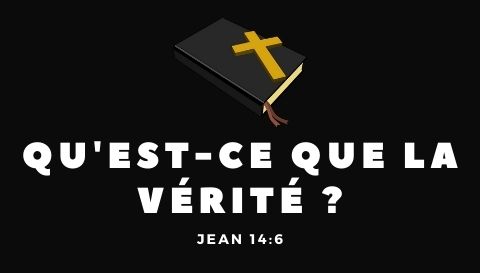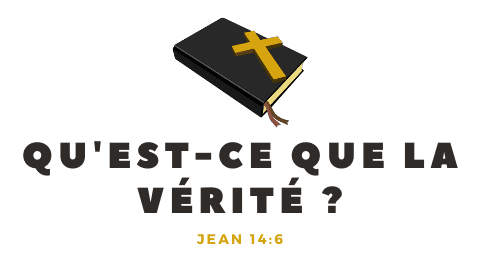La Responsabilité du Catholicisme Romain dans les Schismes de l’Église, la Révolution Française et la Montée de l’Athéisme
L’Église Catholique Romaine (ECR) est connue pour être la plus grande institution chrétienne au monde. On la connaît également pour son exclusivisme religieux: en dehors d’elle, il n’y a pas de salut, de rémission des péchés, de vraie église. L’ECR revendique la succession Pétrinienne et serait par conséquent la seule église visible du Christ. Dans d’autres articles sur le site, nous avons longuement étudié les problèmes théologiques et logiques de la papauté, de l’exclusivisme ecclésiale, de la structure même de l’église, des titres accordés aux responsables catholiques etc… Dans cet article nous allons explorer les conséquences historiques dues à la rigidité, aux erreurs et au mode de fonctionnement de cette église à travers les âges.
En effet, le schisme entre les églises d’occident et d’orient en 1054, s’explique en grande partie avec la volonté romaine de s’imposer aux autres églises, en conflit flagrant avec l’écriture. Une position biblique aurait empêché ce schisme et permis un développement du christianisme beaucoup plus robuste et uniforme.
La chute de la monarchie française, du catholicisme et pour ainsi dire du christianisme dans son ensemble, en France, est en grande partie due à l’église catholique. Son action durant les siècles précédant cette révolution a encouragé ou facilité la montée du déisme et de l’athéisme, puis finalement de l’évolution géologique et biologique.
Ce constat nous exhorte à tous, chrétiens, de rester fidèle à la Parole de Dieu, car lorsqu’on s’en écarte, les divisions apparaissent, des éléments incorrects s’insèrent dans la théologie, des mauvais comportements s’observent et nous nous éloignons de l’église apostolique du premier siècle.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
L’Église Catholique a attendu Vatican II pour encourager officiellement la lecture de la Bible aux fidèles. Elles les en avaient pratiquement privé depuis son origine, en conservant les textes dans une langue illisible par le peuple. Cela a permis l’insertion de dogmes sans bases bibliques et historiques et a induit de nombreuses générations en erreur, et ce jusqu’à aujourd’hui.
La verticalité de l’église a empêcher l’horizontalité de l’église du premier siècle d’empêcher les erreurs, sous couvert de l’autorité pétrinienne, un concept apparu officiellement au 5ème siècle sous Léon 1er pour légitimer la suprématie de Rome sur les autres églises de l’époque qui étaient son égale (Antioche, Alexandrie, Jérusalem…). Les dérives grimpantes ont culminé jusqu’aux indulgences monnayées qui ont provoqué la réforme protestante.
Le mot « protestant » vient du latin protestari, qui signifie: « témoigner publiquement », « déclarer solennellement », ou « affirmer avec force ». Le mot « protestant » ne veut pas dire « protester » comme souvent perçu à tort.
Le christianisme actuel doit beaucoup à Martin Luther et à Jean Calvin (pour ne citer qu’eux). C’est grâce à eux que nous sommes revenus sur le chemin de l’étude biblique et des fondamentaux chrétiens. C’est encore eux qui nous ont permis d’avoir la Bible en langue vernaculaire, comprise par le peuple. Le peuple ayant été dans l’obscurité théologique pendant au moins un millénaire car dans l’Église Catholique, on a longtemps empêché que des Bibles se retrouvent dans les mains des croyants, de peur que des interprétations indésirables (et fâcheuses pour les dogmes catholiques) soient proposées. Ce fonctionnement a abouti à une marginalisation de la Bible au profit du magistère et de la tradition, souvent en contradiction directe avec la Parole de Dieu.
Martin Luther
L’histoire de Martin Luther, le réformateur protestant, est celle d’un moine allemand qui a profondément bouleversé l’histoire religieuse de l’Europe et donné naissance au protestantisme. Il est né en 1483 à Eisleben en Allemagne et est est issu d’une famille de mineurs. Il a étudié le droit, mais lors d’un orage en 1505, il a fait le vœu de devenir moine s’il survivait. Il est alors entré chez les Augustins puis fut ordonné prêtre en 1507, et enfin devint professeur de théologie à Wittenberg, en Saxe. Martin Luther était donc un prêtre et théologien catholique à ses débuts.
Luther était profondément tourmenté par la question du salut: comment pouvait-on être juste devant Dieu? En étudiant l’Épître aux Romains, il a découvert que le salut venait par la foi seule, non par les œuvres ou les indulgences. C’était le principe de la justification par la foi.
Le 31 octobre 1517, Luther a affiché ses 95 thèses à la porte de l’église de Wittenberg. Il y a dénoncé notamment la vente des indulgences, pratique par laquelle l’Église prétendait écourter le purgatoire contre de l’argent. Cela a marqué le début symbolique de la Réforme protestante. Luther a refusé de se rétracter et a été convoqué à Worms en 1521 devant l’empereur Charles Quint où il a déclaré:
« Ma conscience est captive de la Parole de Dieu… Je ne puis faire autrement. »
Il a ensuite été excommunié par le pape et mis au ban de l’Empire (toute personne pouvant l’arrêter). Il s’est caché au château de Wartburg par Frédéric le Sage (duc de Saxe) et il y a traduit le Nouveau Testament en allemand, rendant les Écritures accessibles au peuple. Il rédigea également des catéchismes, des traités, et a réorganisé la liturgie dans un sens plus simple et centré sur la Bible.
En 1529, à la Diète de Spire, des princes allemands et des villes libres ont protesté officiellement contre la décision impériale d’imposer le catholicisme et d’interdire la Réforme. Ce sont ces “protestataires” qu’on a appelé dès lors “protestants”.
Luther n’a pas voulu fonder une nouvelle Église au départ: il voulait réformer l’Église catholique de l’intérieur. Mais ses thèses sur la justification par la foi seule, son rejet des indulgences, de l’autorité papale, et de certains sacrements ont provoqué une rupture. Après son excommunication en 1521, ses disciples ont formé une Église indépendante, appelée plus tard Église luthérienne.
La Réforme s’est répandue rapidement en Allemagne et en Europe. Des princes, des villes et des peuples ont adopté les idées de Luther. Il s’est marié avec Katharina von Bora, une ancienne nonne et ils ont eu plusieurs enfants. Luther est mort en 1546 à Eisleben.
Les principes fondamentaux du luthéranisme sont les suivants:
- Sola Scriptura: l’Écriture seule est autorité.
- Sola Fide: le salut s’obtient par la foi seule.
- Sola Gratia: le salut est un don gratuit de Dieu.
- Sacrements réduits à deux: baptême et cène.
- Sacerdotalité universelle: tous les croyants sont prêtres.
D’autres réformateurs suivront comme:
- Jean Calvin en Suisse (fondateur du calvinisme, ou Réformés).
- Ulrich Zwingli à Zurich.
- John Knox en Écosse (Église presbytérienne).
Chacun développera sa propre vision de la Réforme, mais Luther est la source initiale.
Les indulgences
Les indulgences étaient, dans l’Église catholique médiévale, des remises partielles ou totales des peines temporelles dues pour les péchés déjà pardonnés. Dans la théologie catholique un péché mortel entraîne la culpabilité devant Dieu et une peine éternelle (enfer). Quand on se confesse, Dieu pardonne la culpabilité et épargne l’enfer, mais il reste une peine temporelle à expier (dans cette vie ou au purgatoire). Cette peine peut être réduite par des bonnes œuvres, des prières, des sacrifices, ou par une indulgence.
L’indulgence est une remise partielle ou totale des peines temporelles après le pardon du péché, accordée par l’Église. Elle ne pardonne pas les péchés, mais réduit les conséquences du péché déjà pardonné. À partir du XIe siècle, des indulgences sont données à ceux qui participent aux croisades puis elles sont accordées en échange de dons financiers pour financer des œuvres de l’Église (comme la basilique Saint-Pierre à Rome). Des prédicateurs comme Johann Tetzel affirment des choses très discutables:
« Dès que l’argent résonne dans la caisse, l’âme s’envole du purgatoire. »
Luther n’était pas contre le principe d’indulgence à l’origine, mais contre la vente des indulgences, qu’il voyait comme une corruption de l’Évangile. Pour lui (et pour tout chrétien normalement constitué), on ne pouvait pas acheter le salut, ni se libérer du purgatoire par de l’argent. Cette critique a été au cœur de ses 95 thèses de 1517.
Aujourd’hui, l’Église catholique condamne la vente d’indulgences. Elle continue à enseigner leur validité, mais uniquement dans un cadre spirituel: prière, confession, communion, œuvre de charité, etc.
Le développement historique des indulgences catholiques
Le développement historique des indulgences catholiques s’étend sur plus de mille ans et reflète une évolution progressive de la théologie de la pénitence, des abus pratiques, puis des réformes internes.
Au début (IIIe – Ve siècles), les péchés graves (adultère, meurtre, apostasie…) nécessitaient une pénitence publique très stricte (parfois de plusieurs années). Certains martyrs ou confesseurs (personnes ayant beaucoup souffert pour leur foi) pouvaient intercéder pour d’autres pécheurs, raccourcissant leur pénitence. Cette pratique est considérée comme un ancêtre des indulgences: l’idée d’un transfert spirituel de mérite.
Au Moyen Âge (VIe – XIe siècles), le système devient plus « tarifé » et personnel (livres de pénitence). La pénitence restait liée à des actes concrets (jeûnes, pèlerinages, prières, aumônes…). L’idée d’indulgence a pris forme et on commençait à réduire la peine pénitentielle en cas de bonnes œuvres.
En 1095, le pape Urbain II promet une indulgence plénière (totale) à ceux qui participent à la Première croisade. Cela marque une étape majeure: pour la première fois, toutes les peines temporelles sont annulées pour une action déterminée. Des indulgences sont ensuite accordées pour les pèlerinages, les constructions d’églises, etc.
Les indulgences deviennent monnayables: on peut « racheter » des années de pénitence ou soulager les âmes du purgatoire contre de l’argent.
A la fin du Moyen Âge (XIVe – XVe siècles), l’Église finance ses projets (notamment la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome) grâce à ces ventes. Des prédicateurs (comme Johann Tetzel) exagèrent les promesses: on parle d’acheter directement le salut.
Ce fameux Johann Tetzel était un moine dominicain allemand, il est le personnage le plus associé à la vente d’indulgences. Il a prêché en Allemagne pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, sur ordre de l’archevêque Albert de Brandebourg, avec l’autorisation du pape Léon X.
Le pape Léon X a autorisé et encouragé la campagne d’indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Il a délégué l’organisation à des autorités locales, dont Albert de Brandebourg, qui a emprunté de l’argent aux banquiers Fugger, et a remboursé via la vente des indulgences. Luther a réagit contre cette situation en 1517.
En 1517 donc, Martin Luther a publié ses 95 thèses contre les abus liés aux indulgences. Il contestait le fait qu’on puisse obtenir le pardon ou libérer des âmes du purgatoire en payant. Cela a déclenché la Réforme protestante et entraîné une remise en question globale de l’autorité papale et des pratiques liées aux sacrements.
Le Concile de Trente (1545–1563), en réponse à la Réforme, confirme la doctrine des indulgences mais condamne fermement tout abus et commerce. L’Église a rappelé que les indulgences ne pardonnent pas les péchés, mais les peines temporelles. Elles devaient être liées à des actes spirituels sincères: confession, communion, prière…
A l’époque moderne (XVIIe – XXe siècles), les indulgences sont peu à peu réformées et recentrées sur des pratiques spirituelles: lire la Bible, prier le chapelet, adorer le Saint-Sacrement… Le pape Paul VI, en 1967 (bulle Indulgentiarum Doctrina), clarifie et simplifie la discipline des indulgences. Il supprime les mentions de « jours » ou « années » d’indulgences (ex. : 300 jours), jugées trompeuses et insiste sur la conversion intérieure comme condition préalable.
L’Église catholique continue d’accorder des indulgences, plénières ou partielles, dans un cadre spirituel strict. Par exemple: un fidèle peut obtenir une indulgence plénière s’il accomplit certaines conditions:
- Confession sacramentelle.
- Communion eucharistique.
- Prière aux intentions du pape.
- Réalisation d’un acte spirituel (lecture de la Bible, pèlerinage, prière du rosaire, etc.)
Les bases bibliques invoquées pour les indulgences (dans leur version spirituelle, non monnayée)
Le pouvoir des clés (Matthieu 16:19)
« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
— Jésus à Pierre.
L’Église interprète ce passage comme donnant à Pierre (et à ses successeurs) le pouvoir d’accorder le pardon et les grâces, y compris de remettre les peines temporelles des péchés.
La communion des saints (1 Corinthiens 12:26 ; Colossiens 1:24)
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. »
« Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ, pour son corps, qui est l’Église. »
L’Église catholique enseigne que les mérites du Christ et des saints forment un trésor spirituel commun, dans lequel elle peut puiser pour aider les fidèles à alléger leurs peines — d’où l’idée d’indulgence.
L’idée de réparation (2 Samuel 12:13-14)
David reçoit le pardon de son péché (adultère et meurtre), mais subit tout de même une conséquence (mort de l’enfant). Cela montre, selon l’interprétation catholique, qu’il y a une peine temporelle même après le pardon.
Nulle part dans la Bible on ne trouve une mention explicite d’une indulgence telle qu’instituée par l’Église (avec durée, calcul, transfert, etc.). Jésus pardonne gratuitement, sans mention de peines résiduelles conditionnées à des œuvres ou des dons financiers (cf. Luc 7:48, Jean 8:11). Le salut, selon Éphésiens 2:8-9, est par la grâce, par la foi, non par des œuvres ou un achat de mérite :
« C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. »
Les Réformateurs (Luther, Calvin…) ont affirmé que la pratique des indulgences, surtout vendues, n’avait aucun fondement scripturaire et contredisait la suffisance de la croix du Christ. Pour la réflexion sur Matthieu 16:18-19 et les clefs de Pierre, je vous invite à lire l’article suivant. La pierre en question n’est pas Pierre mais la foi de Pierre ou Jésus directement. Ces mêmes clefs sont remis aux autres apôtres et probablement à tous les croyants. Pierre ne reçoit jamais un rôle de chef ou de pape dans le Nouveau Testament. Les arguments catholiques sont extrapolés et exagérés pour forcer la légitimité papale.
Jean Calvin
L’histoire de Jean Calvin (ou Jean Cauvin, en français d’origine) est celle d’un réformateur français du XVIe siècle, deuxième grande figure du protestantisme après Martin Luther. Il est le père du calvinisme, une branche majeure du protestantisme, et a profondément influencé la pensée théologique, politique et sociale en Europe et dans le monde.
Il est né en 1509 à Noyon, en Picardie (France) a été formé d’abord à la théologie, puis au droit à l’université de Paris et d’Orléans. C’était un humaniste influencé par la Renaissance, il lisait les Pères de l’Église et les classiques grecs et latins. Vers 1533, il s’est convertit à la Réforme, influencé par les idées de Luther.
La France est devenue de plus en plus hostile aux réformés (persécutions, arrestations) et Calvin a fui Paris, puis s’est exilé en Suisse. En 1536, à seulement 26 ans, il a publié son ouvrage majeur: « L’Institution de la religion chrétienne, un traité systématique de théologie protestante. »
En route vers Strasbourg, Calvin s’arrête à Genève (1536-1538). Le réformateur Guillaume Farel le convainc de rester pour organiser la Réforme dans la ville. Calvin tente d’instaurer une discipline stricte, mais il est chassé par les autorités après deux ans. Il devient ensuite pasteur de la communauté française réfugiée à Strasbourg (1538-1541). Il y développe sa pensée, écrit un commentaire biblique et épouse Idellette de Bure, une veuve.
En 1541, les Genevois rappellent Calvin. Il met en place une organisation ecclésiastique rigoureuse:
- Prédication centrée sur la Bible,
- Élection des pasteurs,
- Discipline morale et ecclésiale (avec les anciens et le Consistoire),
- Éducation (création de l’Académie de Genève en 1559).
Il fait de Genève une ville modèle de la Réforme, surnommée plus tard “la Rome protestante”. Des milliers de réfugiés (français, italiens, anglais, néerlandais…) viennent se former à Genève. Ses idées s’exportent dans toute l’Europe, en France (avec les Huguenots), aux Pays-Bas, en Écosse (via John Knox), en Angleterre, et plus tard les États-Unis (via les Puritains). Il meurt en 1564 à Genève, épuisé mais il laisse un immense héritage. Les points majeurs de sa théologie sont:
| Doctrine | Explication |
|---|---|
| Sola Scriptura | Seule l’Écriture fait autorité. |
| Souveraineté de Dieu | Dieu est souverain en toutes choses, y compris dans le salut. |
| Prédestination | Dieu a choisi d’avance ceux qu’il sauve, non à cause de leurs œuvres. |
| Justification par la foi | Le salut est un don reçu par la foi seule, pas par les mérites. |
| Vie chrétienne disciplinée | L’éthique, la moralité et la piété sont centrales. |
Le calvinisme influence non seulement la religion, mais aussi l’éthique du travail, le développement de l’éducation populaire, une certaine vision de la démocratie (via la discipline partagée) et le droit de résistance face aux autorités injustes (notamment chez les huguenots français).
Calvin a des vues théologiques très similaires avec Luther avec quelques différences sur la prédestination, la présence du Christ dans la cène, le style théologique et la relation au culte où il favorise un culte simple et épuré, centré sur la parole, sans images ni symboles, sans accepter les formes héritées du catholicisme (chants, ornements, liturgie.).
De manière intéressante, Calvin et Luther, bien que contemporains, ne se sont jamais rencontrés personnellement. Calvin reconnaissait en Luther le pionnier de la Réforme. Il parlait de lui avec respect, même s’il ne partageait pas tous ses points de vue. Calvin a correspondu avec des disciples de Luther, notamment un certain Melanchthon, qu’il appréciait beaucoup. Il a tenté de favoriser l’unité entre les branches protestantes (luthériens et réformés), mais ces tentatives ont échoué à son époque à cause des désaccords sur la Cène.
Pourquoi le Protestantisme n’est pas très développé en France?
Le protestantisme était porteur d’un retour aux sources salutaire. Il a pris en France mais a été violemment réprimé, ce qui a limité sa progression à long terme. Il a connu un fort essor au XVIe siècle, puis une série de persécutions qui ont conduit à sa marginalisation dans le royaume très catholique de France. Vers 1550, on estimait à 1 à 2 millions le nombre de protestants en France (appelés Huguenots), soit environ 10 % de la population, ce qui représentait une proportion considérable.
S’en suivi des persécutions royales avec le roi François Ier (puis Henri II) qui était reste fidèle au catholicisme. Après l’Affaire des Placards (1534), il a lancé de sévères répressions contre les protestants. De nombreux réformés ont été emprisonnés, torturés ou brûlés vifs.
Le conflit entre catholiques et protestants a généré des centaines d’exécutions violentes. Des huguenots accusés de sédition, d’hérésie ou de complots contre le roi furent pendus, décapités, brûlés vifs, ou roués vifs, surtout s’ils étaient considérés comme des chefs ou meneurs.
Huit guerres sanglantes ont opposé catholiques et protestants entre 1562 et 1598. L’événement le plus tragique est le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où des milliers de protestants sont tués à Paris et dans les provinces. Malgré cela, les protestants ont continué de résister militairement et politiquement.
En 1598, Henri IV, un ancien protestant devenu roi de France, a publié l’Édit de Nantes qui accordait une liberté de culte partielle aux protestants dans certaines villes. Cela a instauré une paix religieuse fragile, mais sans égalité totale avec les catholiques.
En 1685, Louis XIV révoque l’Édit de Nantes par l’Édit de Fontainebleau. Le protestantisme devient interdit: les temples sont détruits, les pasteurs exilés, les enfants enlevés aux familles huguenotes pour être élevés catholiques. Des centaines de milliers de protestants ont fui la France vers la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Angleterre, voire l’Amérique.
Louis XIV, en révoquant l’édit, a rendu illégale toute pratique protestante. Ceux qui refusaient de se convertir au catholicisme ou qui organisaient des cultes clandestins étaient arrêtés, jugés, puis parfois roués vifs en place publique. D’autres étaient envoyés aux galères, enfermés ou déportés.
Ce n’est qu’à la Révolution française (1787-1789) que les protestants obtiennent la liberté religieuse avec l’Édit de tolérance. Le culte protestant est rétabli légalement, et les réformés peuvent à nouveau bâtir des temples et organiser leurs Églises.
En 1787, deux ans avant la Révolution, le roi Louis XVI promulgue cet Édit de Tolérance. Ce texte reconnaissait légalement les protestants comme citoyens français et leur accordait le droit de se marier, d’avoir un état civil et d’hériter. Il ne leur accordait pas encore la liberté de culte public: le protestantisme restait toléré mais pas encore pleinement libre.
La Révolution a proclamé la liberté de conscience et la liberté des cultes. En 1791, tous les cultes sont libres: protestants, juifs, catholiques… Cela a marqué la fin des discriminations religieuses en France. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, les protestants pouvaient bâtir librement des temples, organiser des assemblées publiques, et exister sans clandestinité.
Louis XVI a signé l’Édit de Tolérance en 1787 sous l’influence de plusieurs facteurs politiques, philosophiques et sociaux. Ce n’était pas un geste purement personnel, mais le résultat d’un contexte de pression intellectuelle et morale croissante.
Au XVIIIe siècle, des penseurs comme Voltaire, Montesquieu, Diderot ou Rousseau ont dénoncé l’intolérance religieuse. L’affaire Calas (1762), où un protestant innocent est exécuté, scandalise l’Europe. Voltaire mène une campagne acharnée pour sa réhabilitation. L’idée que l’État doit garantir la liberté de conscience devenait de plus en plus populaire, surtout dans les cercles éclairés.
Certains catholiques continuent aujourd’hui de plaider coupable pour Jean Calas: celui-ci aurait tué son fils et n’était donc pas un innocent martyr protestant. Il a toutefois été innocenté à titre posthume en 1765 après une campagne menée par Voltaire qui a démontré qu’il s’agissait d’une erreur judiciaire motivée par le fanatisme religieux et les préjugés anti-protestants.
Son fils, Marc-Antoine Calas, s’est probablement suicidé (peut-être par pendaison) — selon les témoignages indirects et les reconstitutions de l’époque. Il était instable, désespéré, et en conflit avec son père, notamment pour des raisons liées à sa situation sociale et religieuse.
Le suicide était très mal vu à l’époque: il empêchait l’enterrement religieux et était considéré comme un crime. Marc-Antoine Calas était instable, dépressif, désespéré par son avenir: il voulait devenir avocat, mais à l’époque les protestants n’avaient pas accès aux professions juridiques.
La famille aurait découvert son corps pendu — et craignant que son suicide ne leur attire encore plus de honte ou de sanctions (le suicide interdisait l’enterrement chrétien), elle aurait tenté de faire croire à un accident.
Malgré l’absence de preuve, Jean Calas a été interrogé sous la torture, sans aveux, puis jugé par des magistrats catholiques influencés par la rumeur populaire. Il a été condamné à mort par supplice de la roue, en mars 1762, parce qu’il était protestant, parce qu’on croyait (à tort) que Marc-Antoine voulait se convertir au catholicisme et parce que l’opinion publique de Toulouse était profondément anti-huguenote.
Dans ce contexte, Jean Calas a été condamné sans preuve, uniquement sur la base de soupçons religieux. Cette affaire a été un tournant dans la lutte contre l’intolérance religieuse en France.
La roue a été utilisée comme instrument de terreur contre les protestants en France. Elle a frappé notamment les pasteurs clandestins, les résistants camisards, et ceux qui refusaient la conversion forcée au catholicisme. Cette pratique illustre la violence de l’intolérance religieuse de l’Ancien Régime, et elle est restée profondément ancrée dans la mémoire protestante française.
Le supplice de la roue consistait à briser les membres d’un condamné, puis à l’exposer sur une roue jusqu’à sa mort, parfois lente et atroce. Ce châtiment visait à punir dans la chair et à terroriser les foules, mais il est aujourd’hui un symbole de la cruauté judiciaire d’Ancien Régime, comme l’illustre tragiquement l’affaire Jean Calas.
Les protestants étaient exclus du mariage civil, de l’état civil, de l’héritage… ce qui créait des injustices flagrantes et des situations absurdes. Il était illégal pour un couple protestant de se marier, ou pour un enfant d’hériter de ses parents si le notaire était catholique. Ces absurdités dérangeaient même les catholiques modérés et montraient que la législation était dépassée voire injuste.
La monarchie était affaiblie par les dettes, les tensions sociales et religieuses, et les premières revendications politiques. Il fallait restaurer un minimum de paix religieuse est un geste apaisant pour éviter de nouvelles tensions internes. Le roi a cherché à montrer qu’il était un souverain juste et éclairé, capable d’évoluer.
Le protestantisme s’est implanté en France avec force au XVIe siècle, mais a été écrasé par la persécution, notamment sous Louis XIV. Il existe encore aujourd’hui, bien qu’il soit minoritaire (environ 2–3 % de la population), avec une diversité de courants: réformés, luthériens, évangéliques, pentecôtistes, etc.
Le protestantisme originel n’a pas été plus tolérant que le catholicisme de son époque: il a conservé la même logique d’intolérance religieuse, visant à imposer une vérité unique et à réprimer l’hérésie, qu’elle soit catholique, anabaptiste ou antitrinitaire. Luther, Calvin et Zwingli ont rejeté la liberté de conscience et soutenu la persécution des dissidents, maintenant le modèle d’unité confessionnelle propre au Moyen Âge.
La tolérance n’a émergé que progressivement, sous la pression des conflits religieux et des voix minoritaires: les anabaptistes ont prôné la séparation de l’Église et de l’État, Sébastien Castellion a dénoncé la répression des hérétiques après l’affaire Servet, le traité de Westphalie (1648) a instauré un premier équilibre politique entre confessions, et John Locke a théorisé la liberté religieuse au XVIIe siècle. Ce cheminement long et conflictuel a conduit, bien plus tard, à une évolution vers le pluralisme dans certains courants protestants.
Le début de la fin avec Louis XIV
Louis XIV avait révoqué l’Édit de Nantes en 1685. Cela avait mis fin à un siècle de tolérance relative envers les protestants en France. Ce choix peut sembler contradictoire avec l’héritage de son arrière-grand-père Henri IV, mais il s’explique par plusieurs raisons profondes, religieuses, politiques et idéologiques.
Pour lire la suite de l’article veuillez vous inscrire ou vous connecter si vous avez déjà un compte:

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!