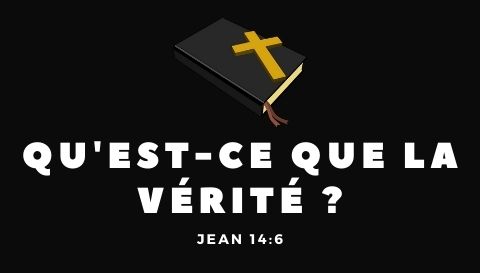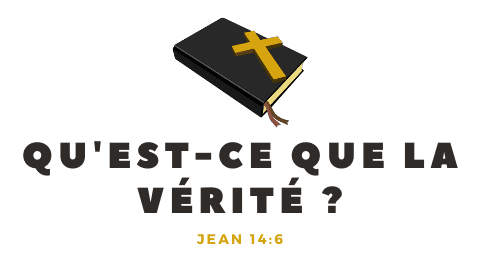Les Évangiles de l’Enfance : entre Traditions, Controverses et Héritages Interreligieux
Quand on lit les évangiles du Nouveau Testament, on n’y trouve qu’une histoire sur l’enfance de Jésus, elle se trouve dans Luc chapitre 2. Chaque année, la famille monte à Jérusalem pour la fête de Pâque. À 12 ans, Jésus reste dans le Temple sans que ses parents s’en rendent compte. Ils le cherchent pendant trois jours, puis le trouvent assis parmi les docteurs, les écoutant et les interrogeant, suscitant l’étonnement par son intelligence. Quand Marie le réprimande, il répond : « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » Il repart avec eux à Nazareth et leur reste soumis, mais Marie garde toutes ces choses dans son cœur.
Cette histoire a fasciné l’église primitive qui s’est demandée ce que Jésus avait pu faire d’autres dans son enfance. Cela a mené à ce qu’on appelle « les évangiles de l’enfance » dont l’origine remonte probablement à la moitié du deuxième siècle de notre ère. Une fois que l’on atteint le troisième siècle, nous avons non seulement des versions grecques sur l’enfance de Jésus mais aussi des traductions en latin, en araméen, en syriaque et plus tard en arabe. Ces « évangiles » se sont répandus dans de nombreux endroits dans différentes versions et manuscrits. Il est très difficile de les retracer à une édition unique. Le père de l’église, Irénée de Lyon, écrivant dans les années 180, exprime son dégout envers ces évangiles parce qu’il ne croyait pas qu’ils étaient authentiques.
La Transmission des Evangiles de l’Enfance
En ce qui concerne les Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament, les copistes et érudits chrétiens savaient faire la distinction entre des textes considérés comme inspirés, qui devaient être copiés avec une extrême rigueur, et d’autres écrits, comme les traditions sur l’enfance de Jésus ou divers apocryphes, qui laissaient plus de place à l’édition, à la variation, voire à la réinvention. C’est pourquoi il est très rare de trouver deux manuscrits identiques des évangiles de l’enfance datant de la période byzantine ou médiévale. Ces textes ont été continuellement modifiés et enrichis au fil des siècles, et les éditions modernes disponibles aujourd’hui ne représentent qu’une infime partie de la diversité manuscrite qui circulait autrefois.
Certains sceptiques assimilent la transmission du Nouveau Testament à celle des évangiles de l’enfance, mais cette comparaison est trompeuse. Il est important de s’informer soi-même sur la question. Le livre d’Alan Mugridge, Copying Early Christian Texts, apporte un éclairage précieux : en étudiant des centaines de manuscrits chrétiens datant du IIe au IVe siècle, il montre que les textes considérés comme inspirés étaient en général copiés par des scribes professionnels – de « niveau A » – qui n’étaient pas forcément chrétiens et n’avaient aucun intérêt théologique à altérer le texte. Les autres écrits, jugés édifiants mais non inspirés, étaient confiés à des scribes de « niveau B ». Enfin, les textes plus personnels ou populaires, comme les évangiles apocryphes, étaient copiés par des scribes de « niveau C », souvent moins rigoureux et plus enclins à des variations.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
L’étude du Dr Alan Mugridge montre que le Nouveau Testament ne présente aucune preuve de modifications généralisées ou intentionnelles, ce qui contraste fortement avec la tradition des évangiles de l’enfance, où les manuscrits varient considérablement d’une version à l’autre. Il est pratiquement impossible de trouver deux copies identiques de ces récits apocryphes.
Les premiers chrétiens savaient parfaitement faire la distinction entre les Écritures considérées comme inspirées — traitées avec une rigueur et un profond respect — et les récits plus personnels ou édifiants, transmis de manière plus souple. Cette hiérarchie de fiabilité et de sacralité était bien perçue et respectée dès les premiers siècles.
Un autre point de divergence majeur tient à la distance temporelle entre les textes originaux et les copies disponibles : pour les évangiles de l’enfance et autres apocryphes, les manuscrits que nous possédons datent souvent du XIIIe au XVe siècle, soit plus d’un millénaire après leur composition supposée au IIe siècle. À l’inverse, les manuscrits du Nouveau Testament grec les plus anciens remontent à quelques décennies à quelques siècles seulement après leur rédaction, ce qui permet une reconstruction textuelle très fiable, avec un taux de confiance supérieur à 99 %.
Pour les textes apocryphes ou gnostiques, une telle reconstruction est impossible. Les variantes sont si nombreuses, et les manuscrits si tardifs, que l’on ne peut même pas proposer une version approximative de ce à quoi ces textes pouvaient ressembler au début du IIIe siècle. On ne possède, au mieux, que des citations ou allusions chez les Pères de l’Église, sans pouvoir reconstruire le contenu original avec certitude.
Le contenu des évangiles de l’enfance
Ces écrits tardifs, souvent composés entre le IIe et le VIe siècle, cherchent à combler les silences des Évangiles canoniques concernant les premières années de Jésus. Leur but est de raconter ce que les textes officiels taisent : la vie de Jésus bébé, puis enfant. Dans ces récits, l’enfant Jésus parle dès la naissance, possède une connaissance surnaturelle, et même conseille sa mère. Parfois, il guérit les malades simplement par son toucher, Marie le posant sur la personne souffrante et la guérison se produisant instantanément.
Ces textes regorgent également d’histoires étonnantes, parfois étranges, comme celles de la fuite en Égypte, lorsque la Sainte Famille échappe à Hérode. D’autres épisodes décrivent Jésus vers l’âge de 5 ou 6 ans, à l’école du sabbat, humiliant son professeur par sa science infinie. Dans l’atelier de Joseph, il compense les erreurs de menuiserie de son père en étirant miraculeusement une planche de bois trop courte.
Le jeune Jésus est parfois présenté comme un sauveur, guérissant et protégeant, mais aussi comme un enfant effrayant : lorsqu’il est réprimandé pour avoir façonné des moineaux d’argile un jour de sabbat, il maudit un homme qui vieillit sur-le-champ ; lorsqu’un enfant le bouscule, il le fait mourir par une parole, avant de le ressusciter. Dans un autre épisode, il fait s’envoler les oiseaux d’argile en frappant des mains.
Ce Jésus-là est surhumain, mais immature, presque inquiétant. Il semble expérimenter et apprendre à maîtriser ses pouvoirs, parfois de manière violente, impulsive ou irrévérencieuse. Ce qui soulève une question de fond : pourquoi le représenter ainsi ? Pourquoi cet enfant divin est-il dépeint comme instable, insolent, voire dangereux ?
La réponse se trouve probablement dans le besoin de combler les zones d’ombre des Évangiles, mais aussi dans une curiosité populaire insatiable. Ces évangiles apocryphes répondent à un désir de merveilleux, de détails, de récits édifiants ou spectaculaires. Toutefois, leur contenu théologique est souvent douteux, parfois même exagéré, au point de frôler le conte ou la légende, plutôt que la confession de foi.
Comment expliquer les évangiles de l’enfance?
L’explication la plus plausible, avancée notamment par le Dr Craig Evans, est que les premiers récits de l’enfance de Jésus reflètent une tentative des premiers chrétiens de répondre à la culture religieuse dominante de l’époque. Dans un monde imprégné de mythologie gréco-romaine, Jésus était souvent comparé aux dieux olympiens, comme Dionysos ou Hercule, dont les récits d’enfance mettaient en avant des traits de caractère puissants, parfois capricieux ou violents.
Par exemple, une histoire populaire racontait que le jeune Hercule, fils de Zeus et d’une mortelle, s’était emporté durant un cours de musique et avait tué son professeur en lui brisant sa harpe sur le crâne. De la même manière, dans les évangiles de l’enfance, Jésus est parfois représenté comme un enfant aux pouvoirs extraordinaires mais encore non maîtrisés, capable de bénir ou maudire, de guérir ou faire mourir.
La différence essentielle, toutefois, c’est que contrairement aux dieux païens, qui restent instables ou hostiles aux humains, Jésus évolue : il grandit, mûrit, et devient le Sauveur compatissant et proche des hommes. Ces récits pourraient donc avoir une fonction apologétique : répondre aux critiques païennes en montrant que Jésus, lui aussi, était remarquable dès l’enfance, mais qu’il incarne un modèle supérieur de divinité, capable d’amour et de sagesse.
De nos jours, Jésus est largement perçu comme le bienfaiteur ultime de l’humanité, mais aux débuts du christianisme, les païens voyaient en lui un sauveur faible et peu convaincant. Ils s’interrogeaient : comment ce prétendu Fils de Dieu avait-il pu être suivi par seulement douze disciples, dont l’un l’a trahi, un autre l’a renié, et les autres se sont enfuis au moment crucial ? Pourquoi, si sa naissance était miraculeuse, n’existait-il aucune preuve frappante de sa nature divine pendant son enfance ? On racontait par exemple que l’empereur Auguste, encore bébé, était capable de parler aux grenouilles et de les faire taire. Où étaient les histoires de ce type à propos de Jésus ?
Les évangiles de l’enfance sont probablement nés en réponse à ce genre d’objections. Ils se sont diffusés dans les milieux chrétiens populaires, non pas chez les théologiens reconnus comme Justin Martyr ou Irénée de Lyon, mais dans les cercles de croyants simples, cherchant à rassurer, convaincre, et relier Jésus aux attentes culturelles païennes.
Dans ces récits, Jésus parle depuis son berceau, guérit des malades par simple contact, fait voler des oiseaux d’argile, ou étire du bois par miracle. Il impressionne, il dérange, mais surtout il est remarquable dès le début. Là où Dionysos reste égoïste et destructeur, Jésus progresse vers la sagesse et la compassion. C’est sans doute pourquoi ces récits ont séduit tant de convertis venus du paganisme, qui, tout en découvrant la foi chrétienne, étaient encore marqués par leur imaginaire antique. Ces histoires créaient un pont culturel : elles disaient, en somme, que Jésus aussi avait eu une enfance divine, mais qu’il était bien plus qu’un dieu parmi les autres.
L’influence des évangiles sur l’enfance sur le Catholicisme, le Judaïsme et l’Islam
Les idées développées au IIᵉ siècle autour de l’enfance de Jésus ont été reprises et amplifiées dans ce qu’on appelle aujourd’hui le Protévangile de Jacques, un texte qui raconte non seulement la naissance de Jésus, mais aussi celle de Marie et sa propre enfance. On voit ainsi comment cette tradition prend racine très tôt dans la littérature chrétienne, et comment elle a exercé une influence profonde sur la pensée et la piété de l’Église catholique.
Au fil des siècles, ces récits de l’enfance de Jésus ont marqué le monde antique, donnant naissance à une multitude de versions, de récits et de variantes, si bien que leur influence s’est étendue bien au-delà du christianisme, touchant également le judaïsme dans ses réponses apologétiques, et plus tard l’islam, où plusieurs de ces motifs se retrouvent dans le Coran.
L’influence sur le Catholicisme
Les évangiles de l’enfance, notamment dans les apocryphes comme le Protévangile de Jacques, ont profondément influencé la théologie catholique, la piété populaire et la liturgie. Le Protévangile de Jacques insiste sur la virginité de Marie avant, pendant et après l’accouchement (dogme de la virginitas in partu) ce qui a participé à développer le culte marial. Cela a ouvert la voie à des doctrines comme l’Immaculée Conception et l’Assomption puis à la figure de Marie, Mère de Dieu, un concept central dans la sphère catholique.
Les scènes de la crèche, les fêtes de la Nativité, et même certains éléments de la messe de minuit sont influencés par ces récits enrichis, y compris les éléments tirés des apocryphes. Des traditions comme les trois rois mages, leur nom, leur symbolisme, viennent en grande partie de traditions post-bibliques.
L’art chrétien (peintures, icônes, fresques) foisonne de représentations de la Sainte Famille, souvent inspirées des récits élargis des évangiles de l’enfance. Le rôle de l’enfant Jésus dans les mystères médiévaux ou les cantiques de Noël prolonge cette influence jusqu’à aujourd’hui.
L’influence sur le judaïsme
Les rabbins postérieurs à Jésus ont reconnu son influence charismatique, ses guérisons, sa popularité – mais ont rejeté sa messianité et sa divinité. Ils voulaient ardemment démontré que Jésus n’était pas le messie et le fils de Dieu. Il n’avait, selon eux, pas accompli les prophéties. Toutefois ils reconnaissaient qu’il était versé de connaissances, qu’il était puissant, qu’il avait guéri des gens et que des disciples continuaient de guérir en son nom etc… Comment fallait-il réagir à cela? Il était si dérangeant que des gens soient guéris par Jésus que les juifs ont passé une loi contre cela. Si une personne était malade ou mourante, il fallait qu’elle accepte de mourir et ne cherche pas à se faire guérir au nom de Jésus.
Dans l’évangile de Marc, Jésus est appelé le fils de Marie (Marc 6:3). Dans Jean 9:34, les juifs disent que Jésus est né dans le péché. Les évangiles de l’enfance sont en lien avec ces affirmations. Ils mettent l’emphase sur le fait que c’est par l’action du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Les rabbins se sont opposées à cette idée dans une variété de commentaires et traditions. Dans un ouvrage appelé « Toledoth Yeshu » (Générations de Jésus), un travail littéraire contre le nouveau testament, il est dit que Jésus est né d’une relation hors mariage, que peut-être Marie avait été violée par un soldat romain (nommé Ben Pandera), ou qu’elle avait une relation inconvenante avec un charpentier non identifié. Et Jésus jeune homme serait ensuite allé en Egypte, il était intelligent et brillant, les rabbins reconnaissent cela, il était difficile d’argumenter avec lui, il avait appris à écrire et à prononcer correctement le nom divin, il avait un rouleau de magie et était devenu un magicien, c’est pourquoi il pouvait opérer ses pouvoirs. Tout cela était, selon les traditions juives critiques, enraciné dans son enfance.
Ces traditions sont des réponses à ce que les Évangiles de l’enfance affirmaient: il était habité de l’Esprit, puissant, et difficilement contestable, même enfant. On peut y voir une stratégie de délégitimation du fondement théologique chrétien : si Jésus était né dans le péché, il ne pouvait pas être le Messie.
Les juifs ont proposé ce travail de contre apologétique pour disqualifier Jésus de son rôle messianique. Cela finira par influencer plus tard le chef religieux Mahomet et à déboucher sur une situation conflictuelle à trois entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. C’est un point particulièrement intéressant à discuter car cela nous aide à comprendre la description de Jésus dans le Coran.
L’influence sur l’Islam
Dans la quatrième sourate nous lisons ce passage où la crucifixion de Jésus est niée:
et à cause leur parole: « Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu »… Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié; mais ce n’était qu’un faux semblant! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l’incertitude: ils n’en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l’ont certainement pas tué.
L’affirmation selon laquelle Jésus n’est pas mort sur la croix trouve ses racines dans certaines doctrines gnostiques du IIᵉ siècle, notamment celles enseignées par Basilide d’Alexandrie. Il était un enseignant gnostique actif au début du IIᵉ siècle qui proposait une interprétation particulière de la crucifixion de Jésus. Selon lui, Jésus, en tant qu’être divin, ne pouvait pas souffrir physiquement. Ainsi, il aurait opéré une substitution en transformant Simon de Cyrène pour qu’il prenne son apparence, tandis que Jésus assumait celle de Simon. Les soldats romains auraient alors crucifié Simon, pensant qu’il s’agissait de Jésus, tandis que ce dernier se tenait à proximité, se moquant de leur erreur.
Cette vision docétique, qui suggère que Jésus n’avait qu’une apparence humaine sans véritable corps physique, était répandue parmi certains groupes gnostiques. Ils croyaient que le Christ, en tant qu’entité divine, était incapable de souffrir ou de mourir réellement.
Ces informations proviennent principalement des écrits des Pères de l’Église, notamment Irénée de Lyon (né en 130 après J-C), qui, dans son ouvrage Contre les hérésies, décrit et réfute les enseignements de Basilide (Contre les hérésies, Livre premier, chap. XXIV):
il ne souffrit pas de passion, mais à sa place Simon de Syrène, qu’il rencontra, porta la croix ; et ce serait lui qui aurait été étendu sur cette croix, et transfiguré à tel point par le Christ, qu’on le prit véritablement pour lui. Jésus alors devint Simon, et, debout parmi la foule qui le crucifiait, il se railla d’elle. Vertu incorporelle et éternelle comme son Père, il transforma à son gré son être, et revint à celui qui l’avait envoyé, se riant de ceux qui voulaient le faire souffrir et auxquels il échappait par son invisibilité.
Dans la 19ème sourate il est question de Myriam (Marie), qui semble être confondue avec une autre Myriam, la sœur de Moïse (les musulmans s’en défendent souvent avec l’usage symbolique ou généalogique). Mahomet aimait Jésus, il admirait Marie et voulait la défendre. La conception selon lui s’était bien produite par le Saint-Esprit et Marie était vertueuse et juste, tout comme Jésus.
Le récit de Jésus parlant dans le berceau (Sourate 19) provient clairement des évangiles apocryphes, notamment de l’évangile arabe de l’Enfance qui est lui-même, en plus d’ajout de traditions locales, basé sur le Protévangile de Jacques et le pseudo-Évangile de Thomas. Cela révèle que ces traditions chrétiennes non-canoniques tardives ont été reprises par Mahomet.
Jésus (‘Isa) avait prophétisé depuis le berceau selon le Coran (chapitre 19:29-34).
Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent : « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? « Mais [le bébé] dit : « Je suis vraiment le serviteur d’Allah. Il m’a donné le Livre et m’a désigné Prophète. Où que je sois, Il m’a rendu béni; et Il m’a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la Zakat ; et la bonté envers ma mère. Il ne m’a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant ». Tel est Issa (Jésus), fils de Marie : parole de vérité, dont ils doutent.
Où Mahomet a-t-il récupéré ces informations de Jésus prophétisant dans le berceau? Nous le savons maintenant, il l’a reçu de la tradition des évangiles de l’enfance. Dans l’évangile arabe de l’Enfance, on lit au chapitre 1:
Nous avons trouvé (ceci) dans le livre de Josèphe, le grand prêtre qui existait tu temps du Christ, – d’aucuns ont dit que c’était Caïphe – il affirme donc que Jésus parla, étant au berceau, et qu’il dit à sa mère : « Je suis Jésus, le fils de Dieu, le Verbe, que vous avez enfanté, comme vous l’avait annoncé l’ange Gabriel, et mon Père m’a envoyé pour sauver le monde. »
Idem pour la formation de moineaux d’argile. Dans le Coran (Sourate 3, verset 49) on lit :
« Et [Jésus] sera le messager aux enfants d’Israël [et il leur dira] :
‘Je crée pour vous de l’argile comme une forme d’oiseau, puis je souffle dedans, et cela devient un oiseau par la permission d’Allah.
Je guéris l’aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d’Allah…‘ »
Sourate 5, verset 110:
« Rappelle-toi, quand Allah dira :
‘Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand Je t’ai soutenu par l’Esprit Saint…
Tu façonnais de l’argile comme une forme d’oiseau, avec Ma permission, et tu soufflais dedans, et cela devenait un oiseau, avec Ma permission…«
Dans l’évangile de l’enfance selon Thomas on lit:
Alors qu’il était un enfant âgé de cinq ans, Jésus était en train de jouer près du gué d’un ruisseau, et il faisait couler de l’eau, la dirigeant vers une flaque, afin de la rendre claire. Ensuite, il tira de la vase de l’argile molle en en façonna douze oiseaux. C’était alors le jour du sabbat et beaucoup d’enfants jouaient avec lui. Un Juif le vit en train de faire cela avec les enfants, et il alla vers Joseph son père et accusa Jésus en disant : « Il a fait de la boue et il en a façonné des oiseaux le jour du sabbat où il n’est pas permis de le faire. » Et Joseph, étant arrivé, le réprimanda en disant : « Pourquoi fais-tu un jour de sabbat ce qu’il n’est pas permis de faire? » Mais, l’ayant entendu, Jésus frappa des mains et fit s’envoler les passereaux en disant : « Allez, volez et souvenez-vous de moi, vous qui êtes vivants. » Et les passereaux s’envolèrent en poussant des cris. Ayant vu cela, le pharisien en fut étonné et alla le raconter à ses amis.
Ce miracle témoigne d’un contact direct ou indirect avec la tradition chrétienne apocryphe orientale, en particulier syriaque ou copte.
Mahomet, furieux, a répondu aux critiques juives de manière très agressive. Cela nous permet de comprendre l’antisémitisme qu’on peut observer dans le monde islamique. Mahomet ne tolérait pas les critiques rabbiniques dégradantes sur Jésus et Marie. Il n’acceptait pas qu’on puisse accuser Marie d’adultère où dire que Jésus faisait de la magie noire ou quelque chose dans le genre.
Dans la quatrième sourate, il est basiquement dit que les juifs sont des menteurs, ils pensent avoir crucifié Jésus mais en fait il n’en est rien. Cela explique la tradition selon laquelle Jésus n’est pas mort sur la croix, il a été enlevé au ciel par Dieu. C’est une vieille hérésie qui remonte au 2ème siècle, crédité à Basilide qui disait que c’était Simon de Cyrène qui avait été crucifié parce que Jésus avait changé son visage avec celui de Simon. Ainsi les romains avaient crucifié Simon plutôt que Jésus. Cette tradition s’est ensuite, quelques siècles plus tard, retrouvée dans le Coran.
Conclusion
En étudiant ces traditions extra canoniques, elles nous semblent étranges aujourd’hui, mais elles ont une force explicative étonnante. On comprend ce qu’il s’est passé dans ces siècles qui ont suivi l’avènement du christianisme et comment certains des éléments des évangiles de l’enfance se retrouvent dans le Coran aujourd’hui.
Il est fascinant de retracer comment ces récits sur l’enfance de Jésus sont nés dans des cercles chrétiens cherchant à défendre la foi face aux critiques païennes, avant d’être repris, transformés ou contestés par les rabbins, puis intégrés, sous une autre forme, dans le Coran à travers les paroles de Mahomet. Ces enchaînements historiques révèlent des connexions remarquables entre les trois traditions.
Il est important pour les chrétiens d’apprendre l’existence et l’origine de ces documents, pourquoi ils ne font pas partie du nouveau testament mais pourquoi ils ont une importance historique significative.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!