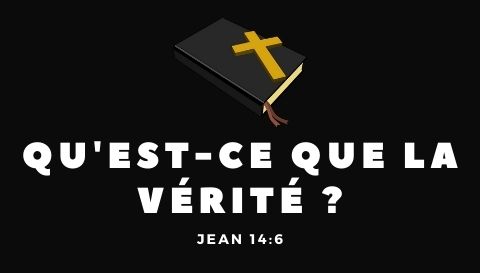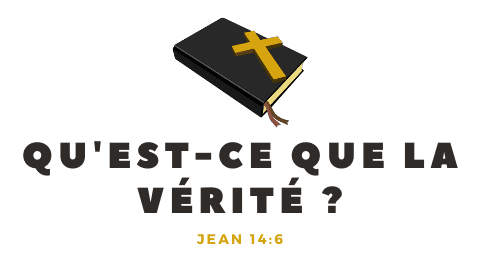La Bible face aux religions orientales (Hindouisme, Bouddhisme et autres)
Dans cet article je vais essayer de comparer la Bible avec les livres religieux orientaux. Nous traiteront de l’Hindouisme et du Bouddhisme prioritairement. Je parlerais un peu du Sikkhisme1 et du Jaïnisme2 mais pas du shintoïsme3 ou du confucianisme4 car le travail de recherche a été fastidieux et l’Hindouisme et le Bouddhisme sont très répandus en Asie. Le Bouddhisme de plus fascine certains occidentaux.
La culture religieuse orientale est très riche. Elle est encore en partie inaccessible pour les occidentaux car beaucoup de textes ne sont pas traduits. Nous avons à faire dans ces religions, à des textes parfois plus longs que la Bible.
Comme les chrétiens sont amenés à rencontrer sur leur chemin des bouddhistes, des hindouistes et autres, il peut être intéressant dans la conversation d’avoir quelques connaissances, pour ne pas rejeter ou relativiser la religion de l’autre sans la connaître un minimum.
Hindouisme
Les Védas sont un corpus de textes religieux en sanskrit védique, transmis oralement pendant des siècles avant d’être mis par écrit. Ils sont considérés comme « ce qui a été entendu », c’est-à-dire révélé aux sages , non inventé par des humains. C’est le fondement du brahmanisme (forme ancienne de l’hindouisme), et donc de toute la tradition hindoue.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
Ils ont longtemps été réservés aux brahmanes (classe sacerdotale) et ont été transmis oralement avec une précision extrême (intonation, rythme…). Aujourd’hui encore, les Védas sont récités dans les temples et appris par cœur dans des écoles védiques. Tous les hindous ne les lisent pas, mais ils les reconnaissent comme source suprême de l’autorité spirituelle.
L’hindouisme n’a pas de fondateur unique ni de texte unique, il dispose toutefois de plusieurs corpus fondamentaux:
- Les Védas (1500–500 av. J.-C.) comme le Rig-Véda qui sont des textes en sanskrit védiques, composés de mantras, hymnes, rituels.
- Les Upanishads qui sont des philosophies métaphysiques associées aux Védas.
- Les Épopées qui sont des textes très longs dont le Mahabharata5 qui inclut la Bhagavad-Gita6.
- Les Puranas qui sont souvent encyclopédiques (mythologie, cosmologie, dévotion).
Bouddhisme
Les textes canoniques du bouddhisme sont en pali, sanskrit, tibétain ou chinois. Il y a l’école du Bouddhisme Theravāda7 dont le texte est plus long que la Bible. Il y a également le Bouddhisme Mahāyāna avec les Soutra du Lotus8, Soutra du Cœur, Soutra de la perfection de la sagesse, etc.
Les livres orientaux ne sont pas encore complètement traduits
Beaucoup de textes hindouistes et bouddhistes ne sont pas traduits en français et parfois même en anglais. Cela est dû au volume considérable et monumentale. Il y a peu de spécialistes pour les traduire entièrement. Une autre raison est que ces textes utilisent des langues anciennes et spécialisées difficiles à traduire. Il faut souvent interpréter autant que traduire, ce qui exige un haut niveau de compétence interdisciplinaire. Il n’y a également aucun canon centralisé.
Il n’y a pas de “Bible” hindoue au sens de Bible judéo-chrétienne. Les textes sacrés sont multiples, variés, parfois contradictoires, et aucun n’est indispensable à tous les hindous. Le bouddhisme Mahāyāna a produit des centaines de soutras, souvent propres à chaque tradition locale (Chine, Tibet, Japon…). Il n’y a donc pas de pas de liste “officielle” de textes à traduire en priorité, comme le canon biblique ou coranique.
Le manque de traduction tient également dans la vision religieuse différente de la transmission de ce que l’on connaît avec la Bible (témoignage oculaire rapporté par écrit rapidement après les faits, copie rigoureuse par des scribes…).
Les hindous et bouddhistes ont une tradition orale très forte avec beaucoup de récitation, d’écoute, d’apprentissage par cœur. La récitation est un acte sacré, le sens profond est souvent transmis par un maître, pas par la lecture autonome. Certains textes sont ésotériques ou initiatiques, réservés à certains contextes rituels ou castes. L’idée que “tout doit être traduit pour tous” n’est pas universelle. Divers projets de traduction sont toutefois en cours.
Cela contraste avec la Bible, qui depuis la Tour de Babel a cet ADN universel concernant les langues. La mission chrétienne universelle nécessite également la traduction en de multiples langues, c’est un devoir qui a occupé la vie de nombreux missionnaires et biblistes. La première traduction du pentateuque a été réalisée très tôt, au 3ème siècle avant notre ère, en grec.
La répartition de l’Hindouisme et du Bouddhisme dans le monde
Hindouisme
| Pays | Situation |
|---|---|
| Inde | Majoritaire (~80 % de la population) – cœur historique |
| Népal | Majoritaire (~80 %) |
| Île de Bali (Indonésie) | Localement majoritaire (hindouisme balinais) |
| Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka | Minoritaire mais ancienne présence |
| Maurice, Fidji, Trinidad, Guyana | Diaspora hindoue importante |
Il y a environ 1,2 milliard d’hindous dans le monde. Ils sont principalement en Asie du Sud. L’hindouisme est la 3e religion mondiale, bien qu’elle soit géographiquement très concentré.
Bouddhisme
| Région | Pays majoritairement bouddhistes |
|---|---|
| Asie du Sud-Est | Thaïlande, Cambodge, Birmanie, Laos |
| Asie de l’Est | Mongolie, Bhoutan, Japon (syncrétique), Tibet (région autonome de Chine) |
| Himalaya | Bhoutan, Népal (mix hindou/bouddhiste) |
| Chine, Corée, Vietnam | Présence massive mais coexistence avec d’autres traditions |
| Sri Lanka | Dans la version Theravāda |
Il y a environ 500 à 600 millions de bouddhistes dans le monde. Le bouddhisme est la religion majoritaire dans au moins 10 pays asiatiques.
À noter que le christianisme et l’islam sont également bien implantés en Asie (sous différents status et « niveaux de liberté »), notamment dans les pays suivants:
- Philippines, Timor oriental, Corée du Sud, la Chine et d’autres (chrétiens)
- Indonésie, Pakistan, Bangladesh, Malaisie (musulmans)
Comment les livres religieux orientaux se comparent avec la Bible?
Il n’y a pas vraiment de Bible unique dans ces religions orientales, mais la Bhagavad-Gītā (Hindouisme), le Guru Granth Sahib (Sikkhisme), et les Puranas (Hindouisme) remplissent certains rôles comparables dans leurs traditions respectives.
Dans la forme, le livre du Sikkhisme est comparable à la Bible. C’est un recueil sacré structuré qui est lu comme autorité spirituelle. Il s’agit d’un unique texte canonique, comme la Parole vivante de Dieu (comme la Bible l’est dans le christianisme). Il est vénéré dans un sanctuaire comme un livre vivant, un peu comme le rôle de la Bible dans la liturgie chrétienne. C’est une religion récente qui n’a qu’un demi-millénaire d’âge.
La Bhagavad-Gītā (hindouisme) a un rôle comparable aux Évangiles. Il s’agit d’un dialogue entre Krishna (avatar divin) et Arjuna (homme en crise morale). Il enseigne le salut, la foi, le renoncement, le devoir, la dévotion et appelle à la conversion intérieure, comme le message du Christ. Il a une influence immense dans toute l’Inde, toutes castes confondues.
Les Puranas (hindouisme) contiennent des récits de création, lois morales, histoires de dieux et d’hommes, parfois comme la Genèse ou les récits des Rois. Ils ont une structure en livres, avec histoires et enseignements et proches de l’Ancien Testament dans l’esprit.
Le Dhammapada (bouddhisme Theravāda) est semblable aux Proverbes ou aux Béatitudes dans la Bible avec des brèves maximes du Bouddha. Il appelle à l’éveil, la discipline et la compassion. Il est davantage lu comme un guide éthique et spirituel simple et profond.
Tous ces textes religieux ne sont pas nécessairement perçus comme la « Parole de Dieu » au sens strictement monothéiste ou abrahamique. Dans le Bouddhisme il n’y a pas de Dieu créateur et donc pas de « Parole de Dieu ». Les textes sont les enseignements du Bouddha qui ont été transmis par ses disciples. Ils sont perçus comme une sagesse humaine suprême mais pas dictée par un être suprême. Pour les Védas, on dit que les sages et voyants inspirés des temps anciens n’ont pas « écrit » les Védas, mais ils les ont « perçus » ou « captés » dans une forme de conscience profonde, parfois décrite comme une intuition cosmique ou mystique. Ce n’est pas une révélation comme la parole de Dieu dictée à un prophète, mais plutôt l’accès direct à une vérité éternelle, inhérente à l’univers.
Les Védas sont la plus haute source d’autorité spirituelle dans l’hindouisme traditionnel. Certains les considèrent comme la résonance du cosmos même, presque comme une vibration primordiale captée en état de méditation. Dans un cadre chrétien, cela n’est pas très rassurant, les manifestations surnaturelles et les inspirations de ce genre sont souvent rattachées au diable et aux démons.
Les Bhagavad-Gītā, Mahābhārata, et Puranas sont des textes très importants dans l’hindouisme mais leur statut n’est pas le même que celui des Védas. Ils sont considérés comme « ce dont on se souvient ». Il s’agit de textes composés par des humains inspirés, transmis par tradition, et adaptés à des contextes historiques et sociaux particuliers. Leur popularité est immense, parfois bien supérieure à celle des Védas dans la pratique religieuse quotidienne. On se rapproche ici un peu plus du mode biblique: des humains inspirés écrivent.
La critique textuelle et l’archéologie
La Bible a été soumise à une critique textuelle rigoureuse, à des comparaisons de manuscrits anciens, et bénéficie de preuves archéologiques abondantes, notamment grâce aux manuscrits de la mer Morte, aux codex grecs et latins, aux inscriptions anciennes, etc. Mais en ce qui concerne les textes religieux indiens, la situation est très différente, à la fois historiquement, matériellement et culturellement.
Les Védas ont été transmis exclusivement à l’orale pendant des siècles, avec une extrême rigueur (intonation, rythme, accent). Les manuscrits sont très tardifs (la majorité date du 12ème siècle au 18ème siècle), bien que les textes soient beaucoup plus anciens. La critique textuelle a été pratiquée par des philologues européens et indiens dès le 19ème siècle, mais les variantes sont peu nombreuses grâce à la rigueur orale. Il n’y a aucune trace matérielle directe du contenu védique. Les Védas sont antérieurs à l’écriture indienne classique.
Les textes comme Mahābhārata, Rāmāyaṇa, Puranas ont été transmis de manière manuscrite (feuilles de palme), avec de nombreuses variantes. Il n’y a pas de version unique ni canonisée. La critique textuelle est très complexe; les textes ont été enrichis au fil des siècles, avec des ajouts, interpolations et versions régionales. En archéologie il est difficile d’identifier des éléments directs ; on trouve parfois des influences culturelles, mais pas de validation historique précise des récits.
Le Bouddhisme (Canon pali Theravāda) a été transmis oralement pendant environ 400 ans, puis mis par écrit au Sri Lanka vers le 1er siècle av. J.-C. Il y a des manuscrits anciens disponibles, notamment en birman et cinghalais. La critique textuelle est assez avancée (notamment en Occident), il y a eu des comparaisons entre versions en pāli, sanskrit, tibétain, chinois. En archéologie il y a quelques soutiens indirects (ex. : inscriptions d’Ashoka au 3ème siècle av. J.-C. mentionnant le Bouddha et le Dharma), mais peu de confirmation textuelle directe.
Les textes hindous et bouddhistes ont une tradition fluide, orientée vers l’oralité, et peu soucieuse de préserver un texte identique dans le temps. Leur autorité vient plus de la sagesse transmise que de l’exactitude textuelle.
Loin de moi l’idée d’affirmer que ces textes ont été mal préservés, j’aurais tendance à penser qu’ils l’ont été mais nous percevons ici une nette différence avec la Bible hébraïque où Dieu avait demandé à Moïse de mettre par écrit ce qu’il lui disait. Le principe biblique est le témoignage oculaire rapporté peu après les événement et la copie rigoureuse par la suite. Notons que dans certains cas, comme les écrits de sagesse, il n’y a pas la même nécessité de situer dans le temps les paroles.
Nous avons l’exemple des traditions du déluge à travers maintes cultures dans le monde. Elles ont mal préservé l’événement, bien qu’on puisse retrouver un noyau commun. La tradition orale a cette tendance a déformé et folklorisé les contenus au fil des siècles. On revoit ça plus bas.
Ces livres orientaux ont-ils une vocation universelle?
L’hindouisme est une tradition ethno-religieuse, enracinée dans la culture indienne, sans fondateur unique ni mission universelle. Les Védas, par exemple, s’adressent aux brahmanes, et non à toute l’humanité. La Bhagavad-Gītā a une portée plus large, mais elle est surtout un modèle spirituel adaptable, pas une religion à imposer.
Le Bouddha a enseigné pour tous les êtres sensibles, indépendamment de leur caste, origine ou croyance. Le Dharma est universel et non théiste: toute personne peut suivre le chemin vers l’éveil sans conversion ni dogme. Le bouddhisme s’est répandu activement en Asie, par choix non violent et sous forme de dialogue.
Le bouddhisme moderne (notamment zen, theravāda, tibétain) attire souvent un public occidental sans exiger une adhésion religieuse stricte. Le bouddhisme est le plus universel dans sa vocation pratique.
Nous sommes tout de même loin de l’action missionnaire chrétienne universelle et du besoin d’amener les âmes du monde entier au salut en Christ. Les messages orientaux semblent être recentrés sur les individus et leur capacité à agir selon une forme de code morale ou à se libérer du cycle des réincarnations, sans reconnaissance de leurs faiblesses inhérentes qui nécessite de faire appel au Créateur.
La création dans l’Hindouisme et le Bouddhisme
Dans le Rig-Véda (Hindouisme), l’Hymne de la Création (Nasadiya Sūkta, 10.129) est un des textes les plus anciens sur la création. Il a une tonalité mystique et agnostique. Une citation célèbre est la suivante:
« Qui sait vraiment ? Qui pourrait ici le dire ? D’où est né ce monde, d’où vient la création ? Les dieux sont venus après la création… Peut-être même celui qui regarde d’en haut ne le sait pas. »
L’origine du le Rig-Véda monde est mystérieuse, il n’est pas sûr qu’on puisse la connaître.
Dans les Upanishads (ex: Chāndogya Upanishad 6.2.1) on lit:
« Au commencement, il y avait l’Être (sat) seul, un sans second. »
Le monde émane du Brahman (réalité absolue), l’univers est une manifestation de cette essence unique, sans créateur personnel.
Les Puranas proposent des mythes cosmogoniques très développés. Voici un exemple:
« Vishnu se repose sur l’océan cosmique, un lotus sort de son nombril, et Brahmā naît pour créer le monde.«
La création est souvent cyclique: l’univers est créé, maintenu, puis détruit et recréé (idée de kalpa).
Le Bouddha n’a pas insisté sur une création unique. L’univers est considéré comme sans commencement et soumis à des cycles d’expansion et de destruction (saṃsāra). Le soutra Agganna (Dīgha Nikāya 27) décrit symboliquement une évolution morale et cosmique de l’univers, plus que sa création physique.
Dans plusieurs suttas, notamment le Cūḷa-Māluṅkya Sutta, un moine demande au Bouddha:
Pour lire la suite de l’article veuillez vous inscrire ou vous connecter si vous avez déjà un compte:
- Le sikhisme est une religion née en Inde au 15ème siècle de notre ère, elle est relativement jeune par rapport aux autres traditions indiennes mais elle est extrêmement riche. De manière intéressante, le Sikkishime défend un monothéisme radical où Dieu est un, unique, sans forme, éternel, immanent et transcendant. Cette religion a été fondée en réaction aux divisions entre hindous et musulmans, rejet des castes, des rituels vides, et du dogmatisme.
- Il y a des similitudes entre Bouddhisme et Jaïnisme (par exemple elles sont non théistes) mais également des différences majeures. Le jaïnisme est un chemin de purification totale de l’âme, par non-violence absolue, discipline rigoureuse et connaissance. Le bouddhisme est un chemin de sagesse qui mène à l’extinction de l’ego, par la compréhension, la méditation, et une voie équilibrée.
- pour lequel il n’y a pas de dogme universel, la croyance est souple et adaptée localement. Il n’y a pas de quête de salut, pas de morale universelle comme les dix commandements. Le shintoïsme est fortement rituel, symbolique, et imbriqué dans la culture japonaise. Il coexiste sans problème avec le bouddhisme au Japon (syncrétisme).
- Le confucianisme n’est pas une religion au départ mais une philosophie sociale et éthique. Il n’y a pas d’esprits ou de divinités.
- immense récit épique, traite du dharma, de la guerre, de la société.
- Il s’agit d’un texte philosophique majeur qui introduit les notions de Brahman (absolu) et ātman (âme), fondamentaux du Vedānta.
- Dans ce Bouddhisme Theravāda, le Dhammapada est un recueil de vers attribués au Bouddha.
- qui enseigne la voie unique du Bouddha et dont l’influence est majeure en Asie de l’Est.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!