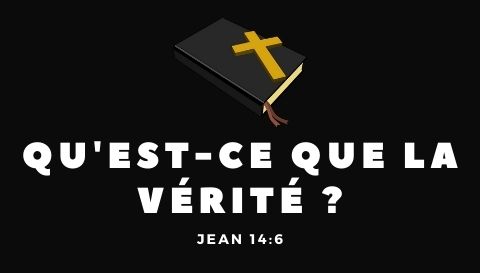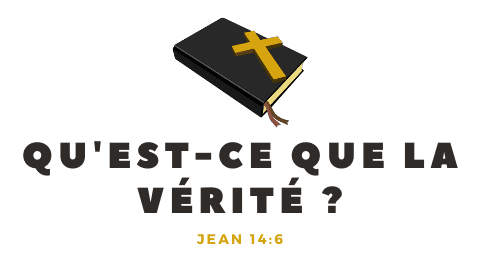Jésus a-t-il voulu un Pape? Réponse à la chaîne « Le catho de service »
Dans cet article je réponds à la vidéo « Jésus voulait-il un pape ? La hiérarchie de l’Église dans la Bible » dans laquelle « Le catho de service » défend la position de l’église catholique sur la papauté. Il le fait de manière assez remarquable avec une vidéo bien rythmée et bien construite. Je vais essayer de répondre fraternellement, de manière non confessionnelle, en faisant appel aux textes bibliques et aux commentaires chrétiens des premiers siècles du christianisme. Une étude globale des textes bibliques et des « Pères de l’église » dégage nettement l’idée d’une structure ecclésiale, horizontale, sans pape et primauté de Rome. Il va falloir contextualiser et apporter des sources parallèles pour avoir un plus large aperçu que ce qui est présenté dans la vidéo de CDS (Le catho de service).
J’avais écris trois articles sur le sujet qui sont complémentaires aux discussions que je vais présenter ici:
- Les Papes et les Cardinaux à la Lumière du Texte Biblique
- L’Apôtre Pierre a t-il été le premier Pape?
- De la collégialité des Evêques à la Papauté Impériale
Il est important de se comporter fraternellement, comme les apôtres et les Pères de l’église l’ont justement démontré dans la structure de l’église des premiers siècles. Je pense que CDS est bien intentionné et convaincu mais qu’il lui manque une approche plus maîtrisée du sujet. En tant qu’étudiant de la Bible, nous devons laisser la Bible nous imprégner et pas l’inverse.
Je remercie Thierry, un lecteur du site, pour avoir porté à mon attention la vidéo de CDS.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
- Matthieu 16 : 18-19 (…et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise…)
- Les Pères Apostoliques
- Infaillible ou faillible?
- Autres points de la vidéo
- Le titre Saint-Père
- L’horizontalité de l’église primitive
- La lettre aux Smyrniotes d’Ignace d’Antioche
- Le souverain pontife
- Apprécier le contexte de l’époque
- Le renvoi des presbytres par les corinthiens et Clément de Rome
- L’église catholique romaine est-elle la continuité directe de l’église fondée Jésus-Christ?
- Les désaccords entre protestants
- Et les dissensions chez les catholiques?
- Conclusion
Matthieu 16 : 18-19 (…et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise…)
« Et moi, je te déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux : tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. »
Le meilleur appui scripturaire pour la papauté serait ce verset de Matthieu 16 dans lequel Jésus affirme qu’il bâti son église sur Pierre et qu’il lui donne les clés du royaume des cieux. A première vue, la logique catholique est imparable. Pierre reçoit un statut de « chef » très particulier, qu’aucun autre ne reçoit. Mais c’est ignoré les autres interprétations de ce verset, largement majoritaires chez les Pères de l’église des premiers siècles.
Nous avions dans un article précédent, sur la notion de papauté associée à Pierre, déjà établi que ce dernier se présentait de la manière suivante dans le Nouveau Testament « moi ancien comme eux » (1 Pierre 5:1) et qu’il ne ressort jamais d’un texte canonique, que par exemple, Paul était soumis à Pierre. En fait Paul a publiquement réprimandé Pierre dans Galates 2:11-14. Les croyants sont naturellement « faillibles » et sont appelés à être rappelés à l’ordre de temps à autre. C’est tout à fait normal.
Il n’y a pas de logique « successorale » dans Matthieu 16, et il n’y a aucune logique tout court à ce que Pierre transmette un héritage quelconque à qui que ce soit. Ce qui compte c’est la fidélité à Dieu et à sa Parole. D’une roche Dieu peut susciter des descendants à Abraham et dans l’Ancien Testament, la descendance de Salomon a été dépourvue du Messie promis (qui est finalement venu de la lignée d’un autre fils de David: Nathan). On ne s’attend pas à ce que Pierre transmettre une autorité. Il était prévisible qu’un successeur puisse fauter, c’est pourquoi il n’y a rien de tel. Les choses fonctionnaient différemment, en partie avec le principe collégial qui permettait la correction, plus difficile dans un système pyramidal. Mais passons.
Il est intéressant de noter que c’est à partir de Léon Ier (pape, 440-461) que Matthieu 16:18-19 devient officiellement une base théologique de la primauté du pape, non seulement comme successeur de Pierre, mais comme chef suprême de l’Église universelle. Léon le Grand a joué un rôle déterminant en affirmant que le pouvoir donné à Pierre avait été transmis à ses successeurs, c’est-à-dire aux évêques de Rome. Il a utilisé Matthieu 16:18-19 comme fondement de cette autorité et a développé la doctrine du « vicariat de Pierre » (le pape est le vicaire de Pierre sur terre). On ne parlait pas encore du Pape comme « Vicaire du Christ » à ce moment là.
L’expression « Vicarius Christi » est apparue ensuite chez Innocent III (pape de 1198 à 1216), dans un sens de représentation directe du Christ sur terre. Elle a été utilisée plus fréquemment à partir du XIIIe siècle, notamment par Boniface VIII (1294–1303), qui affirme dans Unam Sanctam (1302) que le Pontife romain juge toutes choses, mais ne peut être jugé par personne… car il est le vicaire de Dieu.
Bien plus tard, Vatican I (1870) a proclamé:
« Si quelqu’un donc dit que le bienheureux Apôtre Pierre n’a pas été établi par le Christ notre Seigneur chef de tous les Apôtres et tête visible de toute l’Église militante ; ou que ce même Apôtre n’a reçu directement et immédiatement du Christ notre Seigneur qu’une primauté d’honneur et non une primauté de juridiction véritable et proprement dite, qu’il soit anathème. »
Ainsi nous observons une lente dérive dans la théologie catholique au fil des siècles et millénaires. L’église catholique des premiers siècles était effectivement la bonne, mais le débat est clairement ouvert, à savoir si l’église catholique romaine moderne correspond toujours fidèlement à cette église d’origine. L’héritage n’est pas une notion néotestamentaire: nous sommes de la postérité d’Abraham sans lui être relié généalogiquement. Les chrétiens sont greffés à l’olivier de Juda. L’appartenance au Seigneur ne dépend pas de nos prédécesseurs mais de notre foi. Les pharisiens ont été rejetés malgré leur lien naturel légitime avec Abraham.
Les titres: chef et tête
Notons les titres du Pape dans Vatican I: le chef et la tête. Pourtant le Nouveau Testament nous donne une autre identité sur celui qui est censé être le chef de l’église:
Éphésiens 1:22-23
« Le Christ est le chef de l’Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. »
Matthieu 23:10
« Ne vous faites pas appeler chefs : car un seul est votre chef, le Christ. »
Et pour la notion de « tête »:
« Il est la tête du corps, de l’Église ; il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. »
Les mêmes tensions existent pour les titres de « Saint-Père » (réservé au Père Céleste » et de « Vicaire du Christ » (réservé au Saint-Esprit). Je vous invite à lire les articles sur la papauté pour plus de détails.
Les responsables catholiques savent justifier l’utilisation de ces titres réservés au divin selon Jésus, mais pourtant utilisés pour les prêtres, évêques, cardinaux et papes. Cela m’apparaît davantage comme une tentative de rationalisation qu’une démarche biblique sincère. Par exemple ils diront que nous appelons notre père biologique « père » et donc qu’on peut utiliser le mot « père » pour quelqu’un d’autre que le Père de Jésus, mais cela n’a rien à voir avec la déclaration de Jésus qui rejetait qu’on utilise le mot « Père » comme un titre (on en reparle plus bas).
Augustin d’Hippone (430), notamment mentionné dans la vidéo de CDS, dans plusieurs écrits, identifie le Christ comme la pierre, en lien avec 1 Corinthiens 10:4 : « La pierre, c’était le Christ ». Augustin a varié dans ses interprétations, mais dans sa position finale (qui n’est pas mentionnée dans la vidéo), il écrit les 4 passages suivants:
1.« Ce n’est pas l’homme Pierre qui est la pierre, mais le Christ. » (Retractationes, I, 21)
Le fondement serait le Christ confessé, non Pierre en tant qu’individu. Augustin reconnaît qu’il a d’abord affirmé que Pierre était la pierre sur laquelle Jésus a fondé l’Église, comme le croyaient aussi certains Pères latins comme Ambroise (que nous allons toutefois nuancer). Il cite ici un hymne liturgique d’Ambroise, dans lequel Pierre est appelé « pierre de l’Église ». Cela montre que cette idée existait dans la tradition de l’Église latine. Dans cette perspective, Pierre représente symboliquement l’Église tout entière, et non une autorité individuelle. L’Église repose sur cette foi commune, pas sur une seule personne humaine. Pierre tire son nom (« Pierre ») de la pierre véritable, c’est-à-dire le Christ confessé.
2.« Il ne lui a pas été dit en effet : « Tu es la pierre (petra) », mais : « Tu es Pierre (Petrus) ». » (Jeu de mots en grec et en latin):
- Petra (la pierre, au féminin) est le Christ ou sa confession.
- Petrus (Pierre, au masculin) est le disciple qui confesse cette vérité.
- Augustin souligne la distinction grammaticale et théologique: Pierre reçoit son nom de la pierre, il n’est pas la pierre en soi.
3.« Car la pierre était le Christ ; et Simon, l’ayant confessé comme toute l’Église le confesse, a été nommé Pierre.»
Le fondement de l’Église, selon cette lecture, c’est le Christ confessé, et non la personne de Simon. Toute l’Église devient « Pierre » lorsqu’elle confesse cette vérité.
4.« Que le lecteur choisisse de ces deux interprétations celle qui lui semblera la plus probable. »
Augustin termine avec un grand respect de la liberté du lecteur: il ne tranche pas autoritairement, mais propose deux lectures et invite à la réflexion. Nous voyons trop peu de chrétiens avoir cette ouverture à la discussion aujourd’hui. Trop revendique le Saint-Esprit et attribue à l’autre « Satan ». On ne va pas croître dans la vérité du Christ de cette manière. Je le dis alors même que je critique Augustin pour d’autres sujets précis sur ce site.
Cyprien de Carthage
La position de Cyprien de Carthage (258) sur Matthieu 16:18-19 est tout aussi centrale pour comprendre l’évolution de la doctrine de la primauté de Pierre et de l’unité de l’Église au IIIe siècle. Cyprien était évêque de Carthage (Afrique du Nord) au IIIe siècle et l’un des pères latins les plus influents de son époque. C’était aussi un théologien de l’unité ecclésiale dans un contexte de persécutions et de schismes. Il n’était pas en communion constante avec Rome, il s’est opposé au pape Étienne sur des questions ecclésiologiques.
Cyprien enseignait que le baptême administré par des hérétiques était invalide. Étienne, au contraire, affirmait la validité de tout baptême conforme à la formule trinitaire, même en dehors de l’Église. Il a déclaré sur Matthieu 16:18-19:
« Le Seigneur dit à Pierre : « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (…). Il édifie l’unité sur un seul. Et bien que, après sa résurrection, Il confère un pouvoir égal à tous les apôtres (…), cependant, pour manifester l’unité, Il a établi une source unique de cette unité par son autorité. »
(De Unitate Ecclesiae, §4-5)
Cyprien voyait en Pierre le représentant de l’unité apostolique et non un supérieur juridique sur les autres apôtres. Pierre symbolisait l’unité de l’Église, en tant que figure fondatrice: Jésus avait commencé avec un seul homme (Pierre) mais avait conféré ensuite le même pouvoir à tous les apôtres (cf. Jean 20:21-23).
Jean 20:21-23
« Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua : Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes ; et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. »
Cyprien insistait sur le fait que « Tous les apôtres furent égaux entre eux, et tous reçurent les mêmes pouvoirs. » Il voyait donc Pierre comme un type (une figure) et non comme un supérieur hiérarchique. Cela contredisait clairement dans son esprit l’idée d’une primauté de juridiction exclusive de l’évêque de Rome.
Pour Cyprien, chaque évêque était successeur des apôtres, pas seulement le pape. L’unité de l’Église était assurée par la collégialité des évêques, non par un pouvoir centralisé. Il utilisait l’image de la « chaire de Pierre » non pour désigner Rome exclusivement, mais pour désigner l’unité de l’épiscopat dans toute l’Église. Il y avait une organisation « horizontale » et non « verticale » pour répondre à CDS qui semble penser qu’il est absolument nécessaire d’avoir la structure actuelle de l’église catholique pour assurer la pérennité et l’efficacité de l’église.
Le pouvoir donné à Pierre est étendu à tous les apôtres
La seule verticalité de l’église, c’est d’avoir Jésus pour chef. L’église des premiers siècles était en définition collégiale, les décisions n’étaient pas imposées par une personne ayant plus d’autorité qu’une autre. On peut voir l’exemple d’Actes 15 avec le Concile de Jérusalem où les apôtres se sont réunis ensemble pour décider de la question des païens. Ce modèle horizontal produisait une église « solidement organisée ». CDS semble penser que seul un modèle pyramidal permet une organisation de qualité mais nous avons la preuve que l’église n’avait pas de structure pyramidale au début. Les grandes décisions étaient tranchées « collégialement ».
Jean 20:21-23 montre que le pouvoir donné à Pierre en Matthieu 16:18-19 n’est pas exclusif à lui, mais est étendu à tous les apôtres.
Matthieu 16:18-19 (adressé à Pierre seul):
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église… Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
Jean 20:21-23 (adressé à tous les disciples/apôtres) :
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. […] Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
Ici, le même pouvoir de lier/délier, ou remettre/retirer les péchés, est explicitement conféré à tous (ils ont donc tous les clefs qui permettent de faire cela). Nous pourrions également rajouter Matthieu 18:18.
Matthieu 18:18 (adressé à tous les disciples/apôtres)
« Vraiment, je vous l’assure : tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. »
Ce triptyque (Matthieu 16, Matthieu 18, Jean 20) montre que l’autorité donnée à Pierre n’était pas personnelle, mais représentative et étendue à tous (au moins à tous les apôtres).
Voici les positions des différentes traditions chrétiennes sur Matthieu 16:
| Tradition | Interprétation |
|---|---|
| Catholique | Pierre a recu un rôle spécial comme « chef du collège apostolique », mais les autres ont aussi reçu ce pouvoir par participation. |
| Orthodoxe | Tous les apôtres ont reçu le même pouvoir ; Pierre est primus inter pares (premier parmi égaux), sans juridiction universelle. |
| Protestante | Jésus a donné à tous les croyants/apôtres l’autorité spirituelle ; Matthieu 16:18 concerne la confession de foi ou Jésus lui-même, pas une primauté personnelle. |
Je pense qu’il y a de bonnes raisons de penser que la position protestante est la bonne.
Tous les croyants sont « prêtres »
1 Pierre 2:5, 9 – Le sacerdoce universel
« Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce […] »
« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis… »
Tous les croyants du Nouveau Testament, aussi surprenant que cela puisse être, sont appelés à être « prêtre », pas dans un sens cultuel lévitique, mais spirituel, à offrir des sacrifices spirituels (adoration, prière, obéissance) et à proclamer l’Évangile, rôle autrefois réservé aux prophètes, prêtres ou apôtres.
Apocalypse 1:6 ; 5:10
« Il a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. »
« Tu as fait d’eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu… »
L’œuvre du Christ aboutit à ce que tous les rachetés deviennent :
- Médiateurs spirituels dans leur rôle de témoignage,
- Participants à la vie du Royaume, non comme spectateurs, mais comme représentants de Dieu dans le monde.
Matthieu 28:18-20 – La Grande Commission
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, […] enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. »
Bien que donnée aux apôtres, cette mission est transmise à l’Église tout entière, car elle est à la fois permanente (« jusqu’à la fin du monde »), et universelle (toutes les nations), chaque croyant, en tant que disciple, est aussi appelé à faire d’autres disciples. De nombreuses paroles du Christ adressées aux apôtres s’adressent aussi à nous.
Galates 3:28 – Égalité spirituelle
« Il n’y a plus ni Juif ni Grec […] car vous êtes tous un en Jésus-Christ. »
En Christ tous les croyants ont également accès à Dieu, il n’existe aucune classe spirituelle supérieure (comme une caste sacerdotale).
Les Pères Apostoliques
Les Pères apostoliques (Clément de Rome, Ignace d’Antioche) du 1er au 3ème siècle mentionnaient Pierre comme un apôtre éminent, parfois comme exemple de foi ou de martyr, mais sans insister sur une primauté juridictionnelle.
Origène (185–253), l’un des premiers grands exégètes chrétiens, commente Matthieu 16:18 dans son Commentaire sur Matthieu (livre XII, chapitre 10). Il écrit:
« Si nous aussi disons : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant”, alors nous devenons nous aussi Pierre, et à nous aussi peut être dite cette parole : “Sur cette pierre je bâtirai mon Église”. »
Pour Origène la « pierre » n’était pas la personne de Pierre, mais la foi confessée par Pierre. Chaque croyant qui proclame cette foi devient une pierre vivante de l’Église. Il insiste sur le fait que l’Église est bâtie sur la révélation du Christ, pas sur une personne humaine. Cette lecture est non hiérarchique et spirituelle, elle souligne la centralité de la foi plutôt que d’un individu. C’est la logique du triptyque cité plus haut
La « pierre », c’est la foi (confession) de Pierre. Hilaire de Poitiers (IVᵉ s.) avait dit: « C’est sur la foi de sa confession que l’Église est bâtie. » Jean Chrysostome voyait dans la déclaration de Pierre l’élément fondateur: c’est la parole inspirée qui est le socle. Cette lecture était très courante chez les Pères grecs.
De Jérome, nous lisons que le « rocher était Christ, qu’il a donné à ses apôtres d’être appelés rochers ».1 La confession de foi de Pierre qui reconnaissait Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, est le roc sur lequel l’Église est bâtie. Origène est allé encore plus loin que Jérôme, en disant, que pas seulement les apôtres sont des rochers, mais tous les chrétiens à partir du moment où ils confessent Jésus comme Pierre. Pour Jean Chrysostome, le rocher était la confession de Pierre. Pour Basile de Séleucie, le rocher était la confession de Pierre parce que Jésus lui-même était le rocher. Il cite 1 Corinthiens 3, 10, Ephésiens 2 et plein d’autres passages qui identifient Jésus comme le rocher sur lequel l’église est construite.
La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle. (Psaumes 118:22)
Beaucoup comme Hilaire, Ambrosiaster, Epiphane, Théodoret, Cyrille d’Alexandrie ont écrit que le rocher était la confession de Pierre. D’autres bien sûr on dit que Pierre était lui-même le rocher mais la plupart du temps ils disent qu’il est le rocher grâce à sa confession parce que Jésus est le rocher. Pierre n’est ainsi pas le rocher en personne ou dans son rôle ecclésial mais il est le rocher car il est représentatif de la foi, il est un symbole de l’unité de l’église.
Ambroise par exemple, qui est souvent cité hors contexte (comme dans le cas de la vidéo de CDS) semble aller dans le sens des catholiques quand il dit « là ou est Pierre, là est l’église » mais si on continue de lire Ambroise, il dit2:
« Telle est la primauté de sa confession, non de l’honneur ; la primauté de la foi, non du rang. C’est donc Pierre qui a répondu pour les autres apôtres, ou plutôt avant tous les hommes. Ainsi, il est appelé le fondement, parce qu’il sait préserver non seulement son propre fondement, mais aussi le fondement commun… La foi, donc, est le fondement de l’Église, car il n’a pas été dit de la chair de Pierre, mais de sa foi, que « les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle ». »
Ce passage souligne que la primauté de Pierre repose sur sa foi et sa confession, non sur un honneur ou un rang particulier. Dans d’autres passages il identifie clairement que Christ est le rocher sur lequel l’église est construite et il dit basiquement « soyez un rocher comme Pierre ». Christ est le rocher donc confessez le rocher et vous serez aussi un rocher. C’est en ligne avec l’imagerie de Paul dans Ephésiens chapitre 2.
Pierre a bien évidemment été un apôtre fondateur, avec un rôle particulier au sein des apôtres mais pas de là à l’interpréter comme le rocher qui mènerait à la doctrine de la papauté. Si notre interprétation de Matthieu 16 suit les indices des Pères de l’église, alors nous n’arrivons pas à une interprétation favorable à la papauté et à l’interprétation catholique de Matthieu 16.
Pour les Pères de l’église, le rocher sur lequel l’église a été construite est Jésus-Christ et les apôtres sont ses témoins.
Ce qu’il faudrait pour justifier la papauté
Ce qu’il faudrait pour justifier la papauté n’est pas juste la notion que Pierre a eu un rôle fondateur pour l’église, mais qu’il l’a eu de telle manière qu’elle pouvait être transmise séquentiellement aux évêques ultérieurs. Même si l’on pense que Matthieu 16 représente l’office de Pierre, et non pas Jésus le rocher ou la confession de Pierre, qui pouvait être transmis, la doctrine reste très mince car elle ne repose que sur un verset. Les autres passages qui sont généralement amenés dans la discussion comme Jean 21 et Luc 22 par exemple, ne sont ni clairs ni explicites de la doctrine.
Aucun des Pères de l’église ne corrèlent ces textes avec le rang de Pierre. Ils regardent ces passages comme concernant la restauration de Pierre après son reniement du Christ. Cela aurait pu être une preuve de la papauté de Pierre si Jésus avait dit à Pierre dans Jean 21 « pais mes brebis comme mon vicaire » ou pour Luc 22 « quand tu reviens, renforce tes frères comme leur chef » or quelque chose dans le genre. Mais tout ce qui est dit dans ces passages est que Jésus restaure Pierre dans son ministère comme apôtre.
Les chrétiens orthodoxes orientaux et protestants croient en un rôle fondateur pour Pierre mais il faut beaucoup plus pour en arriver à la papauté. Cette doctrine est peut-être le problème principal qui divise les catholiques et les protestants. Tout cela a trait avec l’autorité. Beaucoup de choses découlent de cette doctrine, elle affecte l’approche utilisée en théologie et la vie du chrétien.
Pour une doctrine aussi conséquente et déterminante, il faudrait une très forte argumentation biblique à l’aide de nombreux passages sans ambiguïté, quelque chose qui nous dit clairement qu’il devait y avoir un pape. Cette attente n’est pas déraisonnable, nous avons des passages comme dans la lettre aux Ephésiens au chapitre 4, qui parle de l’unité de l’église et des offices de l’église servant l’unité de l’église: un seigneur, une foi, un baptême. On s’attend dans ce genre de passage quelque chose qui indique qu’il va y avoir un chef de l’église sur Terre mais nous n’avons rien de tel.
Il n’y a pas de débat sur le fait que l’église romaine était une église importante dès le début (avec celles d’Antioche, de Jérusalem et d’Alexandrie), de la même manière qu’il n’y a pas de débat sur le fait que Pierre était un meneur parmi les apôtres durant le ministère terrestre de Jésus. Il y a des commentaires des Pères de l’église sur la stature et l’importance de cette église. C’était la capitale de l’empire. Il s’agissait donc d’une très grande église. Ce qu’il faudrait pour soutenir l’idée de la papauté n’est pas juste une importance générale ou un leadership occasionnel, mais des preuves d’une juridiction universelle précoce dans l’histoire où l’évêque fonctionnait avec la charge du chef universel, comme le chef des évêques ou quelque chose comme ça.
Cela aurait pu se faire dans des conciles œcuméniques ou autres voies de ce type où l’église primitive débattait les doctrines. C’est important car les catholiques critiquent les innombrables dénominations protestantes, nécessitant selon eux un office central. L’église primitive a eu 7 conciles œcuméniques et d’autres conciles généraux par la suite également. Aucun de ces conciles n’a été convoqué par l’évêque de Rome. Ils étaient convoqués par l’empereur.
Quel était le rôle de l’évêque de Rome dans ces conciles œcuméniques? A vrai dire il n’a pas été invités à certains d’entre eux. Nous n’avons pas de preuve qu’il ait été consulté pour Nicée en 325. A Constantinople, au IVe siècle, il n’était même pas invité ou informé. L’église romaine n’a même pas envoyé des légats. Les catholiques diront qu’il suffit que le Pape approuve un concile œcuménique. Cela peut être contesté mais ce que nous cherchons au final ce sont des preuves que l’évêque romain avait une sorte de rôle prééminent et universel.
Même après la montée du pouvoir papal au 5ème siècle, il y a Constantinople II, il y a un cas où l’évêque romain Vigile, n’a non seulement pas convoqué le concile mais il a essayé de l’interdire. Il a écrit un édit à cet effet mais le concile s’est quand même déroulé. L’empereur Justinien a fait arrêter et exiler le pape Vigile (ses conseillers également). Justinien soutenait activement ce concile et voulait forcer l’adhésion du pape à ses décisions. Il a retiré le nom du Pape du concile, ce qui était une action disciplinaire conséquente.
Justinien a convoqué officiellement le Deuxième Concile œcuménique de Constantinople sans l’accord de Vigile. Le pape a refusé de participer et a rejeté ses décisions dans un premier temps. Finalement, en 554, après de longs mois d’exil et de négociations, Vigile a cédé et reconnu les décisions du concile, tout en essayant de sauver la face.
C’est un peu comme lorsqu’on regarde les papes frappés d’anathème du VIIe siècle comme le pape Honorius qui avait été frappé d’anathème parce qu’il avait enseigné des hérésies. Il avait enseigné le monothélisme de manière publique. Et les catholiques disent que le Pape est infaillible uniquement quand il parle ex-cathedra (depuis la chaire de l’évêque de Rome). Mais encore une fois ce que nous cherchons ce sont des preuves historiques que l’évêque de Rome, alors même qu’il était en même temps « le rocher » et « anathème », était hiérarchiquement plus élevé que tous les autres.
Dans ces conciles œcuméniques, la situation ne semble pas ressemblée à celle dépeinte par les catholiques. On ne voit pas l’église ancienne résoudre des débats doctrinaux par l’intermédiaire de l’office de l’église romaine. C’est la même chose que dans le livre des Actes, chapitre 15: toute l’église se réunie pour discuter pour résoudre une tension. Dans ce concile, Pierre n’a eu aucun rôle prééminent. Si l’un d’entre eux a eu un rôle particulier, c’était plutôt Jacques qui a résumé et fait la déclaration finale.
Les conciles œcuméniques et la manière dont l’église ancienne a navigué théologiquement ne donne pas de rôle prééminent à l’évêque romain. Nous pouvons regarder quel était le rôle de l’évêque romain et comment le pouvoir fonctionnait dans l’église primitive. Qui avait le droit de confirmer les évêques? Les preuves sont très claires que c’était une affaire régionale, locale.
Dans le sixième canon du Concile de Nicée, on peut voir trois zones de métropole majeures: Rome, Antioche et Alexandrie. Dans chacune de ces régions, l’évêque a l’autorité de confirmer la nomination d’autres évêques de sa région ou province.
Texte du canon 6 de Nicée (325)
« Que l’ancien usage soit maintenu, en Égypte, en Libye et dans la Pentapole, selon lequel l’évêque d’Alexandrie a autorité sur toutes ces provinces, puisque cela est aussi d’usage pour l’évêque de Rome. De même, dans Antioche et dans les autres provinces, que les Églises conservent leurs privilèges. ».
Cela s’est répété plusieurs fois. Il y a eu des synodes locaux tout au long du IVe siècle et aussi dans Constantinople I. Il est intéressant de les lire, ils disent finalement que Constantinople et Jérusalem ont également ce droit. Chaque évêque est invité à s’occuper de sa juridiction. Il n’y a pas de preuves que l’évêque de Rome était le chef des autres évêques. Il y avait une pluralité d’évêques où les villes les plus importantes ont des rôles plus importants mais aucune d’entre elles n’était le chef de l’autre.
Si on prend du recul et qu’on observe la grande image, il n’y a pas grand chose qui puisse montrer dans ses premiers siècles, que l’évêque romain avait la primauté sur les autres. Les preuves historiques sont donc aussi maigres que les preuves bibliques.
Il y a des écrits venant de Rome comme le Berger d’Hermas ou la lettre d’Ignace à Rome, qui ne parlent même pas d’un pape à Rome voire même pas de qui est l’évêque de Rome. Le mot « pape » n’était d’ailleurs pas exclusif à Rome. A partir du IIIe siècle, l’évêque de chaque ville occidentale et plusieurs de ceux en orient, était appelé « Pape ». Tous les autres titres qui sont finalement revenus à l’évêque romain étaient utilisés pour d’autres. Athanase était appelé le prince des prêtres. Le terme « Père des pères » a été utilisé par beaucoup d’autres évêques comme Jean de Constantinople. Finalement tous ces titres ont fini ultérieurement à être rassemblés pour l’évêque de Rome mais pendant des siècles, il n’y avait pas de terminologie ou une emphase particulière pour l’évêque de Rome.
Infaillible ou faillible?
CDS défend la doctrine de l’infaillibilité pontificale mais là encore cela ressemble plus à un exercice d’équilibriste ou à une tentative de protéger la doctrine plus qu’à une volonté pure et innocente de dénouer le vrai du faux. Toutes les positions peuvent être défendues efficacement, si c’est un objectif de départ. Le tout pour les étudiants est de discerner si la défense est biblique ou au moins cohérente.
Ainsi, le Pape serait à des moments infaillibles et à d’autres pas forcément. Mais si on est infaillible, on l’est tout le temps, autrement le mot ne veut plus rien dire. Si je vous dis que je suis « infaillible par moment » cela veut dire que je suis faillible tout simplement. On est infaillible ou on ne l’est pas.
Avec cette définition souple de l’infaillibilité, tous les chrétiens peuvent être considérés comme « infaillibles » car par moment ils ont raison et par moment ils ont tort! CDS reconnaît que « le pape peut se tromper puisqu’il est un homme mais que la plupart du temps il dit des choses belles et nécessaires ». Il y aurait des moments rares et des conditions précises où on peut sûr qu’il dit la vérité de manière infaillible. Ces moments n’incluent pas les discours, les discussions, certaines lettres, les interviews ou « peu importe », » soit la quasi totalité du temps là il est pas forcément infaillible.
CDS indique que c’est la foi de Pierre qui ne défaillirait pas. Ainsi lorsque le Pape s’exprime en mentionnant son titre de successeur de Pierre pour définir une chose en matière de foi ou de mœurs, en obligeant solennellement les fidèles catholiques à y adhérer pour guider l’église universelle et garder l’unité de la foi chrétienne, le rôle de Pierre, alors là on peut croire que le Pape est infaillible parce que c’est soutenu par la prière de Jésus pour son église. C’est clairement exagérer la prière de Jésus (on en reparle plus bas).
Autres points de la vidéo
CDS essaie d’argumenter avec des éléments relativement pauvres, comme le fait qu’il soit mentionné quelques fois dans le Nouveau Testament « Pierre et les disciples » ou dans Marc 16 (allez à dire aux disciples et à Pierre) ou « Jésus a changé le nom de Pierre » (comparable à Abram ou Jacob) mais cela ne confirme pas la primauté de Pierre sur les autres apôtres. C’est une extrapolation ou un forçage interprétatif.
Pierre a eu un grand rôle mais rien de semblable à celui du Pape monarchique qui a suivi dans les siècles ultérieurs de l’église catholique romaine. L’interprétation des versets par CDS est biaisée pour prouver que Pierre était spécial. Mais le fait qu’il ait été l’apôtre principal ou très proche de Jésus ne mène pas à la conclusion automatique et logique qu’il a été un Pape dans le sens perçu aujourd’hui.
Une prophétie sur Pierre
Il est aussi question de la prophétie d’Esaïe 22:22 que CDS semble associer à Pierre alors qu’elle concerne Jésus. Lisons là en contexte:
« Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture et je lui remettrai ton pouvoir politique, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et le royaume de Juda. Je le chargerai donc de la clé du royaume de David et, quand il ouvrira, nul ne refermera, et quand il fermera, personne n’ouvrira. »
Il est question ici du Messie et pas de Pierre. D’ailleurs ce verset est reprit dans Apocalypse 3:7:
« A l’ange de l’Eglise qui est à Philadelphie, écris : « Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme, et nul ne peut ouvrir«
Il ne faut donc pas confondre le public en donnant l’impression que l’Apôtre Pierre est visé par cette prophétie d’Esaïe 22.
Il est question également de Luc 22:32 où Jésus demande à Pierre d’affermir ses frères. Rien ici ne suggère que Pierre ait une autorité particulière. Cette instruction de Jésus peut s’appliquer à n’import quel croyant. Nous sommes censés être des « lumières du monde ». Cela nous donne le rôle naturel d’affermir les autres.
Les versets de CDS sont tous forcés pour pousser la légitimité papale de Pierre mais ils ne produisent pas naturellement cet effet. Il est encore question de Jean 21:15,17 où Jésus demande à Pierre de « paître ses brebis ». Cela indiquerait la fonction papale de Pierre. Mais ce rôle n’est pas attribué exclusivement à Pierre. A plusieurs reprises d’autres se voient recevoir la même instruction.
Paître le troupeau: une instruction universelle pour tous les responsables d’église
Actes 20:28 – Paul aux anciens d’Éphèse
« Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. »
- Paul parle ici aux anciens (presbuteroi), pas à un chef unique.
- Ils sont établis par l’Esprit, et doivent paître (ποιμαίνειν) l’Église.
- Le troupeau est celui de Dieu, pas le leur.
1 Pierre 5:1-3 – Pierre lui-même à d’autres anciens
« Moi, ancien comme eux […] je vous exhorte : paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement… »
- Pierre, bien qu’apôtre, se présente comme un ancien parmi les autres.
- Il n’exerce pas une autorité suprême, mais encourage les anciens à paître le troupeau.
- Cela montre que la responsabilité de paître n’est pas centralisée.
Éphésiens 4:11 – Les pasteurs comme don du Christ
« Et il a donné les uns comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres comme évangélistes, d’autres comme pasteurs et docteurs… »
- Le mot « pasteur » (ποιμήν / poimēn) signifie berger.
- C’est donc une fonction donnée à plusieurs, pas une exclusivité.
Hébreux 13:17 – Obéissez à vos conducteurs
« Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes… »
- Il est question ici de plusieurs responsables, pasteurs veilleurs, non d’un chef unique.
- L’Église primitive était conduite collégialement dans chaque communauté.
Pierre est-il infaillible après la résurrection?
CDS voit comme « immense » le rôle donné à Pierre mais ce rôle est donné à de nombreux autres responsables d’église. Le verset de Luc 22:32 est également utilisé pour dire que Pierre ne faillirait pas (donc serait infaillible) parce que Jésus lui dit qu’il a prié pour qu’il ne défaille pas. En contexte, Pierre n’avait pas encore failli lors de l’arrestation de Jésus, mais gageons que Jésus parlait de la situation spirituelle de Pierre post-résurrection. Or Pierre a encore failli dans Galates 2. La prière de Jésus ici ne disait pas que Pierre ne défaillirait jamais et encore moins que ceux qui se réclameraient de lui ne défailliraient pas non plus. Les défaillances sont courantes chez l’homme.
En fait Pierre n’a pas défailli dans sa mission générale, et il a été fidèle jusqu’au martyr. Tout cela ne prouve pas que les successeurs à Rome n’allaient jamais faillir (il est tellement facile à observer qu’ils ont failli dans l’histoire et encore aujourd’hui). CDS prête donc à la prière de Jésus plus que ce qu’elle avait comme objectif: que Pierre puisse aller jusqu’au bout de sa mission, en dépit des immenses défis qui l’attendaient.
Luc 22:32 ne parle pas d’un don doctrinal ou magistériel, mais de la foi personnelle de Pierre, c’est une prière d’intercession, non une proclamation juridique ou institutionnelle, elle ne mentionne aucun successeur, aucune « chaîne de transmission ». Le texte concerne Pierre seul, à un moment précis de sa vie. La prière vise à renforcer Pierre, sans en faire un homme infaillible.
Pierre: le « boss » de l’église?
CDS parle également de Paul qui est parti voir « le boss de l’église », Pierre. C’est bien évidemment une énorme exagération. Paul raconte dans Galates 1 sa conversion, son historique. Il est parti voir Pierre (simplement pour faire sa connaissance), et a aussi rencontré Jacques, non parce que l’un d’eux était le « boss » mais parce que naturellement ils avaient connu le Seigneur et Pierre avait accompagné Jésus durant son ministère terrestre. Il n’y a ici aucune relation hiérarchique entre Pierre et Paul. Il n’est jamais question de Pierre comme d’un chef de l’église dans le Nouveau Testament. En contexte, Galates 1 ne convaincra pas une personne neutre que Paul est venu rencontrer Pierre parce qu’il était le « boss ».
Paul va « faire la connaissance » (grec : ἱστορῆσαι / historesai) de Pierre — terme rare qui signifie rencontrer personnellement, non se soumettre. Paul ne dit pas qu’il est allé chercher l’approbation de Pierre. Il ne parle ni de soumission hiérarchique, ni d’une visite imposée. Il affirme plutôt que son Évangile ne vient pas des hommes, mais par révélation directe de Jésus-Christ (Galates 1:11–12).
Paul défend son autorité apostolique indépendante: il n’a pas reçu l’Évangile par l’enseignement d’un autre apôtre. Il veut prouver que son apostolat est aussi authentique que celui de Pierre, Jacques, Jean, etc. C’est donc l’inverse d’un argument en faveur de la primauté pétrinienne.
La confession aux prêtres catholiques dans Jacques 5?
CDS argumente également Jacques 5:14, 16
« L’un de vous est-il malade ? Qu’il appelle les responsables de l’Eglise, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis quelque péché, il lui sera pardonné… Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. »
Pour lui « les uns pour les autres » signifie se confesser aux anciens, qu’ils pensent être les prêtres. Non seulement « les uns autres » ne visent pas particulièrement les anciens. Il s’agit de se confesser les uns aux autres dans le sens « entre croyants » ou entre « frères ou sœurs ». « Quand un juste prie », on voit bien que ça concerne tout le monde.
De plus, les responsables ou anciens (presbuteroi) et les évêques sont souvent les mêmes personnes. Ce n’étaient pas des prêtres comme ceux de l’église catholique aujourd’hui.
Paul utilise les termes presbuteroi, episkopoi et poimen (pasteur) pour les mêmes hommes dans Actes 20:17 et 28 (idem dans Tite 1:5,7 mais aussi 1 Pierre 5:1-2). Il s’agit de termes interchangeables qui désignent les mêmes personnes. Dans le Nouveau Testament, il n’y a qu’un seul grand prêtre, Jésus, et tous les croyants sont prêtres (1 Pierre 2:5, 2:9, Apocalypse 1:6). Les trois termes décrivent différentes facettes d’un même ministère, celui de responsable spirituel d’une Église locale.
Le Nouveau Testament ne limite pas la confession ni la prière à un ministre spécifique.
Éphésiens 6:18
« Faites en tout temps, par l’Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. »
1 Timothée 2:1
« Je recommande donc, avant toute chose, que l’on fasse des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâces pour tous les hommes. »
Galates 6:1-2
« Frères, si quelqu’un vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur… Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. »
Hébreux 3:13
« Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : aujourd’hui, afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. »
Matthieu 18:15
« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. »
1 Thessaloniciens 5:11
« Encouragez-vous donc les uns les autres, et édifiez-vous mutuellement. »
Nous devons encourager l’horizontalité et la fraternité plutôt que la verticalité et la paternité non divine.
L’évêque unique par ville
C’est au IIe siècle qu’on commence à voir un évêque unique par ville (ex. Ignace d’Antioche) qui est secondé par des presbytres (anciens) et diacres. C’est l’origine du système épiscopal: évêque, prêtre, diacre mais ce n’est pas la structure apostolique originale du Nouveau Testament voire même des premiers siècles du christianisme de manière générale, comme on va le développer plus bas.
Au IIᵉ siècle, le système avec un évêque unique par Église locale commence à apparaître. L’évêque est entouré de presbytres et de diacres mais le fonctionnement reste collégial, l’évêque travaillant avec le conseil des anciens, et non seul. C’est plus tard (IIIe–IVe siècles) que l’autorité épiscopale devient plus centralisée et hiérarchisée, ouvrant la voie au modèle catholique classique où le modèle collégial apostolique cède progressivement sa place à une structure pyramidale, surtout après Constantin (IVe siècle).
Le titre Saint-Père
J’ai traité ce sujet dérangeant dans l’article « Les Papes et les Cardinaux à la lumière du texte biblique » mais nous pouvons dire un mot de plus ici. Les catholiques savent que l’utilisation de ce titre est très très limite, pour la simple et bonne raison que Jésus a déclaré ceci:
Matthieu 23:9 (LSG)
« N’appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père : celui qui est dans les cieux. »
Les catholiques renseignés ont une défense toute faite à proposer. L’idée est que le mot « Père » est utilisé de diverses manières dans la Bible (et dans la vie en général). Ils appuient par exemple sur le fait que Jésus ne nous interdit pas d’appeler notre père biologique « Père » alors appeler un prêtre, un évêque, un cardinal ou un pape « Père » ou « Saint-Père » dans le cas du pape est tout à fait acceptable. Cette vue viderait de son sens complètement la parole de Jésus.
Lorsqu’il est question de notre père biologique ou du Père des juifs, qui biologiquement, historiquement et généalogiquement est Abraham, il n’y a pas de problème car ici le terme « Père » ne renvoie pas à un titre mais à une réalité biologique. Dans le contexte de Matthieu 23, le problème soulevé par Jésus est lorsqu’on utilise le mot « Père » comme un titre. Voici comment la Bible du Semeur rend le passage:
Matthieu 23:9 (BDS)
« Ne donnez pas non plus à quelqu’un, ici-bas, le titre de « Père », car pour vous, il n’y a qu’un seul Père : le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chefs, car un seul est votre Chef : Christ. »
Nous voyons ici la futilité et le danger à donner les titres « Père », « Chef » ou « Boss » à un ancien de l’église, en particulier lorsqu’il est question de spiritualité. Nous avons en effet un père biologique ou physique mais nous avons aussi un Père spirituel qui est le Père Céleste, le Père du Seigneur Jésus-Christ.
La Réforme protestante a correctement vu dans ces titres un symbole de la dérive hiérarchique et non-biblique de l’Église catholique. Le titre « Père » appliqué aux prêtres ou au pape est une violation directe de l’enseignement du Christ, puisqu’il donne à un homme ce qui revient à Dieu seul.
Historiquement l’église catholique a souvent essayé de forcer une vue théologique de par son autorité pétrinienne revendiquée. En gros la succession apostolique indiquerait qu’ils ont raison mais ça ne fonctionne pas comme ça. On a raison si on a raison et pas parce qu’on se revendique de tel ou tel apôtre. Il faut rester logique et ne pas en revenir à un modèle pharisien d’autorité décorrélé de la justesse théologique et de la justice.
Jésus et le titre « Père »
Notons de manière pertinente que Jésus lui-même ne s’est jamais attribué le titre de « Père » dans le Nouveau Testament. Cela devrait nous alerter. Si Jésus n’a jamais revendiqué ce titre, à combien plus forte raison Pierre ne l’a pas fait. Paul non plus n’a jamais demandé à être appelé « Père Paul » contrairement aux déductions catholiques sur 1 Cor 4:15 . L’autorité spirituelle vient de la Parole de Dieu, non d’un rôle institutionnel ou d’un titre, cela nous prémunis des errements humains.
Jésus a toujours distingué le Père de lui-même:
- Jean 14:28 : « Le Père est plus grand que moi. »
- Jean 17:1-3 (prière sacerdotale) : « Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils… »
- Jean 20:17 : « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
- Matthieu 26:39 (Gethsémané) : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi… »
Voici les titres qu’il emploie pour parler de lui-même :
| Titre | Références | Sens |
|---|---|---|
| Fils de l’homme | 80+ fois (Matthieu 8:20, Luc 9:22, etc.) | Titre messianique et humble |
| Fils de Dieu | Jean 10:36, Matthieu 16:16, etc. | Relation unique avec Dieu le Père |
| Messie / Christ | Jean 4:26 ; Marc 14:61-62 | L’Oint attendu |
| Maître / Seigneur | Jean 13:13 ; Luc 6:46 | Enseignant, autorité spirituelle |
| Bon berger | Jean 10:11 | Guide sacrificiel du troupeau |
| Lumière du monde | Jean 8:12 | Révélation divine et vérité |
Il y a bien sûr l’exception d’Esaïe 9:5 où le messie devait être appelé « Père éternel » mais ce titre désigne probablement la nature paternelle et protectrice du Messie, pas son identité dans la Trinité. Dans la théologie chrétienne, le Fils (Jésus) est distinct du Père, bien qu’un avec lui dans l’essence divine (voir le Credo de Nicée).
La réalité est que Jésus se définit comme notre frère dans le Nouveau Testament, et cela est profondément théologique: cela montre son identification avec l’humanité, tout en restant Fils unique de Dieu.
Hébreux 2:11-12 (citant le Psaume 22:23) – Le texte le plus explicite
« Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères, en disant : Je proclamerai ton nom à mes frères… »
Jésus nous appelle « frères », parce qu’il partage notre nature humaine. Il s’identifie à nous dans l’incarnation, la souffrance et même la mort.
Matthieu 12:49-50 – Les vrais frères de Jésus
« Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère. »
Jésus redéfinit la famille spirituelle: elle ne dépend pas de la biologie, mais de l’obéissance à Dieu. Admirons comme Jésus exclut qu’un croyant faisant la volonté de son Père qui est dans les cieux, puisse être le Père de Jésus (alors qu’une femme peut être considérée comme sa mère spirituelle). Non, on peut être le frère, la sœur ou la mère de Jésus si on fait la volonté du Père Céleste, mais jamais on ne peut être le Père de Jésus, quand bien même on ferait la volonté de Dieu. Jésus tient à cœur que le titre « Père » soit réservé au Père Céleste.
Jean 20:17 – Jésus parle de « son Père et notre Père »
« Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part : Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. »
Romains 8:29 – Le Fils premier-né parmi plusieurs frères
« Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d’un grand nombre de frères. »
Jésus est le « premier-né » (prototokos) : il précède tous les croyants dans la résurrection et la gloire. Cela fait de nous ses frères et sœurs spirituels, en tant que membres de la famille de Dieu.
Si Jésus-Christ lui-même, Fils éternel de Dieu, Seigneur, Sauveur, Chef de l’Église et Premier-né d’entre les morts, ne s’est jamais attribué le titre de « Père », il semble incohérent, voire présomptueux, que Pierre ou ses successeurs puissent s’arroger ce titre spirituel, surtout dans un sens absolu ou hiérarchique.
Pierre ne se fait jamais appeler « Père » dans le Nouveau Testament. Dans ses lettres (1 et 2 Pierre), il ne s’intitule que « ancien », « apôtre » ou « serviteur » (1 Pierre 5:1). Il exhorte les anciens à paître le troupeau, mais sans dominer : « Non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » (1 Pierre 5:3)
Pierre ne revendique jamais de primauté monarchique, et encore moins le titre de « Père », encore moins du « Saint-Père ». Si ni Jésus ni Pierre ne se sont attribué ce titre, comment justifier qu’un homme l’adopte?
L’horizontalité de l’église primitive
CDS indique que chaque ville avait un chef. Non seulement le mot « chef » ne correspond pas aux mots utilisés dans le Nouveau Testament, mais en plus chaque ville n’avait pas un évêque ou un responsable mais plusieurs.
Actes 14:23
« Dans chaque Eglise, ils firent élire [ou nommer] des responsables [pluriel] et, en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. »
Tite 1:5
« Je t’ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens, et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l’Eglise en suivant les directives que je t’ai données. »
CDS se base sur 1 Timothée 3:2 pour indique que chaque ville avait un chef. Nous voyons que le mot chef n’est pas utilisé et qu’il y a plusieurs responsables et non un seul, mais lisons le passage:
1 Timothée 3:2
« Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable : mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi et vivant de façon convenable. Qu’il soit hospitalier et capable d’enseigner. »
Paul ici donne des instructions générales sur ce que doivent être les responsables de l’église, incluant les diacres au verset 8. En fait Paul dit à peu près la même que dans la lettre à Tite dont nous avions lu le verset 5 plus haut. Lisons la suite:
Tite 1:6-9
« Chacun d’eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c’est-à-dire qu’on ne puisse pas les accuser d’inconduite ou d’insoumission. En effet, il est nécessaire qu’un dirigeant d’Eglise soit irréprochable, puisqu’il a la responsabilité de la famille de Dieu. …
Ainsi il sera en mesure d’encourager les autres selon l’enseignement sain et de réfuter les contradicteurs. »
Dans Actes 6:1-6, on voit également comment les douze apôtres ont invité l’ensemble des disciples à élire « 7 hommes réputés dignes de confiance » pour organiser les distributions quotidiennes. Etienne était l’un des 7. Il y a du sens qu’à chaque fois l’idée pour les apôtres est d’encourager une structure avec plusieurs « responsables de confiance » car l’un peut rattraper l’autre et vice-versa. Si on met une seule personne et que cette personne flanche, ça fait flancher tout le monde! Beaucoup dirait que c’est exactement le cas avec l’église catholique.
Enfin le mot « évêque » n’est pas synonyme de chef comme suggéré par CDS, qui dit que les chefs étaient appelés « évêques ». Il ne faut pas imposer ses conceptions dans le texte. Le terme évêque signifie « surveillant », il s’agit d’un rôle de « supervision ». Aux Philippiens, Paul et Timothée disent:
Philippiens 1:1
« Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint, et qui vivent à Philippes, ainsi que les dirigeants [évêques] de l’Eglise et les diacres. »
Nous voyons qu’il y avait plusieurs « évêques » à l’église de Philippe.
Il n’y a qu’un chef de l’église, au sens où parle CDS:
Éphésiens 5:23
« Christ est le chef de l’Église, qui est son corps. »
Pas de complexification de la chose avec des notions de « co-chef » ou « chef visible » et « chef invisible ». Toutes ces choses ont pour but de viabiliser la position catholique mais elles n’émanent pas des textes. Jésus a été suffisamment clair sur le fait qu’il n’y a qu’un seul chef:
Ne vous faites pas non plus appeler chefs, car un seul est votre Chef : Christ.
Quand Jésus dit « un seul » cela veut dire « un seul »!
La lettre aux Smyrniotes d’Ignace d’Antioche
« Là où paraît l’évêque, là doit être la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l’Église catholique. »
Pour les catholiques ce passage (non canonique rappelons le) justifie la structure hiérarchique aux trois offices (évêque, ancien, diacre) avec une hiérarchie pyramidale où l’évêque est le chef de la ville. Les protestants, de leur côté, ont tendance à voir dans ce passage un glissement vers une hiérarchisation non biblique, qui s’éloigne de la simplicité néotestamentaire (collégialité de plusieurs évêques par ville, égalité des frères…).
Comme indiqué dans les trois autres articles sur le sujet de la papauté et de la structure de l’église, la papauté impériale est un concept progressif dans l’histoire. Elle n’est pas biblique mais historique. Ignace, d’ailleurs, ne dit pas exactement ce que les catholiques disent aujourd’hui. Il n’y a pas encore la notion de « pape » ou de primauté de Rome. Cela viendra bien après lui. Dans la vue d’Ignace, les évêques dirigent leur ville et eux-mêmes ne sont soumis à personne.
De manière intéressante nous avons dans cette lettre aux smyrniotes, à ma connaissance, la première utilisation connue du terme « Église catholique » (katholikē ekklēsia) dans la littérature chrétienne. « Catholique » signifie ici : universelle, intégrale, fidèle à l’enseignement reçu des apôtres. Bien avant les conciles, le terme « catholique » (universel) était déjà utilisé pour désigner la totalité de l’Église fidèle à l’Évangile, et non une institution particulière.
CDS, comme beaucoup de catholique, mentionne cette lettre Ignace d’Antioche comme un soutien indéniable à la structure de l’église catholique. Mais hélas les choses ne sont pas aussi simples et aussi évidentes. Il n’y aurait pas eu de schisme entre les églises d’occident et d’orient et pas de réforme protestante si tout cela avait été aussi simple et évident que ne le laisse penser la vidéo de CDS (les débats sur la papauté existe depuis bien avant le Protestantisme pour la petite histoire).
Comme souvent, les argumentations qui cherchent à défendre une doctrine plus que la vérité ne font pas un travail global et suffisamment transparent. En dehors de ce que peut sembler dire un passage isolément, il faut traiter la logique globale et étudier les différentes sources sur le sujet.
Comme le dit le Gavin Ortlund, docteur en théologie et expert en la matière, « il ne faut pas lire Ignace sans lire les autres pères apostoliques ». Quand on lit les autres « Pères de l’église », on observe une image beaucoup plus complexe que si on ne connaît que la citation isolée d’Ignace aux Smyrniotes. C’est d’ailleurs l’une des difficultés à intégrer de manière non maîtrisée les écrits des Pères de l’église dans notre théologie car les écrits très nombreux de ces derniers sont peu connus du grand public. Les croyants ont déjà fort à faire avec l’étude biblique et tous n’ont pas le temps ou la capacité d’aller voir ce qu’on dit les chrétiens durant les siècles qui ont suivi Jésus. Chez ces Pères de l’église, nous ne trouvons pas la même unité doctrinale que dans les écrits du Nouveau Testament. On pourrait donc piocher ce qui nous convient.
De manière quasi unanime, avant et pendant la vie d’Ignace, la structure de l’église était à deux offices. Un exemple de ça est l’épitre de Polycarpe aux Philippiens, dans les chapitres 5 et 6, qui est très similaire à 1 Timothée 3. Il précise le rôle des diacres et des presbytres (anciens). Il n’y a pas de mention d’un troisième office. Un autre exemple est la première épître de Clément, chapitre 42, qui est intitulée l’ordre des ministres dans l’église. Il parle de Christ établissant l’église, avec des évêques et des diacres. Initialement les termes « évêque » et « presbytre » étaient interchangeables et désignaient les mêmes personnes. Nous l’avons vu dans les écrits du Nouveau Testament, mais cela est aussi le cas dans le chapitre 44 de la première épître de Clément. A la fin, Clément référence la pluralité des presbytres dans l’église de Corinthe. L’église n’est pas dirigée par un presbytre ou un évêque mais par plusieurs responsables, de manière collégiale. C’est ce qu’on voit dans tous ces premiers pères de l’église en dehors d’Ignace.
On le voit encore dans « Le Berger d’Hermas » (100-140), il y a une référence de Rome où il y avait plusieurs responsables dans l’église romaine. Il est question des anciens (presbytres) de Rome, au pluriel (aucune mention d’un « pape » ou évêque unique de Rome). On le voit également dans « La Didachè » (80-100) (ou Didaké) où dans le chapitre 15 on référence des évêques et des diacres dans une même communauté (sans mention d’un évêque unique ou de « chef » hiérarchique), comme dans la première épître de Clément.
En fait, même dans les lettres d’Ignace, une chose intéressante est que les preuves sont très faibles sur le fait qu’il y avait un seul évêque à Rome, contrairement aux arguments catholiques. Il n’y a pas de référence qu’il y avait un évêque unique à Rome alors même qu’Ignace avait une vue élevée de l’évêque.
Clément de son côté ne fait jamais appel à son autorité, il ne mentionne jamais son nom. Cela nous fait penser à Pierre qui était au même niveau que tout le monde dans le Nouveau Testament « moi ancien comme eux ». Clément écrivait au nom de toute l’église.
Beaucoup d’historiens catholiques reconnaissent qu’il y a un développement progressif d’un stade où il n’y avait pas d’évêque unique à Rome, jusqu’à que l’on arrive bien plus loin dans le IIe siècle et que l’on observe une progression vers un début de hiérarchie catholique, qui ne deviendra ce qu’elle est aujourd’hui, que bien des siècles plus tard (notamment avec Léon 1er). Aux IIe et IIIe siècle on ne faisait pas appel à Matthieu 16 pour justifier l’autorité pétrinienne.
Il est important de noter que les termes « évêque » et « diacre » ont longtemps été interchangeables, représentant diverses facettes du ministère d’un responsable d’église. Avec Ignace, en effet, nous commençons à voir la distinction. En fait, avec lui, c’est encore différent de la conception traditionnelle de la succession apostolique où il y a les apôtres transmettant leur autorité ou certains aspects de cette autorité aux évêques. Avec Ignace, les évêques étaient comparés à Dieu et les presbytres étaient comparés à l’autorité des apôtres. C’était une vue assez unique ou effectivement l’évêque avait un rang très élevé. Nombreuses de ses lettres se résument basiquement à « obéir à l’évêque », avec pour exception intéressante sa lettre à l’église romaine.
Au final, seul Ignace dans cette période défend cette vue aux trois offices avec l’évêque distinct, unique et supérieur en grade. Il n’est donc pas correct d’indiquer que dans le premier centenaire qui a suivi Jésus, nous avions déjà la structure de l’église catholique. La structure de l’église a en fait changé progressivement pour devenir plus autoritaire et pyramidale en réponse aux hérésies qui étaient très fortes dans les premières générations de l’église. Si l’on retourne au Nouveau Testament, nous n’avons aucune base pour différencier l’office de l’évêque et celui du presbytre. Il est très clair que les deux termes étaient utilisés de manière interchangeable. On le voit notamment dans Tite 1:5,7 ou Actes 20:17,28.
Quand on regarde le mot évêque dans le dictionnaire d’Oxford, il dit que ce mot était utilisé de manière interchangeable avec le mot « ancien » à l’origine. Plusieurs Pères de l’église reconnaissent cela également. Par exemple Jérôme (347-420), qui disait qu’évêque et presbytre sont une seule et même chose et qu’avant les dissensions provoquées par le diable, l’église était dirigée par le conseil commun des presbytres. Jérôme reconnait que la structure de l’église avait évolué progressivement pour devenir plus verticale, plus pyramidale.
Calvin ne considérait pas qu’Ignace était dans l’erreur, bien qu’il refusait la présentation des trois offices faite par ce dernier. Il disait que c’était une coutume humaine qui avait été utilisée pour répondre aux besoins de l’époque. Calvin cite Jérôme dans son argumentation. Cette structure avait été mise en place pour répondre aux menaces de schisme. Toutes les différences qu’il y a entre dans les différentes traditions chrétiennes, dans la vue hiérarchique de l’église, ne sont pas nécessairement des cas de vérité contre l’erreur et ainsi de suite. Il s’agit de différentes applications ou de différentes réponses apportées à certains moments.
Le Nouveau Testament nous donne quelques indices sur comment nous devons penser l’église, mais il ne nous donne pas tous les détails, c’est pourquoi il y a de la place pour imaginer divers fonctionnements. Il y a des choses, qui ne sont pas bibliques, mais qui ne sont pas contre la Bible, c’est pourquoi je dis toujours que je n’ai rien contre la tradition, à partir du moment où elle n’est pas en confrontation avec les textes bibliques, autrement il y a un problème. C’est cela que Calvin avait en tête quand il parlait du développement de l’office de l’évêque durant le IIe siècle. La vue d’Ignace n’était pas normative ou représentative du fonctionnement de l’église des origines.
Le fait que cette vue se soit imposée ne doit pas nous faire oublier la complexité du sujet et les raisons historiques qui ont amené à ces changements. Il était par exemple commun que l’empereur ait un rôle très important dans le gouvernement de l’église. C’était l’empereur qui convoquait les conciles œcuméniques et les papes lui étaient soumis jusqu’à Grégoire le Grand au VIe siècle. Nous devons reconnaître le contexte « impérial » durant le développement de l’église primitive. On ne peut donc pas dire que le fonctionnement de l’église, que l’on a commencé à voir à la fin du IIe siècle puis après, était normatif dans tous ses aspects à moins que l’on ramène l’Empire Romain. Il faut apprécier le contexte historique.
Quand Irénée à la fin du IIe siècle fait appel à la succession apostolique, il y avait du sens à faire cela dans le contexte des hérésies. Notons d’ailleurs qu’il ne faisait pas appel à l’argument de l’autorité pétrinienne pour justifier la primauté de Rome mais à la tradition apostolique conservée à Rome à son époque. Cette église était restée fidèle et exemplaire et c’est pourquoi il fallait l’écouter. Tout cela est à comprendre dans le contexte des hérésies.
C’est une notion différente que de dire que la succession apostolique est indéfinie, que c’est la marque de l’église exclusive, uniquement si on a la succession apostolique et qu’ainsi on est la vraie église. La vue protestante depuis Galates 1 et d’autres passages est que personne (incluant les anges) ne peuvent revendiquer être du bon côté s’ils se séparent de la doctrine apostolique. Il y a donc une différence entre faire appel à la succession apostolique pour protéger la doctrine apostolique et faire appel à la succession apostolique séparément de la doctrine apostolique.
Le souverain pontife
La notion de « pontife » (pontifex) est originellement une fonction religieuse païenne propre à la Rome impériale, bien antérieure au christianisme, et elle a été progressivement reprise et transformée par l’Église romaine.
Pontifex vient probablement de « pons, pontis » = pont, et « facere » = faire. Littéralement ça veut « faiseur de ponts », possiblement au sens de « médiateur entre le monde des hommes et des dieux ». Le « pontifex maximus » était le grand prêtre de la religion romaine. Il présidait le collège des pontifes, chargé du calendrier sacré, des fêtes religieuses, des rites publics, etc. Ce titre fut assumé par Jules César, puis par les empereurs romains eux-mêmes, jusqu’à la christianisation de l’Empire. Le « pontifex maximus » était une autorité religieuse suprême dans le polythéisme romain, étroitement liée au pouvoir impérial.
Les premières désignations pour les responsables chrétiens sont comme déjà dit:
- Évêques (episkopoi),
- Presbytres (presbuteroi),
- Diacres (diakonoi),
Il n’y a pas de « pontifex » dans les textes néotestamentaires ni dans les écrits des Pères apostoliques. Après la conversion de Constantin et surtout après Théodose Ier, l’Église commence à adopter certains titres d’origine impériale ou sacerdotale romaine. À partir du Ve siècle, les évêques de Rome commencent à être qualifiés de « pontifex », notamment « pontifex maximus », par analogie avec l’ancienne fonction impériale. Ce titre n’est donc pas biblique, mais hérité du vocabulaire religieux impérial, recyclé dans un contexte chrétien. Ce titre officiel (Pontifex Maximus) fut repris définitivement par le pape dans l’Antiquité tardive et intégré dans la titulature papale à partir du Moyen Âge.
Apprécier le contexte de l’époque
Si on veut citer Ignace, il faut le faire en précisant le contexte de l’époque et ce que disait les autres Pères de l’église autour de lui. Il ne faut pas l’isoler. Il faut aussi reconnaître la complexité du sujet et traiter Jérôme et son interprétation de l’évolution des deux offices vers les trois offices en réponse aux menaces de schisme. Il faut reconnaître les nuances de la vue d’Ignace qui n’est pas exactement la même que celle des catholiques avec la succession apostolique. Il faut aussi éviter de cadrer ce débat comme Catholique VS Protestant VS Orthodoxe ou inversement. Certains protestants croient en la succession apostolique et l’épiscopat monarchique.
CDS, en affirmant dans sa vidéo à 15min26, au sujet d’Ignace, « on a plusieurs confirmations très claires de la manière de fonctionner de l’église du 1er siècle ». Hélas, c’est complètement faux, à ce moment ci de l’histoire, Ignace est le seul à parler en ses termes. CDS dit qu’Ignace ne définit pas les termes « évêque » et « catholique » parce que tout le monde comprenait ce que c’était. Ainsi la hiérarchie de l’église et les rôles de chacun étaient clairs dans l’esprit de tout le monde mais nous avons vu que c’est faux.
CDS force des conclusions sur des silences ou des passages neutres. Par exemple l’auteur a écrit « Pierre et les disciples » alors cela veut dire que Pierre était le chef des apôtres ou « Jean a attendu Pierre pour entrer dans la tombe » alors cela pourrait vouloir dire que Pierre était ceci ou cela. Ce type d’argumentation est trop faible pour prouver un point, surtout quand il n’est jamais dit que Pierre était le chef et que les apôtres lui étaient soumis et qu’il ne reçoit jamais un titre particulier dans le Nouveau Testament, si ce n’est d’être un ancien comme les autres.
CDS ne présente pas les vues de Clément de Rome, ni de Polycarpe, ni du Berger d’Hermas, ni de la Didachè, qui tous parlent de la structure collégiale de l’église primitive. Cela révèle un traitement biaisé, qui tend à prouver qu’il cherche à protéger une doctrine plus que la vérité biblique. Il omet complètement l’interchangeabilité des termes « presbytre » et « évêque » dans le NT ainsi que les « plusieurs responsables » par ville pour favoriser la vue de l’évêque unique.
Le renvoi des presbytres par les corinthiens et Clément de Rome
CDS parle également des presbytres (anciens), légitimement établis, qui avaient été renversés ou destitués par certains membres de l’Église de Corinthe. Clément avait écrit pour condamner cette rébellion, appeler à la paix et restaurer les anciens en place.
Cette lettre a été rédigée depuis Rome vers 95–96 apr. J.-C., à une Église de Corinthe troublée par un schisme interne. Clément est le troisième successeur de Pierre à Rome (après Lin et Anaclet), mais il n’est pas intervenu en autorité monarchique mais plutôt en frère ancien s’adressant à une autre Église.
« Nos apôtres savaient aussi qu’il y aurait des disputes au sujet du ministère de l’épiscopat. […] Ils établirent donc des presbytres dans les Églises […] et donnèrent l’instruction suivante : Si ces hommes venaient à s’endormir (mourir), d’autres hommes éprouvés leur succéderaient. »
(1 Clément 44)
« C’est une faute grave, mes frères bien-aimés, que ces hommes, qui ont offert les dons de l’épiscopat d’une manière irréprochable, aient été rejetés de leur ministère. »
Clément montre que les apôtres ont prévu une succession ordonnée des anciens. La structure d’autorité locale était déjà en place, il n’est pas question d’un « évêque unique » à Corinthe, mais d’un collège de presbytres. Clément condamne une sorte de démocratie désordonnée ou révolution ecclésiale. Il appelle à la soumission, l’ordre, et la paix, conformément à la tradition apostolique. Il n’invoque pas une juridiction universelle, mais une autorité morale, il exhorte avec amour, non comme un souverain pontife.
Le style, le langage et les structures d’autorité dans la Lettre de Clément de Rome aux Corinthiens (1 Clément) montrent que Clément n’intervient pas comme un pape monarchique (au sens développé plus tard par la doctrine catholique), mais plutôt comme un ancien parmi les anciens, agissant au nom de la communauté romaine, et dans un esprit de fraternité apostolique. Il est tout à fait possible de se corriger les uns les autres sans pour autant qu’il y ait une relation dominant/dominé.
Clément parle au nom de l’Église de Rome, pas en son nom personnel. On le voit dans sa formule d’ouverture:
« L’Église de Dieu qui séjourne à Rome à l’Église de Dieu qui séjourne à Corinthe… »
(1 Clément 1:1)
Clément n’écrit pas en tant que « pape Clément », mais au nom de l’Église romaine dans son ensemble. Il utilise un langage communautaire (« nous », « notre », « frères bien-aimés »), sans s’arroger un titre supérieur ou exclusif. Cela montre un rapport d’Église à Église, non de supérieur à subordonné. Il est très loin de « gronder » les corinthiens comme le dit CDS.
Clément ne s’est pas imposé, il a exhorté et employé des expressions comme:
- « Nous vous supplions… » (chap. 56),
- « Soyons soumis les uns aux autres… » (chap. 57),
- « Prions pour ceux qui ont fauté… » (chap. 59).
Cela révèle une autorité morale fondée sur l’ancienneté dans la foi, le désir de paix, la fidélité à la tradition apostolique, mais pas une autorité hiérarchique contraignante ou juridictionnelle. Clément ne dit jamais des choses comme:
- « Je suis le successeur de Pierre »,
- « Vous devez obéir à mon autorité apostolique »,
- « J’ai pouvoir sur votre Église locale ».
Il ne mentionne ni Pierre, ni Paul, ni Jésus, pour légitimer une supériorité institutionnelle de Rome. Bien au contraire, il reconnaît une collégialité et une autonomie locale. Clément a écrit:
« Nos apôtres savaient qu’il y aurait des disputes au sujet du ministère de l’épiscopat. C’est pourquoi ils établirent des presbytres… »
(chap. 44)
Il évoque une transmission collégiale, avec une attention à la succession locale et ne prétend pas s’imposer au-dessus de cette structure.
Dans le chapitre 1, il dit:
« À cause de vos discordes et de votre sédition, […] nous avons été poussés à vous écrire, non parce que nous avons trouvé matière à le faire, mais parce que c’est notre devoir fraternel. »
Clément se sentait appelé à la réconciliation, non au commandement. Il a agit en tant que médiateur de paix entre frères, non comme un supérieur hiérarchique imposant des sanctions.
Il n’est pas certain que Clément de Rome ait été un « évêque unique » au sens monarchique. La tradition le considère comme le quatrième évêque de Rome, mais les données historiques les plus anciennes suggèrent plutôt une forme collégiale de gouvernement dans l’Église romaine à la fin du Ier siècle, quoi que les catholiques puissent déduire d’Irénée et Eusèbe qui ont écrit très longtemps après lui.
Clément n’écrit jamais en tant qu’ »évêque ». Il parle au nom de l’Église de Rome, de manière collective. Aucun titre personnel n’est mentionné (contrairement aux évêques ultérieurs comme Ignace). Le style est celui d’un porte-parole, pas d’un souverain spirituel. Cela suggère que l’Église de Rome à cette époque était dirigée par un collège de presbytres, et que Clément était probablement un presbytre influent, ou le président de ce collège, pas encore un évêque au sens monarchique.
1 Clément parle de presbytres (anciens) et non d’un seul évêque. La lettre insiste sur la succession apostolique des presbytres, pas sur un office épiscopal supérieur. Rome n’a aucune trace explicite d’un évêque unique avant la fin du IIe siècle. La plupart des historiens modernes (Lightfoot, Lampe, Sullivan, Ehrman, etc.) reconnaissent que le modèle monarchique épiscopal ne s’est probablement imposé à Rome que progressivement au IIe siècle, alors qu’il s’est développé avant à Antioche ou en Asie Mineure. Dans ce modèle il n’y a pas d’évêques soumis à Rome.
Ignace parle, dans toutes ses lettres, d’un évêque unique par Église locale en Asie mineure mais sa lettre aux Romains (la seule adressée à une Église occidentale) ne mentionne aucun évêque. Il s’adresse simplement à l’Église qui préside dans la charité. Ce silence est frappant si Rome avait déjà un évêque unique établi. Cela conforte l’idée que Rome, vers 95–110, était gouvernée de manière collégiale.
Il y avait plein d’évêques écrivant des lettres à d’autres églises et cela ne prouve pas une juridiction universelle. Les lettres d’Ignace à diverses églises, juste après les lettres de Clément, sont plus imposantes et autoritaires alors même qu’il n’était pas l’évêque de Rome. La lettre de Clément est écrite en réponse à l’appel de l’église de Corinthe. Elle ne prouve las juridiction universelle.
CDS en prêtant à Clément des menaces et des injonctions aux Corinthiens à lui obéir, autrement cela serait une faute grave, fait plus qu’exagérer, il tord complètement la réalité de la première épître de Clément. Ce qui est une « faute grave » dans l’épître c’est d’avoir rejeter des hommes de leur ministère. C’est comme si on disait que c’est une faute grave qu’un responsable religieux ait commis une agression sexuelle. Cela n’établit pas pour autant une relation de chef à subordonné.
D’autres feront appel à Victor, évêque de Rome à la fin du IIe siècle (non mentionné par CDS). Il y avait un débat à propos de la date de Pâque. Victor a essayé d’excommunié un certain nombre de personnes. Irénée et d’autres évêques se sont impliqués dans l’affaire et Eusèbe a dit qu’ils ont sérieusement réprimandé Victor. Des catholiques diront que Victor n’aurait pas essayé de faire ça s’il n’avait pas le droit de le faire. On ne peut rien prouver sur la base de ce genre d’exemple. L’interprétation est biaisée, si ce n’est forcée, pour trouver des arguments pro église catholique romaine.
On ne peut pas prouver que quelqu’un avait le droit de faire quelque chose parce qu’il a tenté de le faire. Peut-être que la raison pour laquelle Irénée et d’autres évêques sont intervenus est justement parce qu’il allait au delà de son autorité. Il y a eu d’autres évêques qui ont été réprimandés de la sorte, comme Etienne 1er au siècle suivant, par Cyprien.
Au Ve siècle, clairement, c’est là qu’on commence à voir la prééminence du rôle de l’évêque de Rome avec le pontificat de Léon 1er. Au VIe siècle il y a une consolidation massive et une extension du pouvoir papal avec Grégoire le Grand qui était un remarquable leader. Jaroslav Pelikan, grand historien du christianisme (notamment dans son œuvre monumentale The Christian Tradition), reconnaît que le pontificat de Grégoire le Grand (pape de 590 à 604) constitue effectivement un tournant pour la papauté au VIe siècle.
Historiquement, il n’y a pas de soutien pour justifier la papauté durant les premiers siècles du Christianisme. Même dans les lettres d’Ignace on en est très loin (les évêques ne sont pas soumis à Rome et Pierre n’est pas reconnu comme chef des apôtres). La papauté s’est développée progressivement et a peu, si ce n’est aucune base biblique. Les protestants ne sont pas les premiers à revendiquer cela. Le protestantisme a hérité d’une église qui était déjà divisée sur ce sujet. Les chrétiens orientaux orthodoxes mais aussi d’autres traditions dans l’est ne reconnaissent pas la primauté de l’église de Rome.
L’église catholique romaine est-elle la continuité directe de l’église fondée Jésus-Christ?
CDS dit que les Apôtres choisiraient de vivre dans l’église catholique s’ils pouvaient revenir aujourd’hui mais bien sûr cela suppose que les doctrines et fondamentaux apostoliques soient encore maintenus aujourd’hui dans cette église, ce qui est très contestable. Pas sûr non plus qu’Irénée dirait au sujet de l’église de Rome actuelle ce qu’il disait à son sujet la fin du IIe siècle de notre ère.
En fait, la papauté est en choc frontal avec les institutions bibliques, au sujet de la forme gouvernemental (vertical plutôt qu’horizontal), le rôle et les titres et pouvoirs accordés au Pape sans mentionner les nombreuses erreurs théologiques et élément non historiques qui ont été introduits dans les siècles qui ont suivi Jésus.
CDS dit encore qu’il faut un pape sinon il y a pas d’unité complète mais cela n’est pas ce qu’on voit dans l’église du premier siècle.
Ephésiens 4:1-6
« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. »
Bibliquement, l’unité de l’Église ne dépend pas d’un pape. Elle repose:
- Sur le Christ comme seul chef (Éphésiens 1:223),
- Sur la foi commune dans l’Évangile (Philippiens 1:274),
- Et sur l’action de l’Esprit Saint (1 Corinthiens 12:135).
Les premiers chrétiens étaient unis sans pape, par la Parole, la prière, la communion fraternelle, la doctrine des apôtres (Actes 2:426).
Les désaccords entre protestants
Il y a des désaccords chez les protestants note CDS. Toutes pensent être guidés par l’esprit saint mais il y en a plein qui se trompe puisqu’il y a des divergences. Mais cela n’est pas aussi négatif qu’il n’y paraît, c’est une bonne chose de débattre et d’essayer d’améliorer sa compréhension. L’adversité créé aussi des possibilités et des études approfondies des sujets. Il en était de même à l’époque des apôtres et peu après eux, il y avait des débats, des sujets de tension et cela n’était pas grave en soi à partir du moment où les uns et les autres se mettaient à la table pour les traiter dans la maturité (voir Actes 15 et le débat intense à Jérusalem qui a été résolu par la prière, l’écoute de la Parole, le témoignage de l’Esprit, et le consensus fraternel). Paul nous invite à discerner, juger, débattre:
1 Thessaloniciens 5:21
« Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. »
1 Corinthiens 14:29
« Que deux ou trois prophètes parlent, et que les autres jugent. »
Galates 2:11-14
Paul reprend publiquement Pierre, dans un esprit de vérité et de correction fraternelle.
L’unité n’efface pas la diversité, mais la sanctifie:
Éphésiens 4:13-15
« Jusqu’à ce que nous parvenions à l’unité de la foi… en professant la vérité dans l’amour. »
L’unité est un but progressif, pas un état figé imposé d’en haut.
Les divergences doctrinales peuvent avoir une valeur pédagogique:
- Elles nous poussent à creuser l’Écriture,
- Elles humilient notre intelligence : personne ne possède toute la vérité,
- Elles nous obligent à pratiquer la charité dans la discussion,
- Elles peuvent conduire à des réformes (comme la Réforme elle-même !)
Proverbes 27:17
« Le fer aiguise le fer ; ainsi un homme en aiguise un autre. »
Mais la Bible met aussi en garde contre certaines divisions. Il y a une différence entre des différences sincères sur des points secondaires et des hérésies volontaires, orgueilleuses, ou destructrices.
Tite 3:10
« Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, de celui qui provoque des divisions. »
1 Corinthiens 1:10
« Qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. »
Et les dissensions chez les catholiques?
CDS fait des remarques mais n’approfondit pas toujours les sujets. Son objectif est de trouver des arguments, sans toutefois les soupeser, de sorte qu’il est pris à son propre jeu. Nous pouvons noter que les dissensions sont nombreuses entre catholiques. C’est particulièrement intéressant puisque c’est un catholique intéressé par mes contenus créationnistes qui a porté à mon attention la vidéo de CDS. Certains catholiques sont en effet créationnistes et d’autres des évolutionnistes théistes. Mais il y a de très nombreux autres points qui divisent les catholiques entre eux, et qui n’ont rien à envier aux débats inter protestants et inter évangéliques.
Il y a des divisions théologiques internes sur la théologie morale et sociale, sur la sexualité, la contraception, le mariage, l’homosexualité, la bioéthique où les catholiques sont souvent très divisés. Certains soutiennent fidèlement l’enseignement traditionnel (Humanae Vitae, Jean-Paul II), D’autres appellent à une réforme morale plus inclusive, voire à réinterpréter certains dogmes.
Pareil pour la liturgie (forme ordinaire vs. extraordinaire). Le Concile Vatican II (1962–65) a entraîné des réformes liturgiques majeures. Beaucoup s’y sont adaptés (forme ordinaire en langue vernaculaire), mais d’autres sont restés attachés à la messe tridentine en latin (forme extraordinaire), il y a eu des tensions accrues après les restrictions de Traditionis Custodes (2021, pape François).
Il y a des groupes catholiques en tension ou en rupture partielle:
| Groupe | Position vis-à-vis de Rome |
|---|---|
| Lefebvristes (FSSPX) | En communion imparfaite, refus de Vatican II et du Novus Ordo |
| Sédévacantistes | Rejettent les papes depuis Vatican II comme non valides |
| Catholiques libéraux (ex : Hans Küng, Teilhard, etc.) | Critiquent Rome pour immobilisme doctrinal |
| Théologiens de la libération (en Amérique latine) | Sont ou ont été mis sous surveillance par Rome |
Tous ces courants se disent « catholiques », mais divergent sur l’autorité, la doctrine et la discipline.
Il y a aussi des tensions au sein de la hiérarchie catholique. Des cardinaux et évêques s’opposent publiquement au pape ou à certaines orientations. Il y a les Dubia des cardinaux (2016–2023) où 5 cardinaux ont interrogé publiquement le pape sur des points doctrinaux (Amoris Laetitia, bénédictions de couples irréguliers, etc.). Le cardinal Sarah, Burke ou feu Viganò ont exprimé de fortes réserves contre les réformes du pape François. Ces désaccords restent à l’intérieur de l’institution, mais ils révèlent une profonde fracture d’orientation.
Sur la contraception, environ 10–20 % seulement des catholiques suivent la doctrine. Sur l’avortement, beaucoup sont partagés selon les cas. De plus en plus de catholiques acceptent le mariage homosexuel. Une minorité très active réclame la messe en latin.
Et pour en revenir à l’infaillibilité pontificale, il est curieux de voir des hommes infaillibles, c’est à dire les papes successifs, différer sur la manière d’enseigner, le rapport au monde moderne et l’accent pastoral ou disciplinaire. Nous savons bien que le Pape François se positionnait différemment de Benoit XVI et Jean Paul II.
Les divergences internes sont nombreuses, parfois graves, sur le plan moral, doctrinal et ecclésiologique. L’unité visible ne garantit pas l’unité réelle de conviction. L’ordre réel censé régner dans l’église catholique n’est pas évident. Les catholiques rétorqueront que les divisions sont « internes » et ne provoquent pas de schisme mais ces schismes ont justement été causés par le doctrine papale dans le passé et certains groupes catholiques sont en rupture avancée. De plus, les tensions internes sont similaires dans le fond à ce qui est reproché chez les protestants donc au final, bien que l’unité de façade soit à peu près maintenue, les mêmes genres de division s’observent.
Personnellement je ne vois rien de mal à ce qu’il y ait des divergences, des vues différentes sur tel ou tel point car cela fait partie de notre remise en question constante, de notre capacité à apprendre, comprendre, à améliorer ou corriger notre compréhension des doctrines bibliques. La confusion s’est installée au fil de l’histoire, et nous devons tous essayer de revenir à la saine compréhension et à extraire les erreurs qui ont été incorporées dans la théologie. Il ne faut pas se présenter comme le détenteur des bonnes interprétations, de manière rigide, en particulier parce qu’on serait le successeur de Pierre.
CDS en soulevant les divergences entre protestants, pourrait tout logiquement critiquer aussi les divergences entre catholiques. Il faut faire attention aux traitements partiels et biaisés.
Conclusion
Il faut essayer d’être le plus biblique et le plus historique possible sur le sujet de la structure de l’église (et sur bien d’autres sujets), avec une réelle envie de poursuivre la vérité. Nous voulons tous faire partie de l’église catholique apostolique.
Ce que nous recevons toutefois de la part des catholiques romains est que nous devons affirmer tous les dogmes du magistère comme l’assomption corporelle de Marie. Mais quelles raisons avons-nous d’affirmer ce genre de doctrine? Cela n’est ni étayé bibliquement, ni historiquement pendant des siècles (il faut attendre le Ve et le VIe siècle). La raison donnée d’y croire serait de faire confiance à tout cet appareil d’enseignement romain qui a l’autorité, lequel a lui-même évolué au fil des siècles.
Il ne faut pas être impressionné par ces dénominations chrétiennes qui veulent s’interposer ou se rendre incontournable pour le salut (ça ne concerne pas que les catholiques). Le message de Jésus est beaucoup plus doux et rassurant:
Matthieu 18:20
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. »
Jésus est au milieu de nous si nous sommes assemblés en son nom. Ni Pierre, ni un autre apôtre, ni aucun leader d’église, ni église n’a de rôle d’intermédiaire à jouer: nous sommes l’église! C’est entre nous et Jésus et heureusement qu’il en soit ainsi. Les modèles pyramidaux ne fonctionnent en général pas très bien. David avait correctement compris la situation en son temps. Lorsqu’après avoir péché en faisant le recensement du peuple, il avait dû choisir entre trois châtiments envoyés par Dieu à cause de son erreur:
« David répondit à Gad : Je suis dans une grande angoisse ! Oh ! tombons entre les mains de l’Éternel, car ses compassions sont immenses ; mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes! »
(2 Samuel 24:14)
Jésus avait aussi enseigné les problèmes des modèles de gouvernement humain et ils nous a enseigné à ne pas copier ce type de modèle:
Luc 22:24-26
Les disciples eurent une vive discussion : il s’agissait de savoir lequel d’entre eux devait être considéré comme le plus grand.
Jésus intervint : Les rois des nations, dit-il, dominent leurs peuples, et ceux qui exercent l’autorité sur elles se font appeler leurs « bienfaiteurs ». Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur….
Matthieu 20:25-28
« Celui qui veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur… le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. »
Marc 10:42-45
« Vous savez que ceux qu’on regarde comme chefs des nations les tyrannisent… Il n’en sera pas de même parmi vous. »
La grandeur dans le Royaume n’est pas dans la domination, mais dans le service. Cela contredit toute idée d’une autorité chrétienne qui serait fondée sur le pouvoir, le prestige, la succession ou la domination. Si Jésus est le serviteur suprême, alors toute autorité dans l’Église doit être à son image: humble, discrète, sacrifiée. Pierre comprenait ce principe:
1 Pierre 5:1-3.
« Ne dominez pas sur ceux qui vous sont échus en partage… »
Références:
- https://christiantruth.com/articles/fathersmt16/.
- https://www.modernreformation.org/resources/articles/from-bishop-to-pope.
- Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église.
- Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme pour la foi de l’Évangile.
- Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.
- Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!