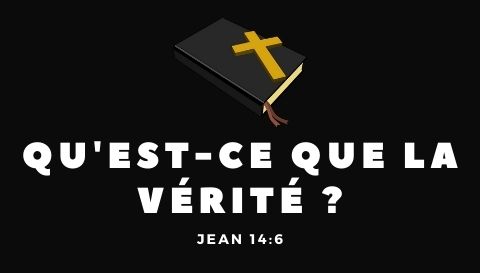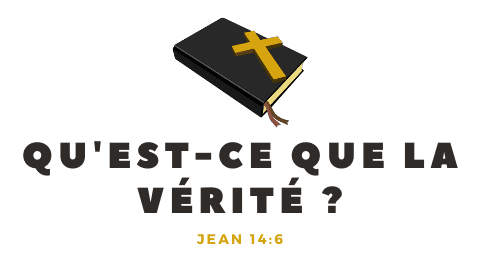Et si on voyait les Étoiles Lointaines en temps réel?
La lumière des objets lointains (étoiles, galaxies…) mettrait du temps à voyager, c’est un fait bien connu n’est-ce pas? En physique, la vitesse de la lumière dans le vide est une constante fondamentale, soit environ 300 000 km/s. Voici quelques exemples concrets:
- La lumière de la Lune mettrait environ 1,3 seconde à nous parvenir.
- La lumière du Soleil environ 8 minutes et 20 secondes.
- La lumière d’Alpha Centauri (l’étoile la plus proche après le Soleil) environ 4,3 ans.
- La lumière de certaines galaxies mettrait des millions ou des milliards d’années à arriver jusqu’à nous.
Dans le modèle standard, quand on regarde une galaxie à un milliard d’années-lumière, on imagine voir cette galaxie telle qu’elle était il y a un milliard d’années et non comme elle est aujourd’hui. Cet argument est allègrement utilisé par les évolutionnistes pour prouver que l’univers est vieux de plusieurs milliards d’années et que la chronologie biblique de moins de 10 000 ans est impossible. Mais je suis français, en plus d’être chrétien, donc clairement « impossible n’est pas français ni chrétien » (allez un peu d’humour ne fait pas de mal😉).

Auteur: NASA, ESA, CSA, and STScI
Dans cet article j’explore la théorie ASC (Anisotropic Synchrony Convention) du créationniste et Dr Jason Lisle, spécialiste en physique et astronomie. L’idée de base est qu’on pourrait voir les objets lointains en temps réel. Cette perspective est également considérée par des scientifiques non créationnistes comme le Dr Derek Muller de la chaîne YouTube Veritasium, dans sa vidéo intitulée « Why No One Has Measured The Speed Of Light« .
Dans un article de 2020, Lewis et Barnes avaient aussi examiné les implications d’une vitesse de la lumière qui varierait selon la direction dans un modèle cosmologique simplifié appelé l’univers de Milne.1

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
Exploration d’un problème non résolu sur la vitesse de la lumière
Il y a un problème fondamental en physique souvent peu discuté (et peu connu par les militants athées): la mesure de la vitesse de la lumière en aller simple (one-way speed of light). Elle est très différente de la mesure aller-retour (two-way speed of light) qui, elle, a été mesurée de façon fiable, comme nous l’avons vu en début d’article.
Toutes les expériences classiques de mesure de la vitesse de la lumière (par exemple, Fizeau, Foucault, Michelson-Morley) mesurent la vitesse moyenne sur un trajet aller-retour. Cela veut dire qu’on envoie un signal lumineux (ou autre) vers un miroir lointain et qu’on mesure le temps qu’il met à revenir. On mesure ainsi une vitesse constante et finie: environ 300 000 km/s.
Mesurer la vitesse aller simple (par exemple, d’un point A vers un point B) est beaucoup plus compliqué (voire impossible).2 Pourquoi? Parce que cela suppose qu’on ait synchronisé parfaitement les horloges A et B. Mais comment synchroniser ces horloges? Einstein lui-même, dans sa théorie de la relativité restreinte (1905), a posé une convention:
On définit la vitesse de la lumière comme étant la même dans toutes les directions.
Cela signifie qu’on suppose que la lumière va à la même vitesse dans toutes les directions, mais ce n’est pas quelque chose qu’on peut directement prouver expérimentalement sans faire d’hypothèses.
Si, par exemple, on imagine que la lumière va à la vitesse de 150 000 km/s dans une direction, mais instantanément dans l’autre, on ne pourrait pas le détecter dans une mesure aller-retour: le temps total serait le même. C’est ce qu’on appelle un problème de convention:
- Soit on suppose la vitesse égale dans toutes les directions (Einstein, convention standard),
- Soit on peut imaginer des vitesses différentes (les mesures aller-retour restant les mêmes).
À ce jour il n’existe aucune expérience directe qui ait mesuré la vitesse aller simple de la lumière sans hypothèse de synchronisation. Toutes les expériences supposent a priori la symétrie (postulat d’Einstein). Si on rejette cette convention, on peut envisager des modèles anisotropes (lumière plus rapide dans une direction que dans l’autre), ces modèles sont mathématiquement équivalents à ceux d’Einstein et ne changent pas les prédictions observables.
Deux scientifiques séculiers dans le cadre de l’univers de Milne et de l’étude de la vitesse de la lumière infinie dans un sens ont écrit:
« Il [en parlant d’Einstein] a également reconnu que les prédictions physiques de sa théorie resteraient inchangées si la vitesse de la lumière était anisotrope, tant que la vitesse moyenne aller-retour est égale à c. »3
Jason Lisle déclare dans son livre « The Physics of Einstein »:
« Il semble que nous soyons libres de choisir la vitesse unidirectionnelle de la lumière, et que l’univers confirme notre choix. »
Il dit encore:
« En 1970, John Winnie a démontré que les effets mesurables de la relativité restreinte ne dépendent d’aucune valeur particulière de la vitesse unidirectionnelle de la lumière — uniquement de la vitesse aller-retour.
Il a constaté que, quelle que soit la valeur réelle de la vitesse de la lumière dans une seule direction, cela n’a absolument aucun effet sur les observations objectives ou sur les résultats mesurables de quoi que ce soit dans l’univers.
Cela affecte seulement la façon dont nous définissons la « simultanéité », et donc la manière dont nous horodatons divers événements. Il est instructif d’examiner les travaux de recherche de Winnie.«
Si on ne peut pas mesurer la vitesse aller simple, on ne peut pas savoir combien de temps a mis la lumière d’une étoile lointaine pour arriver jusqu’à nous. Donc, dire que la lumière d’une galaxie à un milliard d’années-lumière met un milliard d’années à arriver est une hypothèse basée sur le postulat standard, pas une vérité mesurée.
Cela ouvre la porte théorique à l’idée que la lumière pourrait arriver instantanément d’une galaxie lointaine, si on choisissait une convention où la vitesse aller simple est infinie dans un sens et plus lente dans l’autre. En d’autres termes le problème du temps de parcours de la lumière (light travel time problem) pourrait être une illusion, un problème créé par la convention choisie et non par une réalité mesurée.
La physique standard choisit la convention d’Einstein (symétrie: c dans toutes les directions) parce que c’est la plus simple et qu’elle s’intègre parfaitement à la relativité restreinte. Mais d’autres choix sont mathématiquement possibles. Einstein a choisi de postuler que la lumière va à la même vitesse dans toutes les directions. Et ce choix a permit de bâtir tout le formalisme de la relativité restreinte.
En principe, on pourrait choisir une autre convention: par exemple, on pourrait dire : « La lumière va à la moitié de c (c/2) dans une direction, et instantanément dans l’autre. » Dans ce cas le temps serait plus long dans une direction et plus court dans l’autre mais le temps aller-retour serait le même que dans la convention d’Einstein. Pourquoi? Parce que la mesure expérimentale aller-retour ne change pas.
Autrement dit:
| Direction | Vitesse choisie (convention) | Temps de parcours |
|---|---|---|
| A vers B | c/2 | Lent |
| B vers A | Infini (instantané) | Zéro temps |
| Aller-retour | c | Comme dans la physique standard! |
Si on choisit une convention comme celle-là, on obtient les mêmes résultats expérimentaux pour les expériences aller-retour mais on change l’interprétation des événements distants. Dans cette convention, la lumière pourrait arriver instantanément d’une étoile lointaine. On verrait donc l’Univers en temps réel.
Einstein a choisi la convention symétrique (c dans toutes les directions) pour plusieurs raisons:
- Simplicité mathématique cela simplifie les équations et la symétrie de la physique.
- Esthétique scientifique cela paraît plus « naturel » d’avoir une vitesse constante dans toutes les directions.
- Aucune différence expérimentale car quoi qu’on choisisse, la mesure aller-retour reste la même.
Aucune expérience ne peut invalider le choix de C/2… mais ce serait un peu arbitraire ou « bizarre » à utiliser.
Si le temps que met la lumière pour nous parvenir est basé sur un choix de convention, alors on ne peut pas dire qu’il y a objectivement un problème à expliquer de comment la lumière d’une étoile lointaine est arrivée jusqu’à nous. Par exemple, dans une convention C/2, la lumière de n’importe quelle galaxie pourrait arriver instantanément. Le problème du temps de parcours de la lumière pourrait ne pas être un vrai problème, mais juste une conséquence d’une convention arbitraire.
Imaginons:
- Point A : l’émetteur.
- Point B : le miroir à 300 000 km.
On envoie un flash lumineux, et il revient au point A. Le temps mesuré aller-retour est de 2 secondes. On conclut que la lumière a parcouru 600 000 km en 2 secondes, donc la vitesse moyenne aller-retour est égal à 600 000 / 2 = 300 000 km/s. Mais… si on veut savoir combien de temps elle a mis dans un seul sens (aller uniquement), on est obligé de deviner la répartition.
La physique standard choisit de diviser par 2, et dit:
Aller = 1 seconde, Retour = 1 seconde.
Mais rien ne l’impose expérimentalement. On pourrait imaginer:
- Aller : 0,1 seconde.
- Retour : 1,9 seconde.
Résultat : temps total = 2 secondes, ça colle toujours avec l’expérience !
Si la vitesse aller simple est indéterminable, alors on ne peut pas affirmer qu’une étoile lointaine est « vraiment » à un milliard d’années-lumière de nous dans le sens temporel. C’est une conséquence de la convention choisie, pas une mesure absolue.
Cas C/2 dans un sens et infini dans l’autre
- Vitesse A → B = C/2 = 150 000 km/s
- Vitesse B → A = instantanée (infini)
Calculs:
- Temps aller A → B:
300 000 km / 150 000 km/s = 2 secondes - Temps retour B → A:
300 000 km / infini = 0 seconde (instantané) - Temps total aller-retour:
2 secondes + 0 seconde = 2 secondes (exactement le même résultat que dans le modèle standard)
Dans les deux modèles (Einstein ou C/2), le temps mesuré aller-retour est identique. Les expériences ne peuvent pas distinguer entre ces deux scénarios.
Dans la convention standard (Einstein) :
La lumière met 1 seconde pour aller de A à B, et 1 seconde pour revenir de B à A.
Dans la convention C/2:
La lumière met 2 secondes pour aller de A à B, mais revient instantanément.
Si on imagine que la lumière des étoiles arrive par ce « retour instantané », alors on verrait les étoiles en temps réel, sans délai.
Fondamentalement, l’équation de Lisle montre que plus l’angle est proche de zéro, plus la vitesse unidirectionnelle de la lumière est élevée. Seule la lumière se dirigeant directement vers un observateur a une vitesse infinie.
Jason Lisle fournit un exemple dans son livre pour comprendre les deux conventions:
« Par exemple, supposons que, le 3 janvier, deux astronomes — Jake et Emily — observent une supernova, c’est-à-dire l’explosion d’une étoile.
Jake préfère utiliser la convention de synchronisation standard (ESC), tandis qu’Emily utilise la convention anisotrope (ASC).
Quelques jours plus tard, un ami commun apprend la nouvelle de la supernova et téléphone à Jake pour lui demander quand cette supernova s’est produite.
Mais Jake n’a pas encore eu le temps de mesurer la distance jusqu’à la supernova, il est donc incapable de répondre à la question. Il passe alors le téléphone à Emily.
Elle répond : « Elle s’est produite le 3 janvier, il y a seulement quelques jours. »
Avec le temps, Jake et Emily finissent par estimer la distance de la supernova : elle se trouve à 2000 années-lumière de la Terre, soit environ 1,2 × 10¹⁶ miles.
Jake peut désormais répondre à la question de savoir quand l’événement s’est produit : il y a environ 2000 ans.
Emily, elle, maintient sa réponse : la supernova s’est produite le 3 janvier.
Tous deux s’accordent à dire qu’ils ont vu l’explosion le 3 janvier, mais la question demeure : « Quand s’est-elle réellement produite ? »
Selon la convention ASC, le temps de parcours de la lumière est nul, car la lumière se déplace directement vers les observateurs sur Terre.
Il n’a donc fallu aucun temps du tout pour parcourir la distance de 2000 années-lumière.
En revanche, selon la convention ESC, le trajet a duré 2000 ans.
Il convient de noter que, du point de vue de la lumière, le trajet est instantané.
Cela est vrai, que nous utilisions la convention ASC ou ESC.
En effet, la dilatation du temps devient infinie à mesure que quelque chose approche de la vitesse de la lumière. Ainsi, du point de vue de la lumière, chaque trajet est instantané.La question est donc de savoir combien de temps le voyage a duré du point de vue de la Terre.
Et comme il s’agit d’un trajet à sens unique, la réponse n’est pas objectivement mesurable ; elle dépend du choix de la convention de synchronisation.Il est inutile de se demander si Jake ou Emily a la bonne réponse concernant le moment où l’événement s’est réellement produit. Les deux ont raison selon la convention qu’ils ont choisie.
En effet, la question : « Quelle était l’heure sur Terre au moment exact où l’étoile lointaine a explosé ? » est une question de synchronisation.
Elle suppose que nous possédions des horloges sur Terre synchronisées (au moins conceptuellement) avec le temps de l’étoile distante.
La réponse dépendra donc nécessairement de l’observateur, de son référentiel et de la convention de synchronisation qu’il a adoptée.Ce choix n’est rien d’autre qu’une question de convention, ou, en d’autres termes, de commodité.«
Pourquoi la vitesse pourrait être instantanée dans un sens et plus lente dans l’autre?
L’idée qu’il pourrait y avoir une vitesse de la lumière différente selon la direction implique qu’il existerait une direction privilégiée dans l’espace-temps, ce qu’on appelle une anisotropie.
Dans la physique standard, la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions (principe d’isotropie). Cela découle du principe cosmologique: l’univers est homogène (le même partout) et isotrope (le même dans toutes les directions). C’est ce qui permet de construire la relativité restreinte et générale.
Mais…on sait que l’univers n’est pas parfaitement symétrique:
- Il a un fond diffus cosmologique (CMB) qui montre des petites anisotropies (fluctuations de température).
- Des observations comme le « dipôle cosmologique » (vitesse de la Terre dans le CMB) montrent qu’on se déplace dans une certaine direction.
- On observe aussi des structures filamenteuses dans l’univers à grande échelle (superamas, vides), ce qui casse une isotropie parfaite.
Donc en théorie, il pourrait exister une direction privilégiée dans l’espace-temps. Si une direction préférée existe, alors la vitesse de la lumière pourrait varier selon la direction (une anisotropie de la lumière). C’est ce qu’on appelle une violation de la symétrie de Lorentz (fondement de la relativité restreinte). Certains modèles physiques (comme la théorie de l’éther, les théories de gravité modifiée, ou même des extensions du modèle standard comme le SME — Standard Model Extension) tentent d’explorer ces pistes.
L’idée est séduisante parce qu’elle pourrait expliquer certaines anomalies cosmologiques (comme la fameuse « Axis of Evil » dans le CMB, une orientation privilégiée des fluctuations) Mais aussi parce qu’un univers parfaitement symétrique est une idéalisation et la réalité pourrait être plus complexe. Elle remettrait en question le principe de relativité d’Einstein et ouvrerait la porte à de nouvelles théories.
On peut faire un parallèle entre la possibilité d’une vitesse de la lumière anisotrope et le fait que notre univers n’est pas parfaitement symétrique à bien des égards, notamment dans la répartition de matière et d’antimatière. Dans le modèle standard de la physique, on pourrait s’attendre à ce que lors du Big Bang (auquel je ne crois pas), il se soit créé autant de matière (électrons, protons, neutrons…) que d’antimatière (positrons, antiprotons, antineutrons…). Mais ce n’est pas ce qu’on observe:
- L’univers est composé quasiment uniquement de matière.
- L’antimatière est extrêmement rare (on en trouve en laboratoire ou dans certains processus astrophysiques, mais pas à grande échelle).
Cela pose un problème appelé le déséquilibre baryonique ou asymétrie matière-antimatière. Donc, l’univers n’est pas parfaitement symétrique. Il y a une préférence (une asymétrie): la matière a « gagné » sur l’antimatière. Le raisonnement est donc le suivant:
Puisqu’on a des asymétries fondamentales dans l’univers, comme ce déséquilibre matière/antimatière, pourquoi supposer que tout est parfaitement symétrique pour la lumière ?
Pourquoi la vitesse de la lumière serait-elle différente à l’aller et au retour? Jason Lisle répond:
« Je ne connais aucune raison pour laquelle elles devraient être différentes.
Mais je ne connais pas non plus de raison pour laquelle elles devraient être identiques.
Les gens préfèrent peut-être, par sentiment, la symétrie consistant à avoir la même vitesse de A vers B que de B vers A.
Mais le fait de préférer quelque chose le rend-il automatiquement vrai ?
Devons-nous nous attendre à ce que l’univers se conforme à nos préférences émotionnelles ?
S’il est une vérité fondamentale que nous enseigne la physique d’Einstein, c’est bien que l’univers ne se conforme pas toujours à nos préférences ou à nos attentes.« 4
Jason Lisle déclare:5
« En réalité, il existe d’importants problèmes scientifiques avec l’idée que toute la matière de l’univers provient de l’énergie du big bang. Des expériences en laboratoire ont montré que l’on peut fabriquer de la matière à partir d’énergie. Mais dans tous les cas, la réaction produit aussi une quantité égale d’antimatière. L’antimatière possède les mêmes propriétés que la matière ordinaire, sauf que les charges électriques des particules sont inversées. Ainsi, un anti-électron (souvent appelé positron) est exactement comme un électron, sauf que l’électron a une charge négative et le positron une charge positive. Chaque fois qu’on produit un électron, on obtient aussi un positron. La science a démontré que chaque fois que l’énergie se transforme en matière, elle produit également une quantité exactement égale d’antimatière. Il n’existe aucune exception.
Ceci est significatif car l’univers est essentiellement composé uniquement de matière. Si la matière de l’univers provenait de l’énergie, le processus aurait donc dû produire une quantité égale d’antimatière. En d’autres termes, si l’étape 3 du modèle standard s’était réellement produite, alors l’univers devrait être composé de 50 % de matière et de 50 % d’antimatière. Mais les observations montrent que l’univers est pratiquement constitué à 100 % de matière. Ainsi, non seulement l’étape trois n’est pas scientifique (non observable, non reproductible), mais elle semble en plus contraire aux observations scientifiques.«
Peut-être qu’il existe une direction privilégiée dans l’univers, tout comme il existe une « préférence » pour la matière. Si c’est le cas, la lumière pourrait aller plus vite dans une direction que dans une autre, ou d’autres phénomènes pourraient montrer des violations de symétrie.
Le problème des galaxies matures et des éléments lourds selon le modèle Big Bang
Avec le Big Bang les galaxies situées à des décalages vers le rouge élevés (z > 6, 10, 13…) sont supposées être jeunes, car leur lumière provient d’une époque où l’univers était censé être très jeune (quelques centaines de millions d’années après le Big Bang). Pourtant, le télescope James Webb a révélé des galaxies massives et complexes avec un redshift de z = 14,32, des galaxies riches en éléments lourds (métaux), alors que selon le Big Bang, il n’y avait pas encore eu assez de temps pour fabriquer ces éléments dans des étoiles. Cela pose un problème majeur pour le Big Bang:
Comment des galaxies « bébés » peuvent-elles être aussi « adultes » (riches en métaux, structurées, massives) aussi rapidement?
GN-z11 a été repérée dans la constellation de la Grande Ourse avec un décalage vers le rouge (redshift) de z ≈ 11,1, ce qui signifie que nous l’observons telle qu’elle était environ 400 millions d’années après le Big Bang. À l’époque, elle était considérée comme la galaxie la plus lointaine jamais observée.
En mai 2024, le télescope spatial James Webb a identifié une galaxie encore plus distante, nommée JADES-GS-z14-0, avec un redshift de z = 14,32. Cela correspond à une époque où l’univers n’avait que ~290 millions d’années, battant ainsi le record précédemment détenu par GN-z11.
Mais attention : « éloignées » = traduction d’un modèle, pas une mesure directe. Le décalage vers le rouge (redshift) est un phénomène mesuré (allongement des longueurs d’onde), mais son interprétation comme distance et âge dépend des hypothèses du modèle Big Bang: si l’univers s’est vraiment étendu sur 13,8 milliards d’années, alors un redshift élevé = galaxie très lointaine et très ancienne. Mais si les hypothèses sont erronées (ou alternatives, comme en créationnisme), le redshift pourrait avoir d’autres causes (fatigue de la lumière, effets gravitationnels, vitesse de la lumière plus rapide autrefois, effet Doppler à la Hubble…).
Certaines de ces galaxies éloignées ont des masses stellaires comparable à la Voie Lactée, alors qu’elles sont censées être très jeunes selon le Big Bang. Elles contiennent déjà des éléments lourds (C, O, Fe…), alors qu’il ne devrait pas y avoir eu assez de temps pour former plusieurs générations d’étoiles et les disséminer (on commence uniquement avec les éléments légers dans le Big-Bang).
Les structures de ces galaxies lointaines sont trop « évoluées ». Certaines montrent des disques bien formés, des bras spiraux, et même des signes de fusion galactique. Cela semble impossible dans un modèle où elles n’ont eu que quelques centaines de millions d’années pour se former après le Big Bang.
Ces découvertes du JWST posent un problème majeur au modèle standard. Si ces galaxies sont réellement situées à des milliards d’années-lumière et observées dans un état jeune, leur maturité défie les lois de l’évolution galactique. Certains scientifiques (comme Rajendra Gupta) ont proposé de doubler l’âge de l’univers (26,7 milliards d’années au lieu de 13,8) pour résoudre ce problème (mais cela reste une hypothèse très controversée dans le camp évolutionniste car ça remettrait beaucoup de choses en question par effet domino).
Dans une perspective créationniste (modèle ASC ou lumière en transit):
- Le redshift est un phénomène mesuré, mais n’indique pas nécessairement un âge ancien.
- Ces galaxies ont pu être créées matures dès le début (Genèse 1:14-19), avec une lumière visible instantanément sur Terre.
- Les observations du JWST confirment une création complète et fonctionnelle et non une évolution lente sur des milliards d’années.
En substance on peut dire:
Les galaxies que nous voyons aujourd’hui, même à grand redshift, ne sont pas des bébés en train de se former, mais des créations matures, témoignages de la puissance de Dieu.
Dans le modèle ASC, les galaxies lointaines ne doivent pas paraître plus jeunes que les galaxies proches car elles ont toutes été créées en même temps à un état mature, lors de la semaine de la création. La lumière nous parvient immédiatement grâce à la synchronisation anisotrope. Ainsi, nous voyons des galaxies matures et complexes immédiatement après leur création, même si elles sont très lointaines et nous voyons aussi des étoiles contenant des éléments lourds (C, O, Fe…) dès leur apparition, car Dieu les a créées avec ces éléments déjà intégrés (comme il a pu créer la mer avec un niveau de salinité à la base pour les espèces marines).
Il n’y a aucune « attente » nécessaire: pas besoin d’attendre des millions ou milliards d’années pour que des étoiles produisent des éléments lourds dans leur cœur et pas besoin de cycles d’explosions d’étoiles (supernovæ) ni de fusions d’étoiles à neutrons pour fabriquer l’or ou le platine. La maturité des galaxies lointaines observée par JWST tend à démontrer que ces longs processus évolutifs n’ont pas été nécessaires. La Bible indique dans Hébreux 4 que Dieu avait achevé (terminé) sa création au 7ème jour.
| Observation | Big Bang | ASC + créationniste |
|---|---|---|
| Galaxies massives et complexes très tôt (z > 10) | Problème: pas assez de temps pour les former | Pas de problème: créées matures dès le départ, lumière instantanée |
| Présence d’éléments lourds (C, O, Fe, Au) dans étoiles très jeunes | Problème: pas assez de cycles d’étoiles | Créés directement par Dieu dans les étoiles dès le 4e jour |
| Lumière de galaxies lointaines visible aujourd’hui | Univers très vieux nécessaire (13,8 milliards d’années) | Pas besoin: lumière instantanée grâce au modèle ASC |
| Cohérence avec Genèse | Non | Oui: création complète et fonctionnelle dès le début |
Imaginons un musée avec une galerie d’œuvres d’art: dans le modèle Big Bang, on s’attendrait à trouver des toiles à peine commencées dans les galeries éloignées (parce qu’elles sont censées être « jeunes ») mais en réalité, on trouve des toiles finies, encadrées, accrochées dans ces galeries. La perspective créationniste-ASC indique que le musée a été créé d’un coup (du moins en 6 jours), avec toutes les toiles déjà prêtes dans toutes les galeries. La lumière de ces galeries est instantanément arrivée dans la salle d’accueil. Dieu a créé un univers opérationnel et non en devenir.
Le Dr en physique, Derek Muller déclare:
« Vous pourriez voir des étoiles situées à des centaines d’années-lumière, non pas telles qu’elles apparaissaient il y a des siècles, mais exactement telles qu’elles sont à cet instant précis. »6
Le Dr Jason Lisle déclare:
Le Big Bang est censé avoir produit uniquement les éléments légers hydrogène et hélium, ainsi que de très petites quantités de lithium. Tous les éléments plus lourds auraient été produits plus tard, dans le cœur des étoiles massives. Si cela était vrai, alors la première génération d’étoiles aurait été composée uniquement d’hydrogène, d’hélium et de traces de lithium. Il n’aurait pas pu y avoir d’éléments plus lourds, comme l’oxygène ou le carbone, car ceux-ci ne seraient pas encore formés.
Cette première génération d’étoiles, dépourvue d’éléments plus lourds que le lithium, est appelée « population III ». De nombreuses étoiles de population III devraient consommer leur énergie si lentement qu’elles devraient encore exister aujourd’hui, même si elles se sont formées peu après le Big Bang. Pourtant, aucune étoile de population III n’a jamais été observée.
C’est remarquable, étant donné qu’il existe plus de 100 milliards d’étoiles dans notre seule galaxie, et au moins autant de galaxies dans l’univers. Toutes les étoiles observées sont soit de population II (avec quelques éléments lourds), soit de population I (avec encore plus d’éléments lourds).
La science d’observation est donc cohérente avec l’idée que l’univers a été créé avec déjà certains éléments lourds présents, ce qui est contraire aux prédictions du Big Bang, mais cohérent avec la création biblique.
https://biblicalscienceinstitute.com/apologetics/a-big-bang-part-3
Si la vitesse de la lumière à l’aller est instantanée, que se passe-t-il?
Cela signifie que la lumière d’une galaxie lointaine nous parvient immédiatement dès qu’elle est émise. Il n’y a pas besoin d’attendre des milliards d’années pour que cette lumière atteigne la Terre. Donc nous pouvons voir instantanément des galaxies situées à des milliards d’années-lumière selon le modèle standard. L’âge de l’univers (entre 6000 et 8000 ans, selon la Genèse) devient parfaitement compatible avec la vision de galaxies distantes, même très éloignées. Il n’y a aucun « problème de la lumière des étoiles lointaines ».
Objection: l’univers paraîtrait différent selon les directions observées si ASC était vrai?
Je reprends, pour répondre à cette objection, la conclusion de Lewis & Barnes, des séculiers qui ont étudié les implications d’une vitesse de la lumière infinie dans un sens:
« Dans cet article, nous avons examiné la question de l’impact de la vitesse à l’aller de la lumière sur les observations cosmologiques, en répondant à l’argument selon lequel nous devrions observer des régions du ciel ayant des âges différents si la vitesse de la lumière n’était pas la même dans toutes les directions. En étudiant l’univers FRW le plus simple — à savoir l’univers vide de Milne — on constate que la vitesse anisotrope de la lumière engendre des effets anisotropes de dilatation du temps qui compensent les différences de temps de parcours de la lumière. Dans cet univers, n’importe quel observateur verrait un univers isotrope autour de lui, même si la vitesse de la lumière ne l’est pas.
L’adepte d’une vitesse de la lumière anisotrope doit donc conclure que des galaxies à une même distance ont une vitesse de récession plus élevée dans une direction que dans l’autre, et que l’univers s’étend plus vite vers la droite ou vers la gauche. Cependant, la dépendance du décalage spectral (redshift) envers la vitesse de la lumière fait que cela ne modifie pas l’apparence du ciel nocturne. Un côté du ciel n’est pas significativement plus décalé vers le rouge que l’autre. Les vitesses initiales données aux galaxies au commencement de l’univers possédaient juste le degré d’anisotropie nécessaire pour compenser l’effet du redshift anisotrope. »
Même si la lumière met plus ou moins de temps à venir selon la direction, la dilatation du temps propre des galaxies compense, si bien que les objets paraissent du même âge partout et même si la lumière a des vitesses différentes, cela changerait à priori le redshift (plus rouge d’un côté, moins de l’autre) mais la relation entre expansion, redshift et vitesse (dans ce modèle) se rééquilibre aussi.
La « dépendance du redshift envers la vitesse de la lumière » signifie que dans leur formalisme, le redshift n’est pas traité comme une simple donnée fixe mais comme fonction de la vitesse de la lumière (unidirectionnelle) + de la synchronisation + de la métrique cosmologique. Cette dépendance est ce qui « évite » que l’anisotropie de la vitesse de la lumière n’apparaisse visuellement dans l’univers que nous voyons.
Basiquement en ESC, si on une galaxie a 1 milliard d’années lumières, on déduit qu’elle a 2 milliards d’années (1 milliard à l’émission + 1 milliard de trajet).
En ASC + créationnisme, cette galaxie située à 1 milliard d’années lumières, a été créée dans un état mature lors de la semaine de la création, il y a 6 000 à 8 000 ans, et sa lumière est arrivée instantanément.
Les intrications quantiques
Les expériences d’intrication des particules montrent que deux particules intriquées réagissent comme si elles se coordonnaient instantanément, même si elles sont séparées par des kilomètres, aucune influence mesurable ne semble voyager d’un point à l’autre à vitesse finie. On a des corrélations instantanées (ou « télépathie quantique ») ce qui ressemble à une vitesse infinie.
On peut lire sur un article dédié au prix Nobel français, Alain Aspect:7
« Une expérience réalisée en 2000 a montré que cette « communication » allait au moins à 700 000 fois la vitesse de la lumière. Les systèmes quantiques ont cette propriété que l’on appelle la non localité, c’est une propriété très importante. Même si on ne la comprend pas, on sait qu’elle est là.«
Les expériences d’intrication quantique, de John Bell à Alain Aspect montrent l’existence de corrélations instantanées, indépendantes de la distance, comme si deux particules échangeaient de l’information sans aucune limite de vitesse. La physique moderne appelle cela non-localité, et même si aucun signal exploitable ne dépasse c, le fait brut demeure: la nature permet des effets supraluminiques en apparence, défiant l’intuition relativiste classique sur la simultanéité. Ce comportement ressemble formellement à un univers où certains phénomènes sont perçus sans délai, ce qui suggère qu’une description physique peut exister sans qu’une vitesse aller-simple finie soit nécessairement mesurable ou imposée.
C’est précisément sur ce terrain conceptuel que la convention ASC de Lisle reste cohérente. L’ASC stipule que la lumière dirigée vers l’observateur peut être traitée comme instantanée sans modifier aucune prédiction physique testable, car seules les vitesses aller-retour sont observables et pertinentes expérimentalement. Or, si la mécanique quantique accepte déjà des corrélations instantanées, il n’y a rien d’absurde à adopter une convention de synchronisation qui, elle aussi, permet une perception instantanée de certains phénomènes. L’intrication ne prouve pas l’ASC, mais elle montre que la nature n’est pas strictement limitée par une propagation temporelle symétrique et isotrope, rendant l’ASC philosophiquement et mathématiquement compatible avec la physique observationnelle actuelle.
Bibliographie
Il est important de réaliser que ce concept de convention de synchronisation n’est pas spécifique et ne trouve pas son origine avec le créationnisme. L’article de la Standford Encyclopedia of Philosophy explique bien le sujet:
Indépendamment de toute motivation créationniste, de nombreux physiciens et philosophes évolutionnistes/naturalistes (Hans Reichenbach, Adolf Grünbaum, John Winnie, Michael Tooley, Sarkar&Stachel…) ont étudié l’hypothèse qu’on peut poser la vitesse de la lumière comme instantanée dans une direction (et plus lente dans l’autre), sans contradiction avec la relativité.
Reichenbach est l’un des pionniers de la thèse selon laquelle la simultanéité de deux événements spatialement séparés n’est pas fixée de façon unique par la nature, mais dépend d’une convention de synchronisation des horloges à distance.
Plus précisément, il introduit dans sa « définition ε » (epsilon-synchronisation) la possibilité que pour deux horloges A et B séparées, un signal lumineux part de A à l’instant t1, arrive à B à l’instant t2, est refleté et revient à A à t3. Il définit la simultanéité de l’événement à B comme celui qui se produit à l’instant:
tB = =t1+ε(t3−t1)
où ε est un paramètre choisi entre 0 et 1. Le choix standard Einstein correspond à ε=1/2.
Tant que seules les mesures de vitesse aller-retour sont empiriquement déterminées, le choix de synchroniser les horloges (et donc d’attribuer une vitesse « aller » spécifique) est à un degré libre, donc conventionnel.
John Winnie, dans l’article Special Relativity Without One‐Way Velocity Assumptions (1970), a développé et clarifié la thèse de la conventionnalité (via Reichenbach et Grünbaum) dans une version plus technique.
Il montre notamment que si l’on n’admet aucune hypothèse a priori sur la vitesse aller-simple de la lumière (c’est-à-dire qu’on ne suppose pas qu’elle soit égale à celle du retour), alors on peut reconstruire les effets classiques de la relativité restreinte (dilatation du temps, contraction des longueurs) sans faire appel à la vitesse aller-simple.
Le fait que Winnie puisse dériver la relativité restreinte sans supposer une vitesse aller-simple spécifique montre que les résultats empiriques de la théorie ne dépendent pas de cette convention.
Dans le modèle ASC de Lisle, on prend : ε=1, ce qui signifie que:
- le temps aller-simple depuis les étoiles vers la Terre est instantané, la vitesse c aller = ∞
- le retour, si on en faisait un, serait c retour=c/2 de sorte que la moyenne aller-retour reste c, conformément à l’expérience.
L’ASC correspond donc à une synchronisation où ce que nous recevons « maintenant » est défini comme simultané avec son émission, puisque la lumière venant vers l’observateur terrestre n’a pas de délai dans la convention temporelle adoptée. L’ASC conserve la même constante c, la même relativité, les mêmes prédictions et les mêmes technologies, GPS, physique moderne etc…
L’étude de Lewis et Barnes démontre qu’on peut avoir une vitesse de la lumière infinie dans un sens, c’est à dire anisotrope, tout en conservant un ciel isotrope, ils déclarent:8
Dans cet article, nous avons examiné la question de l’impact de la vitesse aller-simple de la lumière sur les observations cosmologiques, en réponse à l’idée selon laquelle nous devrions observer des côtés opposés du ciel présentant des âges différents si la vitesse de la lumière n’était pas la même dans toutes les directions. En analysant l’univers FRW le plus simple, l’univers vide de Milne, on constate qu’une vitesse anisotrope de la lumière engendre des effets anisotropes de dilatation du temps qui compensent les différences de temps de parcours de la lumière. Dans un tel univers, tout observateur verrait un univers isotrope autour de lui, même si la vitesse de la lumière ne l’était pas.
L’article Wikipédia sur la vitesse de la lumière dans un seul sens déclare:
…le problème reste plus théorique que pratique, car toutes les prédictions de cette théorie qui ont été vérifiées de façon expérimentale ne dépendent pas de la convention de synchronisation utilisée.
Beaucoup d’objections ASC ont à voir avec la remise en cause des expériences et des observables utilisant c, mais en réalité, peu importe la convention, les résultats restent les mêmes, c’est comme si on passe du mètre au pied ou du fahrenheit au Celsius. En cosmologie le redshift, les distances, l’expansion, utilisent c en aller-retour ou des observables qui ne requièrent pas de synchroniser deux horloges distantes. Je conseille de regarder la vidéo de Veritasium « Why No One Has Measured The Speed Of Light » pour bien comprendre le sujet.
Conclusion
La vitesse de la lumière « aller simple » n’est pas mesurable directement sans choisir une convention de synchronisation des horloges. Nous choisissons souvent la convention isotrope (vitesse de la lumière = c dans toutes les directions), mais rien n’oblige à ce choix. Le modèle ASC est mathématiquement valide et compatible avec la physique expérimentale connue. Jason Lisle dit encore dans son livre:
« Il ne peut pas y avoir de problème de lumière stellaire lointaine dans le cadre de l’ASC, puisque l’univers apparaît en temps réel. «
« Les critiques affirment que la lumière des étoiles lointaines soutient leur position et exclut la possibilité d’une création « récente » (il y a 6000 ans).
En effet, il existe des galaxies situées à des milliards d’années-lumière. Puisque la lumière se déplace à la vitesse c (c’est-à-dire qu’elle parcourt une année-lumière en un an), il s’ensuit que la lumière provenant de ces galaxies devrait mettre des milliards d’années pour atteindre la Terre.
Il ne fait aucun doute que la lumière de ces étoiles nous est déjà parvenue, puisque nous pouvons voir ces galaxies.
Par conséquent, les évolutionnistes soutiennent que notre capacité à voir la lumière des galaxies lointaines est une preuve que l’univers a des milliards d’années, et que la Genèse a tort.
Mais lorsque nous comprenons la physique d’Einstein, nous voyons immédiatement certains problèmes dans l’argument des critiques.
Ils affirment que le temps entre deux événements distants (le départ de la lumière depuis la galaxie et son arrivée sur Terre) correspond à des milliards d’années.
Cependant, ils n’ont pas précisé de référentiel, ils ont ignoré la dilatation du temps et, surtout, ils ont supposé la convention de synchronisation d’Einstein. «
Le Dr en physique créationniste, John Hartnett soutient lui aussi le modèle ASC du Dr en astrophysique Jason Lisle:
« En conclusion, il n’existe aucun problème de lumière stellaire lointaine dans le cadre de la convention de synchronie anisotrope (ASC), car l’univers apparaît en temps réel. Ce que nous appelons « maintenant » ici sur Terre est également « maintenant » partout ailleurs dans l’univers. Le langage de la Bible utilise une convention temporelle valide — l’ASC — en rapportant tous les événements tels qu’ils sont observés au moment où ils se produisent. »9
De leur côté le doctorant Tichomir Tenev et le DrJohn Baumgardner ont construit un espace-temps où cette convention est intégrée mathématiquement. Ils proposent le modèle CTC (Creation Time Coordinates) qui est une extension relativiste de l’ASC à l’échelle de tout l’univers.10 Il définit un système de coordonnées cosmiques où les « jours » de la Création sont mesurés selon le temps observé depuis la Terre. Dans ces coordonnées, la lumière venant de n’importe quelle galaxie atteint la Terre au même « Jour 4 », car le temps est défini le long du cône de lumière terrestre.
Bien évidemment, en tant que créationniste, nous ne raisonnons pas qu’avec les explications naturalistes car la création est par nature « surnaturelle ». Les lois, les constantes, les processus observés aujourd’hui ne contraignent pas le Créateur qui les a mises en place. Les paramètres en place aujourd’hui pourraient très bien avoir pris leur cours au jour 7. Une analogie simple, certes dérisoire, est que lorsqu’un développeur code une application, il y a au début peu de contraintes, peu de règles, peu de sécurité mais à la fin du processus de développement, il y a toutes sortes de mécaniques contraignantes, qui réglementent, dirigent, limitent l’utilisation du logiciel à certains cas de figures, certaines choses sont possibles et d’autres ne le sont plus.
Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu’il dit: Je jurai dans ma colère: Ils n’entreront pas dans mon repos! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde.
Hébreux 4:3
Ce verset est une puissante confirmation, dans le Nouveau Testament, du récit de la Genèse selon lequel la création a été accomplie dans le passé et ne se poursuit pas dans le présent, contrairement à ce que doivent supposer les évolutionnistes théistes, dont le modèle est en quelque sorte une création continuelle. Quels que soient les processus que Dieu a pu employer pendant les six jours de la création, ils ne sont plus en action aujourd’hui, car:
furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée…. Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant.
Genèse 2:1-3
Le récit de la Genèse ne pourrait être plus clair et précis. Pourtant, le fait qu’il soit dans le livre de la Genèse tend à le discréditer aux yeux de nombreux scientifiques et théologiens. C’est pourquoi ils préfèrent croire en une évolution continue et en de longues périodes dans le passé. Mais l’auteur de l’épître aux Hébreux confirme encore une fois la réalité d’une création achevée : « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. » (Hébreux 4:10).
L’auteur ne cherche pas à défendre la doctrine de la création achevée en tant que telle, mais il la considère simplement comme une vérité généralement reconnue. En réalité, le « repos » de Dieu après ses œuvres de la création est présenté comme un type prophétique du repos spirituel du croyant chrétien, lorsqu’il cesse de se confier en ses propres œuvres légalistes et se repose pleinement sur l’œuvre achevée de Christ pour son salut éternel.
Sur la croix, avant de mourir pour nos péchés, le Seigneur a crié : « Tout est accompli » (Jean 19:30), et notre dette pour le péché a été entièrement payée. La grande œuvre de rédemption de Dieu a été accomplie, tout comme son œuvre de création, et maintenant nous pouvons aussi nous reposer de nos « œuvres mortes pour servir le Dieu vivant » (Hébreux 9:14).
Dans la Bible nous apprenons que Dieu « ordonne, et elle [la chose] existe. » Dans Genèse 1:3 nous lisons « Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. » Dans ce contexte, nous pouvons très simplement comprendre que la création de la lumière et de l’univers tout entier est un immense miracle, sans lequel rien existerait, et qu’il n’y a pas nécessairement besoin d’une explication naturaliste à partir des lois et constantes actuelles pour comprendre comment la lumière lointaine nous a atteint.
Ce qui est intéressant de noter, sur ce sujet de la lumière distante, c’est qu’il est possible que l’explication ne nécessite pas de miracle, le modèle créationniste pourrait être défendu sans y faire appel. A ce titre, le fait que JWST ait mis le Big-Bang dans l’embarras, avec des galaxies distantes paraissant toutes aussi matures que les galaxies proches, tend à démontrer que les hypothèses qui sous-tendent le modèle naturaliste, sont défectueuses à plus d’un égard, et que le modèle biblique où « tout a été créé en une semaine », correspond aux observations.
Jason Lisle répond à plusieurs objections au modèle aux liens suivants:
- https://biblicalscienceinstitute.com/refuting-the-critics/refuting-the-critics-distant-starlight-and-asc
- A Refutation of Phillip Dennis’s Claims Regarding Alleged Inconsistencies in ASC
- A Refutation of Lisle’s “Refutation” of Dennis (2024)
On explorera l’autre piste de Phillip W. Dennis dans un autre article. Il est passionnant de voir que cette objection récurrente trouvent plusieurs solutions dans le modèle créationniste.
Références:
- https://arxiv.org/pdf/2012.12037.
- Koberlein, B., There’s no way to measure the speed of light in a single direction, phys.org, 11 Janvier 2021.
- https://arxiv.org/pdf/2012.12037.
- The Physics of Einstein: Black
holes, time travel, distant starlight, E=mc2 – page 209 – Jason Lisle. - https://biblicalscienceinstitute.com/apologetics/a-big-bang-part-2/.
- Why the Speed of Light Can’t Be Measured. Veritasium. Publié sur on youtube.com le 31 Octobre, 2020.
- Prix Nobel de physique décerné à Alain Aspect.
- https://arxiv.org/pdf/2012.12037.
- https://dl0.creation.com/articles/p130/c13060/j33_2_22-28.pdf.
- Tenev, T.G., Baumgardner, J., and Horstemeyer, M., A solution for the distant starlight problem using Creation Time Coordinates, Proc. 8th ICC, 2018.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!