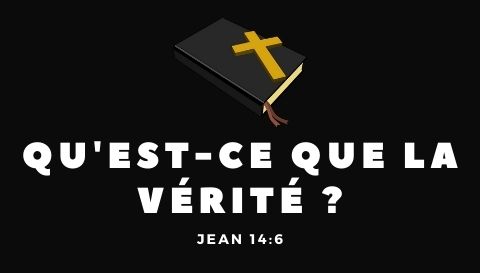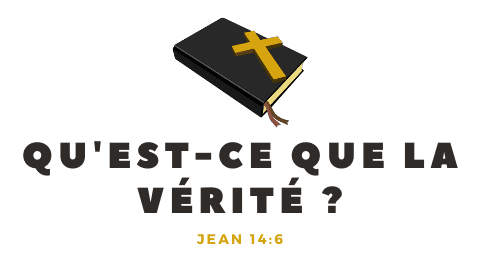Exploration d’une Nouvelle Théorie de Biologie Intelligente: Continuous Environmental Tracking (CET)
La Théorie de Conception Biologique (TOBD en anglais) est un modèle concurrent au modèle néodarwinien pour expliquer l’origine des espèces. Elle a été proposée par l’Institute of Creation Research dans les années 2010. On peut résumer en disant « l’origine des espèces par le suivi continu de l’environnement ». C’est une vision internaliste, dans laquelle les variations au sein d’organisme préexistent aux conditions qui vont les déclencher. L’environnement est un déclencheur et non un modeleur (comme c’est le cas dans le modèle externaliste de Darwin). Nous revenons ainsi avec ce modèle CET (continuous environmental tracking) à un modèle internaliste et finaliste: les organismes ont été conçus avec un potentiel de variation pour pouvoir peupler la Terre entière. Ce modèle est aujourd’hui testable et observable, nous allons voir cela dans l’article avec des exemples concrets.
QQLV soutient ce modèle depuis 2023. J’avais fait mon premier traitement dans l’article ci-dessous:
Le modèle CET
Voici le synopsis du programme de recherche biologique CET de l’ICR:

Hypothèses de recherche (cadre TOBD appliqué à la biologie)
1. Intégré : La recherche fondamentale sur les fonctions biologiques et les applications techniques associées relèvent du domaine de la pratique de l’ingénierie.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
2. Complet : Tous les systèmes biologiques liés au développement, au métabolisme, à la reproduction et à l’adaptation peuvent être rétro-conçus.
3. Instructif : Les fonctions biologiques ne peuvent être expliquées correctement que par des modèles développés selon les principes de l’ingénierie.
4. Directif : L’analyse des pratiques d’ingénierie humaine éclaire les prédictions et oriente les chercheurs vers des caractérisations précises des phénomènes biologiques.
Principes de base TOBD, attentes et inférences
But intentionnel
- Orienté : L’activité des systèmes est efficacement dirigée vers des finalités utiles. Il faut reconnaître la réalité du but.
- Cohérent : La cohérence est omniprésente. Chercher les éléments du système fonctionnant comme moyens et fins simultanément.
- Prévu à l’avance : Supposer que les traits fonctionnels vers des états finaux sont des indicateurs de planification issue de l’expérience.
- Proactif : Attendre une planification anticipée intégrant les conditions présentes, les expériences passées et les probabilités futures pour modéliser des réponses en avance.
Fonctionnement internaliste
- Unité : L’organisme dirige tous les résultats intentionnels et ne peut être réduit au-dessous de lui-même (ex. : l’ADN est un sous-système).
- Antériorité : Les traits de l’organisme déterminent ses capacités. La réussite ou l’échec sont dus aux traits, pas aux expositions.
- Déclencheurs : Les déclencheurs d’ajustement sont des capteurs internes détectant les conditions variables.
- Information : Les organismes perçoivent les expositions et extraient les données. L’environnement ne transmet pas d’instructions.
- Adaptation : L’adéquation des traits à l’environnement est optimisée via un contrôle intégré du rapport organisme/environnement.
Agentivité individualisée
- Stimuli : La programmation interne spécifie ce qui est reconnu comme stimulus. Aucun stimulus n’est indépendant. Les organismes ont des capteurs pour chaque condition définie.
- Interfaces : Les organismes communiquent avec l’environnement via des interfaces identifiables (ex. : authentification, protocole, média commun).
- Organismes comme éléments : Les organismes sont des entités discrètes interagissant via systèmes, sans perte de leur individualité.
1) « Les cochons d’Inde combattent le changement climatique en modifiant leur propre ADN » – New Scientist (2016)

Des chercheurs allemands ont exposé des cochons d’Inde sauvages à une température élevée (+10 °C pendant 2 mois environ). Ils ont constaté que ces animaux modifiaient la méthylation de leur ADN, une forme d’épigénétique qui module l’expression des gènes sans changer leur séquence .
Ces modifications n’étaient pas seulement présentes dans les tissus des parents (par exemple, le foie): certains changements étaient également observés dans les cellules reproductives des descendants, suggérant un héritage transgénérationnel .
Cela offre une preuve concrète que des mammifères sauvages répondent rapidement (quelques générations) à une contrainte environnementale par une réponse épigénétique. Le mécanisme repose sur un ajustement de l’expression génétique, non sur des mutations de l’ADN. L’ADN de base reste inchangé.
Les évolutionnistes traditionnels diront que la variation (mutation) combinée à la sélection naturelle provoque l’adaptation. Ici, cependant, l’adaptation est non-mutationnelle et rapide, ce qui montre que les modèles SN classiques ne rendent pas compte de ce type de réponse.
Ce modèle met en avant des mécanismes intrinsèques et réactifs: ici l’organisme détecte une contrainte (la chaleur) et active un programme épigénétique, un potentiel interne permettant d’ajuster l’organisme sans tri évolutif. Il n’y a pas de nombreuses mutations aléatoires et un tri de ceux qui ont eu la chance d’avoir la bonne variation. Les organismes s’adaptent tous de manière dirigée et intelligente, sans qu’aucun ne meurt et sans mutation fortuite observée.
Cette étude étaye l’idée d’un design intérieur ou d’une capacité adaptative programmée: la réponse n’est pas le résultat d’une sélection sur mutations aléatoires, mais une modulation dirigée de l’expression des gènes.
Dans cette étude, tous les cochons d’Inde exposés à la chaleur ont déclenché la même réponse adaptative épigénétique. Il n’y a pas eu de sélection naturelle ici, au sens de Darwin (des individus mourant ou n’ayant pas transmis leurs gènes). Il n’y a pas eu de mutation bénéfique apparue au hasard.
Ce que l’on observe est une programmation adaptative, déclenchée automatiquement, et héritable au moins partiellement.
Les cochons d’Inde ont été prééquipés pour détecter un changement de température et ajuster leur physiologie en conséquence, un comportement intelligent, réactif, ciblé. Ce n’est pas la nature qui les a “triés”, c’est l’organisme qui se reprogramme activement, selon les besoins environnementaux.
Ce cas illustre l’absence totale de sélection naturelle. L’adaptation est intégrée, prédictive, non aléatoire, et non létale. C’est un exemple puissant de design adaptatif, et non de filtrage évolutionnaire.
2) Les coléoptères staphylinidés et fourmis légionnaires

L’étude de Maruyama et Parker (2017) sur les coléoptères symbiotes des fourmis légionnaires constitue un exemple frappant de convergence morphologique complexe sur de très longues périodes. Dans une perspective critique issue du cadre CET (Continous Environmental Tracking), ces données ne valident pas la notion darwinienne d’un processus guidé par des mutations aléatoires et sélection naturelle aveugle. En effet, le fait que des lignées indépendantes de coléoptères aient développé à plusieurs reprises une morphologie quasiment identique, mimant précisément celle de leurs hôtes fourmis, suggère un mécanisme directionnel et programmé. Une telle répétition n’est pas attendue si les variations aléatoires sont véritablement sans direction ni finalité.
Au lieu d’interpréter ces résultats comme des « coïncidences évolutives », le CET y voit une confirmation que les organismes sont prééquipés avec des capacités internes, modulées par des déclencheurs environnementaux spécifiques, pour produire des solutions adaptatives ciblées. Cette convergence massive, anatomique et comportementale, n’est donc pas le fruit d’un bricolage aveugle mais d’un plan de réponse intégré, codé dans le génome dès le départ. En ce sens, cette étude affaiblit l’explication par sélection naturelle et soutient davantage l’idée d’un design adaptatif distribué à travers différents baramins, chacun capable d’exprimer un potentiel programmé selon les conditions rencontrées.
Plusieurs lignées très éloignées de coléoptères (Rove beetles) ont indépendamment développé le même type de morphologie mimétique, très spécifique: elles imitent les fourmis légionnaires (army ants) non seulement dans leur forme du corps, mais aussi dans leur comportement social et leur mode de vie parasitaire au sein des colonies de fourmis.
L’étude montre qu’au moins 12 lignées indépendantes ont acquis cette morphologie myrméciforme (forme de fourmi) de façon répétée dans différentes branches évolutives, censées avoir divergé depuis plus de 100 millions d’années (Crétacé).
Ce ne sont pas de simples similitudes grossières:
- les coléoptères imitent l’apparence anatomique des fourmis,
- leur mode de déplacement,
- et infiltrent les colonies pour exploiter leurs ressources, parfois en trompant chimiquement les hôtes.
Or, selon le darwinisme classique, ces traits auraient dû résulter de mutations aléatoires suivies de tri par sélection naturelle. Que cela se produise une fois serait déjà hautement improbable. Que cela se répète 12 fois de manière quasi identique dans des lignées génétiquement éloignées est un défi majeur au paradigme.
Cela suggère plutôt l’existence de modules génétiques programmés ou de schémas développementaux préexistants dans ces coléoptères, réactivés ou déployés en fonction de stimuli environnementaux (proximité avec les colonies de fourmis).
Cette répétitivité ciblée évoque davantage un plan d’ingénierie intégré, que le jeu du hasard et de la nécessité.
Ce qui est surprenant ici, c’est:
- la complexité du mimétisme,
- la répétition indépendante dans des lignées non apparentées directement,
- l’apparente finalité adaptative, sans passer par des étapes intermédiaires observables.
Ce type de convergence profonde défie la contingence historique que l’évolution est censée suivre, et alimente les modèles comme le CET.
3) Les araignées hawaïennes
L’étude rapportée par ScienceDaily (8 mars 2018), parle des araignées hawaïennes du genre Ariamnes qui ont répété « l’évolution » de trois formes distinctes (appelées écomorphes) sur différentes îles, indépendamment. Ce serait un cas frappant de « convergence évolutive répétée », avec un haut degré de précision morphologique, malgré l’isolement géographique et la séparation génétique entre populations.

Chaque fois qu’un groupe d’araignées Ariamnes colonise une nouvelle île il ne développe pas n’importe quelle forme, mais ré-instaure les trois mêmes morphologies spécifiques, qui correspondent chacune à une niche écologique précise.
Ces écomorphes se ressemblent fortement entre les îles, sans être génétiquement les plus proches entre elles: c’est une convergence fonctionnelle plutôt qu’héréditaire.
La théorie darwinienne prédit que l’évolution est contingente, dépendante de mutations aléatoires et d’un tri progressif. Les formes doivent diverger selon les contraintes historiques propres à chaque population.
Mais ici la variation est hautement prévisible, elle reproduit les mêmes solutions morphologiques, et ce, sans millions d’années ni intermédiaires visibles. Ce genre de régularité défie le caractère aléatoire que les évolutionnistes prêtent habituellement au processus évolutif.
Les chercheurs ont découvert que sur plusieurs îles hawaïennes, les araignées du genre Ariamnes se développent toujours en trois morphologies distinctes, chacune adaptée à une niche écologique particulière. Ces écomorphes sont:
- Araignées vertes
- 🟩 Camouflage dans les feuilles vivantes.
- Couleur et forme du corps adaptées pour se fondre dans la végétation.
- Occupent la canopée ou les zones feuillues.
- Araignées brunes ou sombres
- 🟫 Adaptées aux écorces d’arbres.
- Morphologie plus massive et couleur foncée.
- Se camouflent sur les troncs et branches.
- Araignées blanchâtres
- ⚪️ Adaptées aux lichens ou zones claires.
- Corps pâle, parfois avec des motifs rappelant les lichens.
- Occupent des surfaces éclatées ou rocheuses.
Dans le modèle CET proposé par l’Institute for Creation Research (ICR):
- les organismes sont programmés avec des capteurs environnementaux intégrés,
- capables de détecter certaines conditions (prédation, climat, structure de l’habitat),
- et d’activer en réponse des modules génétiques spécifiques déjà présents,
- qui déclenchent des changements ciblés, prédictibles, rapides, internes à l’organisme.
Dans ce cadre:
les écomorphes ne sont pas des produits de mutation hasardeuse triés par sélection naturelle,
mais des réponses intégrées à l’environnement, déclenchées intelligemment par l’organisme.
Un tel niveau de prévisibilité biologique pointe davantage vers un plan intégré (design), que vers des processus darwiniens aléatoires et longs.
Les araignées Ariamnes sont vues dans le modèle CET comme des systèmes autonomes intelligents, un peu comme des drones biologiques. Chaque population détecte son environnement grâce à des capteurs biologiques (lumière, structure du substrat, végétation). Ces capteurs activent des modules génétiques ou voies de régulation épigénétiques déjà présents dans l’ADN.
Le résultat est que la forme la plus adaptée à la niche est exprimée sans attendre des mutations aléatoires et un tri. Cela explique la répétition, la rapidité, la fonctionnalité et la précision des formes.
4) « L’évolution prévisible l’emporte sur le caractère aléatoire des mutations »
La recherche publiée dans Nature (« Predictable evolution trumps randomness of mutations », 2013) montre que différentes populations d’Escherichia coli, évoluant séparément mais dans des conditions identiques, aboutissent souvent aux mêmes solutions adaptatives. Malgré la nature aléatoire des mutations, « l’évolution tendrait à converger vers des adaptations similaires ».
Ici, une fois de plus, il n’y a pas de mutations aléatoires, mais plutôt les contraintes fonctionnelles et la niche (ressources, environnement). Ces dernières déterminent la trajectoire du développement et non une série de mutations fortuites.

Les souches d’E. coli distantes génétiquement développent des adaptations identiques, ce qui illustre une prévisionnisme écologique plus qu’un tri aléatoire des variantes.
Plutôt qu’un sélecteur abstrait, on observe un ajustement immédiat aux conditions.
La niche écologique (ressources, contraintes physico-chimiques) agit comme un guide de développement: les bactéries ajustent leurs fonctions ou expression génomique en réponse, sans avoir besoin de passer par un long processus de variations aléatoires suivies d’élimination.
La réplication de la même fonction adaptative à travers plusieurs lignées met en lumière un principe d’“adaptation dirigée” via la structure interne des organismes et de leurs processus biologiques, au lieu du pur hasard + sélection aveugle.
Cette étude renforce l’idée que la variation peut être prédictible et orientée, en lien avec l’environnement, plutôt que résulter de processus chaotiques et entièrement imprévisibles. Elle corrobore la perspective de la CET, qui met en avant des capacités adaptatives innées, agissant rapidement sans passer par une élimination graduelle de mutations aléatoires.
5) L’observation du suivi adaptatif des mouches des fruits

L’objectif de l’étude de Rudman et al. (2022), présentée dans Science sous le titre “Direct observation of adaptive tracking on ecological time scales in Drosophila”, était d’observer l’adaptation évolutive en temps réel dans des populations de drosophiles (Drosophila). Des mouches des fruits ont été relâchées dans 10 enceintes extérieures (« cages »), recréant des conditions naturelles saisonnières. Chaque mois, les populations ont été analysées génétiquement (fréquence des allèles) et phénotypiquement (traits sélectionnés liés à la fitness).
Les fréquences allélique et les traits liés à la survie/chance de reproduction variaient significativement d’un mois à l’autre. L’adaptation s’est déroulée en quelques générations seulement, bien plus rapidement que ne le prédirait un modèle darwinien « classique » reposant sur mutations lentes et tri graduel.
Plusieurs cages ont montré des changements génétiques indépendants mais similaires dans les mêmes régions du génome, indiquant un même « plan adaptatif » se répétant.
| Aspect | Modèle Darwinien (SN) | Modèle CET (Tracking Continu) |
|---|---|---|
| Mécanisme | Mutations aléatoires + sélection progressive | Réponse adaptative rapide, ciblée, facilité par la plasticité ou la variation préexistante |
| Rôle du hasard | Central (mutations + tri stochastique) | Limité — l’adaptation est quasi immédiate, non dépendante de premières variantes rares |
| Temps | Long (générations multiples pour changements modestes) | Court — ajustements phénotypiques visibles en quelques semaines |
| Sélection | Mort/survie, tri allèles | Réponse proactive dès exposition au changement environnemental |
C’est trop rapide pour un tri génétique classique: le phénotype évolue bien plus vite que n’importe quel tri impliquant mort ou non-reproduction.
Il y a également de la prescience génétique car plusieurs populations indépendantes s’adaptent de manière similaire. Cela parle d’un « programme de réponse » intégré et pas d’un hasard. Si l’adaptation était un ajustement progressif via sélection, on s’attendrait à plus de divergence entre populations, suivant la distribution aléatoire des mutations.
« Au cours de l’expérience, qui a duré quatre mois, les chercheurs ont documenté des changements dans 60 % du génome des mouches. Par cette observation directe d’une adaptation rapide et continue en réponse à l’environnement — un phénomène connu sous le nom d’ “adaptive tracking” — les biologistes ont établi un nouveau paradigme sur la manière de concevoir l’échelle temporelle de l’évolution. »
Penn Today, sur l’étude de Rudman et al., 2022
Cette citation reprend verbatim le concept clé de Randy Guliuzza, qui est à l’origine du modèle CET : l’adaptive tracking, qui désigne la capacité d’un organisme à détecter activement les changements environnementaux et à y répondre de manière intégrée et ciblée, sans passer par une sélection aveugle de mutations aléatoires. Le fait que 60 % du génome ait été modifié en quelques mois ne cadre pas avec les modèles néo-darwiniens traditionnels, qui postulent une lente accumulation de mutations favorables, testées par la sélection naturelle.
Ce résultat est bien plus conforme à un système interne programmé qui ajuste dynamiquement l’expression des gènes et les phénotypes associés, comme le prédit le modèle CET. En résumé, la biologie expérimentale confirme ici la perspective créationniste d’un design ingénieux, où les organismes sont conçus pour s’adapter activement, et non passivement sélectionnés.
Une adaptabilité programmée et non aléatoire
Il y a une tendance de plus en plus reconnue même au sein de certains courants évolutionnistes: l’adaptabilité observée dans la nature n’est pas aléatoire, lente, ni chaotique comme le voudrait le modèle néo-darwinien classique (mutations au hasard + sélection naturelle). Au contraire, elle est souvent:
- Régulée, contrôlée par des mécanismes internes précis (gènes régulateurs, voies de signalisation, épigénétique),
- Rapide sur quelques générations, parfois en jours ou semaines (comme chez les drosophiles ou bactéries),
- Répétable: les mêmes adaptations apparaissent indépendamment dans des contextes similaires (ex. : convergence évolutive),
- Ciblée (targeted responses): des changements spécifiques, fonctionnels et ajustés à l’environnement.
Dans le cadre du modèle CET (Continuous Environmental Tracking) développé par Randy Guliuzza, cela contredit le postulat fondamental du néo-darwinisme : que les mutations génétiques seraient aléatoires et non dirigées, et que la sélection serait seule responsable des adaptations bénéfiques.
Même certains biologistes évolutionnistes reconnaissent désormais que:
- Les mutations ne sont pas toujours aléatoires: il existe des « mutations dirigées » (e.g., CRISPR naturels, changements adaptatifs répétés),
- Les réponses adaptatives sont prévisibles: comme si le système était programmé pour détecter l’environnement et y réagir.
Le CET affirme que les êtres vivants sont conçus avec un système d’ingénierie intégré pour:
- Détecter des signaux environnementaux (comme des capteurs),
- Traiter l’information (comme un ordinateur),
- Réagir par des modifications ciblées (comme une réponse programmée).
Ainsi, au lieu de mutations aléatoires sélectionnées après coup, on a des mécanismes d’adaptation proactifs, comparables à un système de régulation intelligent, une perspective beaucoup plus compatible avec une conception intentionnelle des organismes.
L’article de revue dans Trends in Plant Science (vol. 27 • 8, août 2022, p. 733–735) met en lumière une critique montante au sein de la communauté scientifique: la remise en question de la vision selon laquelle les mutations génétiques sont purement aléatoires. Les auteurs soulignent que ce concept peine à trouver un référent empirique clair dans la nature et qu’il serait plus pertinent de considérer les mutations comme influencées ou canalisées par des processus biologiques internes.
Les mutations ne surviennent pas à l’aveugle: elles sont souvent liées à des régions spécifiques du génome, à des motifs séquentiels, ou orchestrées par des mécanismes cellulaires actifs.
Certaines zones du génome sont plus sujettes à mutation quand cela est potentiellement adaptable ; un peu comme une « régulation mutationnelle » sensible au tissu, au stress ou à l’environnement.
Cela rejoint l’idée défendue par le courant CET: l’organisme suit et ajuste activement son génome aux changements, via des réponses ciblées, plutôt qu’en attendant passivement un coup de dés puis un filtrage.
| Aspect | Modèle darwinien (SN) | Approche CET |
|---|---|---|
| Mutations | Aléatoires, aveugles | Potentialisées, régulées |
| Adaptation | Par filtrage des mutations existantes | Par ajustements dirigés selon l’environnement |
| Échelle | Lente, multi-générationnelle | Rapide, intra ou intergénérationnelle |
| Valeur sélective | Déterminée après le fait | Anticipée et guidée en amont |
Dans le cadre CET, cette publication vient renforcer l’idée que les adaptations observées, comme un “adaptive tracking” rapide, s’expliquent mieux par une réponse proactive, régulée et potentiellement instructive, plutôt que par un processus de sélection naturelle reliant seulement mutations aveugles et tri.
La revue de Trends aligne les mutations sur des processus non aléatoires ni totalement opportunistes, ouvrant une perspective où le génome serait plus qu’une simple boîte à outils stochastique. Cela renforce la position CET, qui voit l’organisme comme doté d’un pouvoir adaptatif intelligent, capable de moduler son propre héritage génétique en réponse à l’environnement.
6) Quand les microbes menacent la synthèse moderne
Dans le paradigme CET, les êtres vivants ne sont pas des entités passives soumises aux caprices du hasard et du tri environnemental, comme le propose la synthèse néo-darwinienne. Au contraire, ils sont conçus comme des systèmes adaptatifs dynamiques, comparables à des dispositifs cybernétiques dotés de capteurs internes, de mécanismes de traitement de l’information, et d’effecteurs de réponse génétique. Ce modèle s’inspire des principes d’ingénierie, où un organisme suit une logique de type entrée – traitement – réponse.
Ainsi, lorsque des conditions environnementales changent (température, disponibilité en nutriments, stress oxydatif, etc.), des signaux précis sont captés et transmis via des réseaux de régulation moléculaire, aboutissant à des réponses ciblées, souvent au niveau de l’expression ou de la modification du génome.
L’étude de Rosenberg et Fitzgerald (2019) dans PLOS Genetics souligne justement que chez certaines bactéries (comme E. coli), des mutations apparaissent de manière non aléatoire dans des régions précises du génome, notamment celles impliquées dans la réponse au stress ou dans l’adaptation métabolique. Ces mutations ne surviennent ni au hasard dans le génome, ni au hasard dans le temps, mais sont activées par des conditions de stress détectées en amont, et régulées par des circuits épigénétiques ou transcriptionnels. On parle ici de mutagenèse dirigée ou régulée, ce qui s’oppose frontalement à l’hypothèse d’un hasard absolu dans la production des variations génétiques.
Les auteurs expliquent que, contrairement à l’idée traditionnelle, les mutations ne surviennent ni de façon constante, ni de manière uniforme dans le génome, ni indépendamment du contexte environnemental. En réalité:
- Les cellules stressées, y compris par les antibiotiques, activent des réponses de stress (comme la SOS response et la sigma-S/general stress response).
- Ces réponses déclenchent une “mutagenèse ciblée”, augmentant la fréquence des mutations dans certaines régions génomiques utiles, notamment celles en lien avec la survie ou la résistance
L’article décrit un mécanisme où:
- Les mutations surviennent en “rafales”, créant des clusters localisés dans l’ADN, facilitant des changements synchronisés dans plusieurs gènes nécessaires à la résistance.
- Des sous-populations distinctes apparaissent, dont certaines sont mutables (“gambler” cells) et réactives au stress, ces cellules jouent un rôle central dans l’adaptation, en réponse directe aux signaux (ROS, dommages ADN…) générés par l’antibiotique.
Certains antibiotiques induisent des cassures doubles-brin (DSB) dans l’ADN et des espèces réactives de l’oxygène (ROS). En réponse, la cellule active des voies d’alerte (SOS + sigma-S), ce qui active des polymérases ADN à erreur (IV, V). L’ADN est réparé, mais de façon mutagène, précisément lors de stress généré par l’antibiotique
Ces observations confortent l’idée que la plasticité génétique est prévue et encadrée par des systèmes préexistants, une stratégie d’adaptation optimisée, qui évoque moins un processus d’essais-erreurs sur des millions d’années qu’une conception d’ingénierie robuste, capable de réagir avec précision à des contextes donnés. En résumé, ces mécanismes de réponse génétiquement encodés, activés en temps réel, illustrent parfaitement l’approche CET: l’adaptation n’est pas le fruit du hasard + sélection, mais le fruit d’un design adaptatif intégré.
Ces mécanismes soutiennent une vision où les organismes répondent activement aux stress, déclenchant une mutagenèse dirigée et localisée, plutôt que d’attendre l’apparition fortuite de mutations avantageuses.
Selon le modèle Continuous Environmental Tracking (CET):
- Les bactéries sont conçues avec des capteurs de stress, des voies de traitement de l’information, et des effecteurs mutagènes ciblés.
- Cela conduit à une réponse prédictible, rapide, et fonctionnellement utile, bien plus qu’un simple scénario de hasard + sélection.
En résumé, la mutagenèse induite par les antibiotiques décrite par Fitzgerald & Rosenberg est exactement le genre de mécanisme qu’attend le modèle CET: un design d’ingénierie adaptatif, encodé, non un accident aveugle de la nature. Une citation de l’étude de Rosenberg et Fitzgerald (2019) est particulièrement parlante:
« Nous soutenons que les mécanismes de mutagenèse régulée augmentent considérablement la probabilité que des mutations utiles surviennent au bon moment, augmentant ainsi la capacité d’un organisme à évoluer et, éventuellement, au bon endroit. Les hypothèses concernant une nature des mutations constante, graduelle, régulière comme une horloge, et aveugle aux conditions environnementales sont prêtes à être mises à la retraite. »
Le constat est similaire pour la résistance aux pesticides:
«Les variantes génétiques nécessaires pour résister aux différents pesticides étaient apparemment présentes dans chacune des populations exposées à ces produits chimiques.»
Francisco J. Ayala, The Mechanisms of Evolution, Scientific American, Vol. 239, Septembre 1078 p. 65
« Que se passerait-il si des biais mutationnels ou développementaux intervenaient dans le processus évolutif? »
« Pourquoi la variation a-t-elle été caractérisée comme aléatoire dès le départ ? Et que se passerait-il si des biais mutationnels ou développementaux intervenaient dans le processus évolutif? »
« On the nature of variation: random, biased and directional », tenue les 3 et 4 octobre 2017
Cette conférence remet en question un pilier fondamental du néo-darwinisme: l’idée que les variations génétiques (et donc les mutations) seraient entièrement aléatoires, sans direction, et triées a posteriori par la sélection naturelle. En posant cette question provocatrice — pourquoi a-t-on supposé la variation aléatoire comme postulat de départ ? — les chercheurs ouvrent la voie à une approche plus dirigée, conditionnée et fonctionnelle de la variation biologique.
Dans le cadre du CET, cette réflexion rejoint l’idée que les organismes sont équipés de mécanismes d’ingénierie interne, capables de détecter des changements dans leur environnement et d’y répondre via des modifications ciblées, qu’elles soient physiologiques, comportementales ou génétiques. Ces modifications peuvent être régulées et orientées, souvent de manière reproductible et rapide, ce qui contredit l’idée de mutations « au hasard » et aveugles. La prise en compte de biais mutationnels ou développementaux appuie donc l’idée que l’adaptation est activement pilotée par des systèmes conçus pour cela, ce qui cadre parfaitement avec une vision créationniste fondée sur une intelligence organisatrice initiale.
Darwin et ses successeurs ont délibérément conçu un mécanisme sans but ni direction pour rendre superflue toute intervention d’un Créateur intelligent. C’est pour cela que la variation devait être aléatoire:
Si les variations sont guidées, ciblées, ou orientées vers une fonction, alors il y a intentionalité, et donc la possibilité d’un plan ou d’un programme.
Dans ce schéma, la sélection naturelle agit comme un filtre passif, sans prévoir, ni anticiper. C’est le couple variation aléatoire + sélection naturelle aveugle qui permettait de revendiquer un processus purement naturaliste, sans design.
Mais si l’on découvre, comme dans l’étude de Rosenberg & Fitzgerald (2019), la conférence de 2017 ou les travaux sur les drosophiles, bactéries, coléoptères, etc. — que:
- les mutations peuvent être déclenchées en réponse à un signal environnemental,
- elles peuvent survenir dans les bonnes régions du génome (hotspots fonctionnels),
- elles sont parfois répétables, rapides, et orientées vers une solution adaptative,
Alors la variation aléatoire n’est plus fondamentalement nécessaire. Et l’idée même de sélection naturelle comme moteur principal perd du terrain, puisque les mécanismes internes sont capables d’anticiper et produire l’adaptation.
Les évolutionnistes se retrouvent alors dans une situation paradoxale:
- soit ils intègrent ces mécanismes ciblés, mais ils doivent abandonner l’argument selon lequel l’évolution est aveugle et sans dessein ;
- soit ils rejettent ou minimisent ces découvertes pour préserver la philosophie naturaliste du modèle.
En somme, admettre des processus ciblés revient à reconnaître que l’adaptation repose sur un système d’ingénierie intégré, ce qui soutient une vision théiste ou téléologique, précisément ce que l’évolution darwinienne voulait éviter dès le départ.
Le modèle CET (Continuous Environmental Tracking) formalise cette contradiction: il explique l’adaptation non par un tri passif d’erreurs, mais par une réponse active, programmée et intelligente des organismes, ce qui aligne les observations empiriques avec un modèle de conception intentionnelle.
7) Test du modèle de biologie intelligente
Ce que nous observons dans les êtres-vivants, c’est que les solutions précèdent les problèmes. Ce ne sont pas les défis qui « créent » la solution, mais les solutions sont déjà préprogrammées, en attente d’un déclencheur environnemental.

Par exemple dans le cas des poissons tétras, la version de surface est équipée d’une vision et elle est fortement pigmentée. La version cavernicole est aveugle et hypo-pigmentée. Les évolutionnistes disaient dans leur publication initiale qu’il avait fallu 8 millions d’années de mutations aléatoires pour que les gènes qui font la pigmentation se cassent. Des gènes cassés avaient mené à une perte de fonction.
Dans le modèle CET, nous disons que l’organisme est prévu en amont pour perdre sa pigmentation dans les grottes et pour développer d’autres capacités sensorielles pour se diriger dans un endroit sombre. Il ne s’agit pas de gènes mutés aléatoires devenant défectueux. Ce modèle est testable parce que si les gènes sont cassés, alors la pigmentation ne peut pas revenir quand le poisson est ramené à la surface.
Les chercheurs ont soumis des poissons cavernicoles et de surface à différents environnements (lumière, pH, CO₂, obscurité) et ont observé des réponses adaptatives rapides en quelques semaines, chez des individus adultes:
- Pigmentation accrue chez les poissons cavernicoles exposés à la lumière intense, suggérant l’activation d’un chemin biochimique latent de synthèse de mélanine.
- Acclimatation comportementale et physiologique des cavernicoles à des eaux riches en CO₂ (pH acide) — cohérent avec les conditions naturelles de grotte.
- Réduction de la pigmentation et détresse respiratoire chez les poissons de surface soumis aux mêmes conditions de grotte (obscurité + CO₂ élevé).
- Réponses observées à l’échelle individuelle, en l’absence d’un héritage multigénérationnel → ces adaptations ne nécessitent pas de sélection naturelle lente sur plusieurs générations.
Cette étude sur les poissons cavernicoles fournit un exemple empirique puissant du modèle CET. Les données expérimentales montrent que les organismes ne sont pas passifs face à leur environnement, mais possèdent des systèmes internes de détection et d’action conçus pour s’y adapter activement. Ce paradigme renforce une vision du vivant comme ingénierie intentionnelle et conteste l’idée que l’adaptation dépend uniquement de la sélection de mutations aléatoires.
Moran, Softley & Warrant (2015) ont démontré que la vision consomme jusqu’à 15 % du métabolisme de base durant le développement des poissons. Dans l’environnement pauvre en nutriments des grottes, la perte des yeux constitue donc une économie énergétique nécessaire, et non un hasard neutre.
Les changements: perte de pigmentation, yeux, modifications morphologiques, se produisent indépendamment dans plusieurs populations. Ce motif convergent est intuitivement plus consistant avec un programme interne ayant des trajectoires adaptatives pré-établies qu’avec l’accumulation aléatoire de mutations triées par sélection naturelle.

Les poissons cavernicoles (Astyanax mexicanus) et les poissons de surface, bien qu’ils soient interfertiles (c’est la même espèce), réagissent chacun avec leur propre palette d’adaptations, activées en fonction de leur environnement:
| Poisson cavernicole | Poisson de surface |
|---|---|
| Augmente sa pigmentation s’il est exposé à la lumière | Perd de la pigmentation en obscurité et en eau acide |
| Supporte bien l’eau acide (riche en CO₂, faible pH) | Souffre dans l’eau acide (respiration difficile) |
| S’adapte rapidement aux nouvelles conditions (quelques semaines) | Réagit aussi, mais souvent en souffrance ou en désadaptation |
Il n’y a pas besoin d’évolution lente par sélection naturelle car les réponses sont déjà programmées dans les deux morphotypes ; Chaque poisson déploie une réponse intégrée selon son environnement : lumière, pH, etc. L’environnement ne crée pas ces traits, il déclenche leur activation.
Les deux types de poissons possèdent des systèmes d’ingénierie interne différents:
- Comme des véhicules spécialisés l’un est optimisé pour les grottes, l’autre pour les rivières de surface.
- Le génome agit comme une boîte à outils adaptative.
- Cela va à l’encontre du récit darwinien d’adaptation par tri aléatoire car les changements sont ciblés, immédiats, intelligents et souvent réversibles.
Les estimations anciennes basées sur l’hypothèse de mutations aléatoires sur des millions d’années sont désormais réfutées par des mesures génétiques récentes suggérant une adaptation rapide et récente. Cela appuie une vision du vivant plus réactive, dirigée et intégrée, en ligne avec les modèles CET (~design adaptatif) plutôt qu’un processus de mutation aléatoire + sélection lente.
Source: « Testing the Cavefish Model: An Organism-focused Theory of Biological Design » (Boyle, Thomas, Tomkins, Guliuzza, 2023), publiée dans les Proceedings of the International Conference on Creationism, Vol. 9.
Les recherches montrent des adaptations rapides
Au cours des 20 dernières années, de nombreuses études ont mis en évidence l’adaptation étonnamment rapide des populations à des conditions environnementales changeantes. L’ICR a mis en exergue ces adaptations observées qui concernent une grande variété de caractères chez de nombreux types d’organismes, notamment:
- des modifications du moment de maturation et de la taille corporelle chez les guppys1,
- des caractéristiques divergentes entre les populations d’épinoche à trois épines vivant en eau douce et en milieu marin2,
- une tolérance thermique accrue chez les phytoplanctons3,
- une tolérance accrue aux métaux lourds et une résistance aux herbicides chez les plantes4,
- des modifications de la fréquence de coloration du plumage chez les chouettes hulottes5,
- des changements morphologiques dans la taille du bec et du corps chez les pinsons6,
- ainsi que des changements morphologiques chez les lézards (taille des coussinets des doigts, taille de la tête, force de morsure, voire la structure du tube digestif)78.
En contraste Darwin avait dit:
« Puisque la sélection naturelle agit uniquement en accumulant de légères variations favorables successives, elle ne peut produire aucune modification grande ou soudaine ; elle ne peut agir que par étapes courtes et lentes. »
Darwin, C. 1882. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. New York: D. Appleton and Co., 413-414.
Toutes ces adaptations observées se sont produites en réponse à des changements environnementaux en seulement quelques générations (dans la plupart des cas, en moins de 50 ans). Un article publié en 2011 a résumé les preuves croissantes en faveur de l’adaptation rapide des populations, en notant que de telles observations ont pris les scientifiques évolutionnistes par surprise :
« Rétrospectivement, on peut se demander pourquoi la correspondance entre les temps écologiques et évolutifs n’a pas été reconnue. »9
Bien sûr, si les évolutionnistes sont surpris par l’abondance de preuves d’adaptation rapide, c’est parce que le mécanisme évolutif qu’ils envisagent, la sélection naturelle, est par nature, extrêmement lent (confirmé par le dilemme d’Haldane10). Plutôt que de reconnaître le défi majeur que ce décalage représente pour la théorie néo-darwinienne, de nombreux scientifiques préfèrent intégrer ces résultats inattendus dans la théorie en adoptant des termes comme « évolution contemporaine » ou « dynamiques éco-évolutives » — une proposition selon laquelle les changements écologiques et évolutifs interagissent dans une boucle de rétroaction sur des échelles de temps observables.11
Un article de 2009 discutant de ces dynamiques éco-évolutives est même allé jusqu’à déclarer que la vision traditionnelle de l’évolution comme un processus lent est simplement erronée :
*« Des espèces aussi diverses que des algues unicellulaires, des plantes annuelles, des oiseaux, des poissons, des crustacés, des insectes et des moutons présentent des changements évolutifs contemporains rapides dans des traits qui les adaptent en quelques générations à des environnements changeants ou nouveaux… Ainsi, l’ancienne hypothèse selon laquelle le changement évolutif est négligeable à l’échelle des interactions écologiques est désormais démontrablement incorrecte. »12
Un nombre croissant de biologistes évolutionnistes reconnaissent désormais les limites conceptuelles et mathématiques du sélectionnisme, et recherchent des mécanismes alternatifs.13
Dans la perspective du modèle CET, une population atteint rapidement une solution optimale, à mesure que des « ordinateurs individuels » (organismes) exécutant le même « algorithme distribué » (sélection immanente) génèrent des « solutions » similaires (traits). Ces organismes se reproduisent ensuite et redistribuent les traits, la solution de consensus devenant dominante en seulement quelques générations. Cela permet à la population de s’adapter rapidement à des conditions environnementales changeantes ou à un nouveau milieu écologique. Tout comme dans un système informatique distribué, plus le nombre d’ordinateurs (organismes) est élevé, plus la vitesse à laquelle une solution optimale est trouvée est grande.
De plus, une population qui possède un grand effectif ou une large distribution géographique devrait développer une plus grande diversité de solutions (c’est-à-dire une diversité génétique) et pourrait ainsi s’adapter plus facilement et rapidement à un changement environnemental extrême. C’est précisément ce que de nombreuses études récentes sur l’adaptation rapide semblent démontrer.
Ce modèle d’adaptation des populations contraste fortement avec le modèle sélectionniste du néo-darwinisme. Il met l’accent sur la coopération plutôt que sur la compétition et affirme que les nouveaux traits sont générés et distribués de manière ciblée et orientée vers la résolution de problèmes, plutôt que de façon aléatoire. Ainsi, il prévoit une convergence rapide et largement observée vers des solutions, plutôt qu’un progrès lent étalé sur d’immenses périodes de temps.
Le raisonnement de l’ingénieur (modèle d’ingénierie dirigée)
Les ingénieurs conçoivent des systèmes en anticipant les défis futurs. Ils développent des stratégies adaptatives : des mécanismes de réponse prévus avant que les défis ne surviennent. Cela repose sur une logique conditionnelle du type “si… alors…” (if-then), intégrée dans les systèmes pour déclencher des réponses spécifiques à des stimuli précis. Exemples:
- Si une température monte trop haut → déclenchement d’un système de refroidissement.
- Si une forte salinité est détectée → activation d’un mécanisme d’excrétion du sel.
Ce modèle implique:
- Spécificité (réponse ciblée),
- Programmation intégrée,
- Sélectivité dirigée par une intelligence (le concepteur choisit les bonnes réponses à prévoir).
Les évolutionnistes présentent souvent l’iguane marin comme un exemple d’adaptation par sélection naturelle, où des mutations aléatoires “favorisées” au fil du temps auraient transformé une glande banale en glande excrétrice de sel, adaptée à la vie marine. Mais en réalité:
- Les iguanes marins ET de nombreuses espèces continentales possèdent déjà des glandes capables d’excréter du sodium et du potassium.
- Ces glandes ajustent rapidement et à volonté la quantité, la concentration, et la composition du fluide salin excrété.
- Cela implique:
- Un capteur interne de salinité,
- Une programmation intégrée capable de répondre immédiatement,
- Une flexibilité d’adaptation sans mutation nouvelle.
Cela ressemble davantage à un système prévu à l’avance, avec des réponses déjà programmées plutôt qu’à un système ayant lentement évolué sous pression sélective.
Le cas de l’iguane marin, par exemple, suggère que certains traits adaptatifs ne sont pas le fruit d’un long processus de sélection, mais sont activés par un système de détection et de réponse programmé, comme dans un modèle de conception intelligente ou Continuous Environmental Tracking (CET).
Références:
- Reznick, D. N. et al. 1997. Evaluation of the Rate of Evolution in Natural Populations of Guppies (Poecilia reticulata). Science. 275 (5308): 1934-1937.
- Lescak, E. A. et al. 2015. Evolution of stickleback in 50 years on earthquake-uplifted islands. Proceedings of the National Academy of Sciences. 112 (52): E7204-E7212.
- O’Donnell, D. R. et al. 2018. Rapid thermal adaptation in a marine diatom reveals constraints and trade-offs. Global Change Biology. 24 (10): 4554-4565.
- Bone, E. and A. Farres. 2001. Trends and rates of microevolution in plants. Genetica. 112-113 (1): 165-182.
- Karell, P. et al. 2011. Climate change drives microevolution in a wild bird. Nature Communications. 2: 208.
- Grant, P. R. and B. R. Grant. 2006. Evolution of Character Displacement in Darwin’s Finches. Science. 313 (5784): 224-226.
- Stuart, Y. E. et al. 2014. Rapid evolution of a native species following invasion by a congener. Science. 346 (6208): 463-466.
- Herrel, A. et al. 2008. Rapid large-scale evolutionary divergence in morphology and performance associated with exploitation of a different dietary resource. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105 (12): 4792-4795.
- Schoener, T. W. 2011. The Newest Synthesis: Understanding the Interplay of Evolutionary and Ecological Dynamics. Science. 331 (6016): 426-429.
- Le dilemme d’Haldane, formulé en 1957, montre qu’il existe une limite naturelle à la vitesse à laquelle des mutations bénéfiques peuvent être fixées dans une population par sélection naturelle, en raison des contraintes imposées par la reproduction, le temps de génération et la mortalité nécessaire pour remplacer les anciens gènes. En appliquant ce calcul aux humains, Haldane a conclutqu’il n’y aurait pas eu assez de temps, même en millions d’années, pour expliquer l’ampleur des différences génétiques entre l’homme et les grands singes. Walter ReMine, dans The Biotic Message (1993) puis dans un article de 2005, approfondit ce raisonnement en soulignant que la quantité d’information génétique nouvelle nécessaire pour produire les divers traits biologiques dépasse de loin ce que le néo-darwinisme peut expliquer. Il conclut que ce problème, ignoré par la plupart des évolutionnistes, remet fondamentalement en cause la capacité de la sélection naturelle à générer la complexité biologique observée dans le temps imparti.
- Jones, L. E. et al. 2009. Rapid contemporary evolution and clonal food web dynamics. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 364 (1523): 1579-1591.
- Jones, L. E. et al. 2009. Rapid contemporary evolution and clonal food web dynamics. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 364 (1523): 1579-1591.
- Laland, K. et al. 2014. Does evolutionary theory need a rethink? Nature. 514 (7521): 161-164.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!