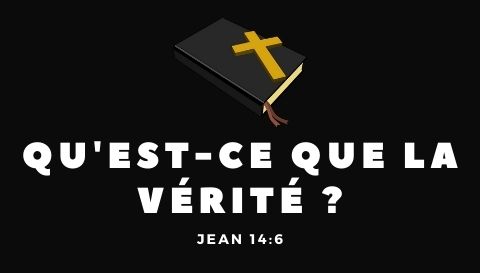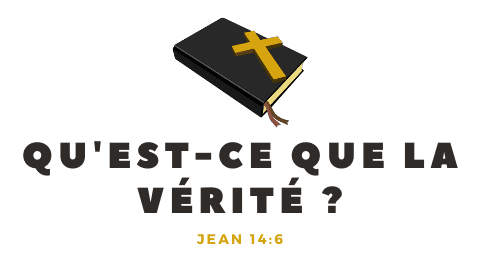Comment la Lumière des Étoiles distantes a-t-elle pu atteindre la Terre en 6 jours?
Dans le cadre du modèle créationniste Terre jeune, l’univers a été créé il y a moins de 10 000 ans. En astrophysique conventionnelle, on observe des galaxies et d’autres objets situés à des distances mesurées en millions ou milliards d’années-lumière, ce qui signifie que leur lumière mettrait un temps tout aussi long pour nous atteindre. Le problème est donc le suivant: Si l’univers n’existe que depuis quelques milliers d’années, comment la lumière provenant de galaxies situées à des millions ou des milliards d’années-lumière a-t-elle pu voyager jusqu’à nous? Cet argument est en général considéré par les créationnistes comme le meilleur argument évolutionniste.
Dans le modèle standard (basé sur la relativité et l’expansion de l’univers), le fait de mesurer des distances aussi grandes implique que la lumière a voyagé pendant des périodes bien supérieures à l’âge proposé par un modèle créationniste de la Terre jeune.
Une année-lumière correspond à environ 10 000 milliards de kilomètres, soit la distance parcourue par la lumière en un an (300 000 km/sec). Ne faudrait-il donc pas des milliards d’années pour que la lumière des étoiles lointaines nous parvienne?
Le débat évolution VS création
Le débat évolution VS création fait rage depuis plusieurs décennies. Le point faible de la science créationniste, jusque là, a toujours résidé dans ce problème difficile à résoudre de la lumière des galaxies distantes, un point que les évolutionnistes n’ont jamais failli à évoquer. Les créationnistes ont proposé des solutions. Nous allons en reparler plus bas.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
D’un autre côté les créationnistes ont également mis en lumière les nombreux points de vulnérabilité de la théorie de l’évolution, comme la présence de tissus mous et de biomatériaux variés dans les fossiles de dinosaures, le carbone 14 dans les fossiles, le manque d’érosion entre les couches sédimentaires, les « fossiles-vivants », le paradoxe du jeune soleil faible, la distance entre la Terre et la lune, le manque d’étapes intermédiaires incontestables dans le registre fossile, les plis de roche, le taux d’érosion des continents, le niveau de salinité et de boue dans la mer, le taux de décroissance du champ magnétique, la formation rapide « observée » de canyons etc… Des dizaines d’articles sur le site QQLV explorent ces sujets.
Propositions de solutions dans le modèle créationniste
Variation de la vitesse de la lumière
Certains proposent que la vitesse de la lumière a été beaucoup plus élevée durant les 4 premiers jours de la création. Cela aurait permis à la lumière d’atteindre la Terre en un temps plus court que ce que l’on suppose actuellement.
Dr Humphreys indique que trois éléments présents dans le récit de la création dans Genèse 1 suggèrent que pendant les quatre premiers jours de la création, la vitesse de la lumière dans le ciel était extraordinairement plus rapide qu’elle ne l’est aujourd’hui. Parallèlement, les indices provenant du texte biblique (y compris le passage d’Exode 20:11, qui fait référence à la création en six jours) indiquent que les jours de la création sur Terre ont eu une durée « ordinaire » (similaire à nos jours de 24 heures).
D’après la relativité générale et divers résultats expérimentaux, la « vitesse du temps » (c’est-à-dire le rythme auquel le temps s’écoule) est liée à la vitesse de la lumière. Puisque sur Terre la vitesse de la lumière semble avoir toujours été la même (celle que nous mesurons aujourd’hui), la durée des jours de la création y était normale.
En revanche, si la vitesse de la lumière dans les cieux était des trillions de fois plus élevée pendant les quatre premiers jours, alors la lumière aurait pu parcourir des distances immenses en un laps de temps très court. Cela permettrait qu’en dehors de la Terre, des événements correspondant à des « milliards d’années » de développement se soient produits pendant ces mêmes jours de création.
Selon la relativité générale, la vitesse à laquelle s’écoule le temps dépend du champ gravitationnel : plus on est dans un champ fort (comme près de la Terre), plus le temps s’écoule lentement, tandis que dans des régions de faible gravité (comme en profondeur dans l’espace), les horloges pourraient « tourner » plus vite. Le physicien Dr. Russell Humphreys a proposé que la dilatation temporelle gravitationnelle pourrait permettre que, dans l’espace profond, le temps s’écoule beaucoup plus rapidement qu’au niveau de la Terre.
De nombreux créationnistes pensent que la théorie de la relativité d’Einstein, qui permet aux horloges de fonctionner à des rythmes différents, est la clé pour résoudre ces mystères. Dieu aurait pu permettre aux horloges de l’espace lointain de fonctionner à des rythmes beaucoup plus rapides afin de permettre à la lumière des étoiles lointaines de nous atteindre au jour 4 de la semaine de la création.
Distorsion ou contraction de l’espace-temps
Une autre proposition est que l’espace lui-même aurait été « contracté » ou déformé au moment de la création, de sorte que les distances réelles parcourues par la lumière auraient été bien plus courtes qu’elles ne le paraissent aujourd’hui. Cette approche nécessite de modifier radicalement notre compréhension de la géométrie de l’univers et reste très spéculative dans le cadre des postulats créationnistes.
Création immédiate de la lumière en transit
Certains soutiennent que Dieu aurait créé non seulement la Terre et l’univers, mais aussi la lumière en transit, c’est-à-dire que la lumière voyageant depuis des objets lointains aurait été placée « en route » dès la création pour apparaître conforme aux observations actuelles. Cette idée soulève des questions théologiques sur la manière d’opérer de Dieu dans l’histoire.
La nature « surnaturelle » du modèle de la Genèse
Notons que dans le modèle biblique, la création est un événement surnaturel, un miracle, il est donc difficile voire impossible de l’envisager dans un cadre strictement « naturel ». Le mode « naturel » est enclenché au jour 7, pas avant. Le but était que l’univers soit achevé en 6 jours afin de rendre la conception entièrement fonctionnelle pour ses habitants fraîchement créés.
Le texte hébreu de la Genèse affirme que la lumière des étoiles a été émise le quatrième jour de la semaine de la création et qu’elle est également arrivée le même jour. Peut-être que c’était un miracle, ou peut-être que les lois de la physique établies par Dieu ont permis à la lumière lointaine de nous atteindre naturellement en peu de temps. Dans ce dernier cas, la solution implique presque certainement la théorie de la relativité d’Einstein, et les scientifiques créationnistes ont proposé un certain nombre de suggestions quant à la manière dont Dieu a pu faire cela.
Il est au moins théoriquement possible que la lumière qui provient d’étoiles lointaines nous parvienne encore rapidement aujourd’hui. Si tel était le cas, l’explication correcte ne serait pas un miracle lors la semaine de la création, puisque Dieu avait terminé son œuvre créatrice à la fin du sixième jour (Genèse 2:1-2). Dans ce cas, l’explication pourrait être compréhensible en termes de physique normale. Même si Dieu utilisait un miracle pour nous faire parvenir rapidement la lumière des étoiles, il est peut-être possible de comprendre les effets du miracle.
Disons également que les premiers arbres et les premières plantes ont poussé rapidement, en accéléré, et non sur des mois ou des années comme cela a été le cas depuis le jour 7 de la création jusqu’à nos jours. Il en est de même pour les deux premiers humains et les premiers couples d’animaux. Dieu a créé Adam adulte et non pas au stade bébé. Les premiers bébés de l’histoire ont été Abel et Caïn. Le démarrage de l’univers est surnaturel dans la Bible. On ne part pas d’une vie monocellulaire (ce qui en soi demande aussi un miracle).
Il convient de noter que le modèle du Big Bang a sa propre version de ce problème cosmologique. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les cosmologistes séculiers ont ajouté la théorie de l’inflation au modèle. Mais la théorie de l’inflation est devenue si étrange que même des scientifiques séculiers l’ont sévèrement critiquée.1
Le James Webb Space Telescope (JWST) et l’infrarouge

Le JWST est un télescope conçu pour observer dans le domaine de l’infrarouge. Cela lui permet de capter la lumière décalée vers le rouge émise par des galaxies très lointaines. Ce décalage est dû à l’expansion de l’univers, qui « étire » la lumière émise par ces galaxies et la déplace hors du spectre visible vers l’infrarouge. En conséquence, le JWST peut obtenir des images de ces galaxies lointaines avec une qualité et un niveau de détail souvent supérieurs à ceux obtenus par le télescope Hubble.
Des galaxies lointaines « trop matures »
Selon le modèle du Big Bang, la lumière des galaxies les plus éloignées aurait voyagé pendant presque 14 milliards d’années. On s’attend donc, avec le puissant télescope James Webb, à voir ces galaxies telles qu’elles étaient à une époque très jeune, c’est-à-dire « non évoluées » ou « immatures », en raison du peu de temps écoulé pour leur formation et leur évolution. Les images du JWST montrent pourtant des galaxies qui paraissent déjà « matures » et « développées », ce qui contredit les prédictions des cosmologistes du Big Bang.
Révisions constantes des chronologies
Les défenseurs du modèle du Big Bang ont récemment revu à la baisse les estimations concernant l’apparition des premières étoiles et galaxies.
- Par exemple, il y a quelques années, la NASA évoquait la formation des premières étoiles il y a environ 400 millions d’années après le Big Bang.
- Des études plus récentes proposent que ces premières étoiles seraient apparues dès environ 250 millions d’années, voire 200 millions d’années après le Big Bang.
Ces ajustements successifs indiquent une difficulté à concilier les observations (la présence de galaxies évoluées) avec les prévisions théoriques du modèle du Big Bang.
Profondeur d’observation et persistance des galaxies
Si le Big Bang est correct, des télescopes de plus en plus puissants devraient éventuellement révéler des régions de l’univers très jeunes où aucune étoile ou galaxie n’était présente. Cependant, les observations semblent montrer que, quelle que soit la profondeur d’observation, des étoiles et des galaxies sont toujours présentes, ce qui pose la question de l’absence de périodes « vierges » dans l’univers visible.
Pour lire la suite de l’article veuillez vous inscrire ou vous connecter si vous avez déjà un compte:
Notes:
- Ijjas, A., P. J. Steinhardt, and A. Loeb. Cosmic Inflation Theory Faces Challenges. Scientific American.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!