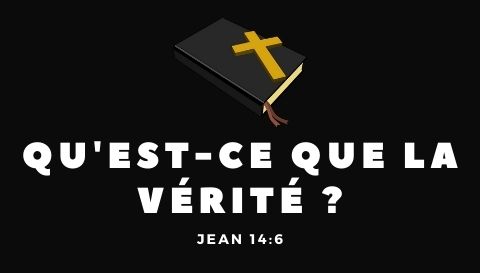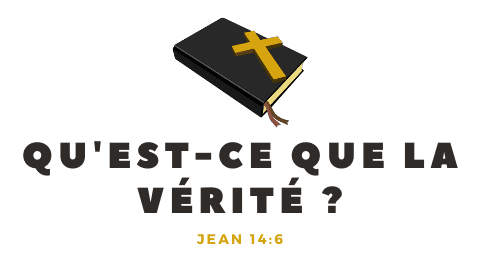Humains et Chimpanzés: l’Eternel Combat Évolutionniste de l’Ascendance Commune
L’argument évolutionniste va comme suit « les humains et les chimpanzés sont similaires génétiquement à hauteur de 98 ou 99%, vous devriez donc les grouper dans le même genre (baramin) ». A en considérer les analyses de Jeff Tomkins, Richard Buggs et l’étude de nature (2025), les humains et les chimpanzés sont plutôt similaires à 85%. Les code-barres ADN montre également une dissociation nette de 10 à 15% entre les deux espèces. On y ajoute que les gènes similaires peuvent s’exprimer très différemment, ce qui montre bien qu’un même piano peut produire des mélodies très différentes.
La génétique est un indice mais elle n’est pas déterminante en soi, dans le modèle biblique le critère majeur est le continuum reproductif entre deux espèces. Celui-ci est renforcé ou compensé par les continuum morphologiques et comportementaux. Quand nous prenons en compte tous les paramètres, nous percevons que les critères de la baraminologie ne permettent pas de placer ensemble humains et chimpanzés. La divergence de classification créationniste et évolutionniste, ne s’arrêtent pas là, car d’autres groupements évolutionnistes ne sont pas acceptés par les créationnistes pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le cas du chimpanzé et de l’homme.
La comparaison entre chat et tigre devrait elle nous pousser à classer humains et chimpanzés dans le même groupe?
Dans le logiciel évolutionniste, on est naturellement obsédé par la volonté de faire des liens entre les organismes (ce qui visiblement n’est pas aisé compte tenu de la pléthore de gènes uniques). En créationnisme on est pas soumis à cette exigence. Deux organismes peuvent être très différents génétiquement et pourtant appartenir au même genre (après des milliers ou centaines d’années de spéciation) et deux autres organismes très similaires génétiquement peuvent appartenir à des baramins différents.
La logique évolutionniste est de dire: même s’il y a 15% de différence entre l’humain et le chimpanzé, s’il y en a 15 ou 20 entre le chat le tigre (que vous incluez dans le même baramin) alors vous devez aussi inclure humain et chimpanzé dans le même baramin. C’est une compréhension simpliste du génome.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:

Notons qu’un chat et un tigre ne peuvent pas se reproduire ce qui peut se comprendre compte tenu de la différence de taille. Pourtant le chat peut se reproduire avec le serval alors qu’il y a autant de différence, si ce n’est plus, qu’entre le chat et le tigre. Le chat et le tigre sont génétiquement plus proches et plus compatibles sur le plan chromosomique que ne le sont l’homme et le chimpanzé mais les différences structurelles empêchent la reproduction. On note également une taille de génome identique entre tigre et chat mais différente entre humain et chimpanzé. Tout ça pour dire que la raison de l’hybridation impossible entre chat et tigre n’est pas la même raison de l’hybridation impossible entre homme et chimpanzé. On peut être infertile pour plusieurs raisons: si on est a des extrémités d’un même arbre ou si on appartient à des arbres différents.

Ce n’est pas que l’humain qui n’est pas classable dans le genre chimpanzé, mais aussi les gorilles et les orangs outans (baramins différents). L’incapacité à se reproduire, le nombre de chromosomes différents, il y a des barrières nettement plus infranchissables qu’entre chat et tigre.

Les touches du piano ne nous expliquent pas la musique jouée, c’est la partition qui compte (l’expression et la régulation des gènes via les mécanismes épigénétiques). Des instruments différents peuvent jouer des musiques semblables et des instruments identiques peuvent jouer des musiques très différentes.
Le génome a un fonctionnement extrêmement complexe: avec la géophysique c’est probablement l’un des domaines les plus compliqués dans le monde de la science. Plus on ouvre des livres de génétique, plus on doit apprendre des termes techniques et ça ne s’arrête jamais: on dit que la complexité d’une cellule dépasse la complexité d’une ville comme New York. C’est âprement plus compliqué que de comparer des génomes et d’en tirer des conclusions évolutionnaires simplistes.
En particulier, si ces comparaisons ADN sont importantes pour les évolutionnistes, ils devraient réfléchir à ce que signifie 15% de différence entre chimpanzé et humain et ils verraient que créer 400 à 500 millions de différences entre 6-7 millions d’années (principe du gradualisme) est hors de portée compte tenu des taux de mutations (qui en plus sont généralement nuisibles).
Pour ce qui est de la variation post-déluge, je pense qu’il est bien documenté que la spéciation peut se faire très rapidement en quelques décennies à quelques siècles (exemple parlant avec les chiens notamment) mais aussi des pinsons, des guppys, des lézards, tous sont connus pour une spéciation très rapide.
Les pourcentages de divergence ne sont pas l’unique critère pour délimiter les groupes créés. On ne sépare pas les baramins uniquement sur la base du taux de différences génétiques, mais sur la base d’un faisceau d’indices, notamment:
- Aucune inter-fécondité homme-chimpanzé (contrairement aux gorilles entre eux).
- Discontinuités fonctionnelles majeures: langage, culture, abstraction, conscience morale…
- Présence de gènes orphelins et fonctions uniques à l’humain (ou au chimpanzé), sans antécédent évolutif clair.
- Barrières claires et stables dans l’histoire humaine: il n’a jamais existé de forme de transition reproductible ou historique entre les deux.
Tandis que les différences entre gorilles se produisent à l’intérieur d’un continuum reproductif, les différences entre humains et chimpanzés s’inscrivent dans une discontinuité radicale, tant morphologique que comportementale, génétique ou spirituelle (dans une perspective théologique).
Le degré de différence n’est pas seul décisif. C’est la nature, la combinaison et la structure de ces différences et surtout la présence ou non d’un pont reproductif ou fonctionnel qui permettent de poser une barrière baraminologique.
Comparaison n’est pas raison
Il ne faut pas une vision simpliste du génome. Il est démontré que des créatures proches morphologiquement peuvent être très éloignées génétiquement et que des créatures éloignées morphologiquement peuvent être proches génétiquement. Cela indique que la comparaison n’est pas raison. Il faut comprendre que deux gènes similaires partagés par des groupes différents n’est pas un constat significatif: d’une le concept des principes communs, dans le créationnisme, s’explique par un concepteur en commun. Il n’y a donc aucune raison, et aucune prédiction créationniste que, par exemple, chimpanzés et hommes doivent être drastiquement différents. Un même piano peut produire des milliards de mélodie.
La baraminologie ne repose pas sur un critère unique universel (comme un pourcentage d’ADN), mais sur un faisceau d’indices convergents: hybridation possible, discontinuités génétiques et morphologiques, fonctions biologiques, écologie. Il est donc logique qu’on ne puisse pas comparer deux baramins selon une règle unique de distance génétique. Ce n’est pas une faiblesse, c’est un choix méthodologique cohérent avec le rejet de la filiation universelle darwinienne.
Concernant l’homme et le chimpanzé, les différences sont nombreuses: pas d’hybridation possible, phénotypes radicalement différents, régions non alignables importantes (environ 13-15 % selon Yoo et al. 2025), gènes orphelins spécifiques. Il y a donc une vraie discontinuité, contrairement à d’autres groupes, où l’on a des ponts reproductifs ou morphologiques.
Quant à l’arche, seuls les représentants des baramins nephesh y étaient. La diversité actuelle s’explique par une spéciation rapide, basée non sur des mutations aléatoires, mais sur des mécanismes intégrés (CET, recombinaison, activation de gènes latents…).
Enfin, même les évolutionnistes reconnaissent aujourd’hui que le fameux “1 % de différence” est faux, que les gènes orphelins sont fonctionnels et que le junk DNA est dépassé.
Des divergences élevées entre gorilles
Les pages 26–27 de l’étude Nature 2025 (Yoo et al.) rapportent des gap divergences élevées entre certains gorilles. Cela montre bien que la discontinuité n’est pas linéairement corrélée à la taxonomie classique, et c’est justement l’un des constats favorables à une approche baraminologique: certaines espèces dites proches montrent des discontinuités importantes, et certaines espèces dites éloignées montrent des similarités surprenantes. Cela va contre l’idée d’un arbre universel fluide.
Sur le 6,4 % de non-alignement entre humains de l’étude, attention cette valeur ne s’applique pas entre deux individus normaux. Elle inclut des comparaisons avec des haplotypes rares, des zones hautement variables ou non fonctionnelles. Les estimations standard entre deux humains sont de l’ordre de 0,1 à 0,4 % de SNV. Le chiffre de 6,4 % vient d’approches incluant des haplotypes structuraux très divergents, et cela ne veut pas dire que ces humains ne sont pas apparentés. Personne ne le pense.
Ce qui est frappant, c’est que le total entre humains et chimpanzés est bien d’environ 15 %, ce qui équivaut à plusieurs centaines de millions de différences brutes. Même en supposant des insertions/délétions ponctuelles, cela représente une charge génétique colossale à expliquer en 6–7 millions d’années. Les taux de mutation connus (1–1.2×10⁻⁸ par site et par génération) ne permettent pas d’arriver à une telle divergence, surtout quand les différences touchent aussi les éléments régulateurs, les ORFs, les structures 3D du génome.
Enfin, je comprends l’argument que les SNVs sont plus “alignables”, mais pourquoi alors affirmer que le génome est à 98–99 % identique, comme cela a longtemps été dit, si l’on sait que 13 % du génome est inalignable? C’est là le vrai problème, l’impression de proximité a été entretenue par une présentation partielle des données, alors qu’aujourd’hui même les chercheurs reconnaissent que la divergence est bien plus large que ce qui était affirmé. C’est cette discontinuité réelle qui alimente une remise en question légitime du postulat de filiation directe.
Le créationnisme baraminologique n’est pas gêné par des variations internes à un même groupe (comme chez les gorilles), mais s’intéresse aux discontinuités globales, comme celles observées entre hommes et chimpanzés.
L’analogie avec des choux tétraploïdes
Dans les organismes polyploïdes (comme certains choux, fraises, etc.), les insertions/délétions massives peuvent rendre les alignements difficiles, voire irréalisables, et fausser les mesures de divergence. Cela est tout à fait vrai dans le cadre de la comparaison d’organismes à complexité génomique radicalement différente, ou avec des duplications entières de génome.
Mais cette analogie ne s’applique pas dans le cas de la comparaison homme–chimpanzé. Ces deux espèces ont le même niveau de ploïdie (diploïdes), ils ont des tailles de génome similaires, et ne présentent pas de duplications massives récentes comparables à celles des tétraploïdes végétaux.
Par conséquent, l’analogie avec des choux tétraploïdes n’est pas pertinente ici. Chez les humains et les chimpanzés, les gap divergences ne reflètent pas simplement des artefacts d’alignement dus à la ploïdie, mais bien des zones entières non homologues, souvent non retrouvées dans l’autre génome, même avec des assemblages complets (telomere-to-telomere). Autrement dit, ce ne sont pas juste des décalages techniques, mais des régions réellement absentes ou distinctes.
Ensuite, l’argument selon lequel les indels se font en une fois et donc ne représenteraient qu’un seul “événement évolutif” n’efface pas le problème fondamental. Si l’on admet qu’il faut expliquer 13,3 % de séquences inalignables, cela implique quand même l’apparition (ou la disparition) d’énormes blocs fonctionnels, souvent riches en promoteurs, gènes orphelins, séquences régulatrices, etc. Même s’il s’agissait d’un seul événement ponctuel, l’information génétique apparue ou disparue est considérable et nécessite une explication mécanistique, pas seulement une déclaration de type “c’est une indel”.
Enfin, l’argument: “on n’utilise que les SNV pour les parentés” n’est pas tout à fait honnête scientifiquement. On utilise les SNVs parce qu’on sait les aligner plus facilement, mais cela a biaisé historiquement les estimations de proximité. Si 13 % du génome est non-alignable, ignorer cela dans les calculs de proximité revient à travailler avec des œillères. Les auteurs de l’étude de Nature 2025 (Yoo et al.) le reconnaissent eux-mêmes: les anciennes estimations de 1–2 % de divergence ne tenaient pas compte des gap divergences.
Donc non, il ne s’agit pas d’un simple artefact comme chez les choux. Ce sont des différences réelles, dans des génomes comparables, qui mettent en cause la narration d’une filiation linéaire en seulement 6–7 millions d’années.
Le génome n’est pas un simple amas de molécules: il contient un code symbolique, des instructions organisées, des circuits de régulation intégrés, et des gènes spécifiques sans ancêtre (gènes orphelins). Aucun processus aléatoire ne produit ce genre de système fonctionnel et hiérarchisé. Tout cela pointe clairement vers un dessein intelligent, pas vers le hasard ni le temps.
Des humains très différents génétiquement entre eux?
Comparer les 6,4 % de non-alignement entre humains à 13,3 % entre humain et chimpanzé (étude Nature 2025) est trompeur, les premiers incluent surtout des haplotypes rares, des régions non codantes ou structurales très variables, donc sans impact fonctionnel majeur, alors que les 13,3 % entre humains et chimpanzés contiennent de nombreuses séquences codantes, gènes orphelins et fonctions spécifiques, sans trace évolutive intermédiaire.
Le chiffre seul ne suffit pas, c’est la nature des différences qui compte. Deux régions non alignées peuvent être longues mais insignifiantes chez deux humains, et courtes mais critiques entre espèces. Le même pourcentage n’a pas la même signification biologique ni historique.
La baraminologie se base justement sur ces discontinuités « qualitatives »: capacité de reproduction, fonctions uniques, gènes sans homologue. Le modèle darwinien suppose une continuité progressive, or ce sont précisément ces discontinuités, fonctionnelles, non aléatoires et spécifiques, qui le remettent en cause.
Je n’ai personnellement eu aucun souhait à élargir les différences entre chimpanzés: un même piano peut produire des milliards de mélodies différentes. Le niveau de ressemblance génétique n’est pas déterminant en soi. Je constate juste que Nature a confirmé les approches de Tomkins et Buggs.
Les gènes orphelins chez les chimpanzés sont souvent fonctionnels, spécifiques, et absents chez l’humain, sans précurseur connu. Ce n’est pas comparable à de simples variants intra-humains. Le fait que ces différences soient structurellement codantes, adaptatives, et sans trace d’évolution graduelle suggère non une transition, mais une discontinuité.
Le DNA barcoding (ou « codage à barres de l’ADN ») est une méthode rapide et standardisée d’identification des espèces basée sur une courte séquence génétique unique que l’on appelle un code-barres ADN, comme un « identifiant moléculaire ».
D’un point de vue barcoding, humains et chimpanzés appartiennent à deux espèces totalement distinctes, sans zone grise.
Ce point est visuellement évident dans les arbres génétiques basés sur le COI(cytochrome c oxydase I):
- Les humains forment un groupe compact, très resserré,
- Les chimpanzés forment un groupe distinct, bien séparé,
- Pas de chevauchement, pas de transition, pas de spectre évolutif intermédiaire.
| Comparaison | Résultat barcoding (COI mtDNA) |
|---|---|
| Humain vs Humain | ~<1% de variation (très faible) |
| Chimpanzé vs Chimpanzé | ~2–3% de variation |
| Humain vs Chimpanzé | ~10–15% de différence (net) |
| Interprétation | Espèces clairement distinctes, sans recouvrement génétique |
Proche génétiquement mais éloigné morphologiquement et inversement
Les créationnistes ne sont pas incohérents en refusant de placer humains et chimpanzés dans le même “genre”, car ils appliquent les mêmes critères à tous les cas, même quand cela va à l’encontre de certaines proximités génétiques alléguées par l’évolution. Exemple :
- Taupe dorée vs éléphant, ils sont proches génétiquement selon les évolutionnistes (Afrotheria), mais les créationnistes les classent séparément: trop de différences morphologiques, pas de reproduction possible, fonctions radicalement différentes.
- Chauve-souris vs cheval sont également regroupés par la génétique évolutive (Laurasiatheria), mais aucun lien fonctionnel ni reproductif, il s’agit de baramins distincts.
Les évolutionnistes eux-mêmes doivent admettre que la taupe marsupiale (Australie) n’a aucun lien de parenté directe avec les taupes placentaires ou les taupes dorées, même si elles se ressemblent énormément. On invoque donc la convergence évolutive. Mais du point de vue créationniste:
❝ Pourquoi faire appel à des évolutions aléatoires ayant « recréé » trois fois le même plan corporel pour des animaux sans lien entre eux… si la solution la plus simple est un design commun fonctionnel? ❞
La convergence évolutive suppose que des mutations aléatoires ont produit trois fois le même résultat, sans lien héréditaire ce qui est hautement improbable statistiquement.
En revanche, un Créateur intelligent peut réutiliser un plan corporel optimisé (ex. : corps fuselé pour nager, griffes pour creuser) dans plusieurs créatures sans les faire dériver l’une de l’autre. Ce que les évolutionnistes appellent « convergence », les créationnistes y voient plutôt la signature d’un Créateur appliquant des designs efficaces à des contextes fonctionnels semblables.
La génétique est un indice, mais pas un critère absolu. Elle doit être interprétée en conjonction avec:
- La capacité de reproduction (critère majeur),
- L’anatomie,
- Le comportement,
- Les structures embryologiques,
- La discontinuité statistique.
Des chercheurs comme Dr. Nathaniel Jeanson (AIG) ou Dr. Rob Carter (CMI) ont montré que les codes-barres ADN permettent d’identifier des groupes d’organismes bien délimités, avec peu de variation interne, ce qui correspond aux baramins bibliques.
La majorité des espèces modernes semblent provenir de « pools génétiques fondateurs récents », ce qui correspond au modèle post-Déluge (repeuplement rapide à partir des survivants de l’Arche). Des études sur des milliers d’espèces montrent que :
- La variation génétique intra-groupe est faible,
- L’apparition des groupes semble simultanée sur l’échelle génétique (moins de 10 000 ans).
Humains, éléphants, moineaux, mouches, etc., ont chacun un code-barre distinct, non chevauchant, mais très cohérent en interne, compatible avec des types créés fixes, chacun ayant des marges de variabilité.
Il est temps de réaliser que la similitude génétique (qu’elle soit à 85 ou 95% n’est pas déterminante). Le regroupement génétique inattendu de l’éléphant, du lamantin et de la taupe dorée (Afrotheria), malgré leurs morphologies totalement divergentes, montre que la ressemblance physique n’est pas toujours liée à une parenté génétique réelle (les animaux citées sont classées ensemble malgré des différences colossales morphologiquement).
À l’inverse, des animaux très semblables comme la taupe dorée et la taupe classique ne sont pas du tout apparentés selon l’ADN. De même, le dauphin et le requin, tous deux profilés pour la nage rapide, ne partagent aucune ascendance commune récente selon le modèle évolutionniste: leur ressemblance est due à une « convergence fonctionnelle ». Des créatures différentes peuvent partager des solutions similaires parce qu’elles ont été conçues pour remplir des fonctions analogues dans des environnements similaires, sans relation évolutive directe.
Cela montre que la similarité ne prouve pas une origine commune. Si des formes très différentes (éléphant, taupe dorée) peuvent être proches génétiquement, et si des formes similaires (homme et chimpanzé) peuvent, selon la logique évolutive même, avoir développé leurs ressemblances de façon parallèle ou fonctionnelle, alors il n’y a aucune raison objective de forcer l’ascendance commune entre l’homme et le singe. Le modèle créationniste considère ces groupes comme distincts dès l’origine, et l’apparente proximité génétique (ce qui reste assez vrai même à 85%) peut refléter un design commun, tout comme un ingénieur peut réutiliser des modules similaires pour des machines très différentes.
Bien que les humains et les chimpanzés partagent de nombreux gènes similaires, leur expression génétique diffère souvent de manière profonde, en particulier dans le cerveau. Des études ont montré que ce ne sont pas tant les séquences des gènes elles-mêmes qui expliquent les différences majeures entre les deux espèces, mais plutôt la manière dont ces gènes sont activés, désactivés, et régulés au cours du développement et dans les différents tissus.
Par exemple, certains gènes sont exprimés à des niveaux beaucoup plus élevés dans le cerveau humain que chez le chimpanzé, ou sont activés à des moments différents de la croissance. Ces variations dans la régulation, souvent situées dans des régions non codantes de l’ADN (comme les promoteurs ou les enhancers), produisent des effets significatifs sur la morphologie, le comportement et les capacités cognitives. Cela remet en question l’argument selon lequel une forte similarité génétique impliquerait nécessairement une origine commune, et soutient au contraire, dans une perspective créationniste, l’idée d’un design dirigé, utilisant des briques biologiques communes mais orchestrées de manière unique chez l’homme.
Dans le modèle créationniste, la présence de modules génétiques similaires dans des organismes très différents est interprétée non comme le résultat de l’évolution aléatoire et graduelle, mais comme le fruit d’un design intentionnel et modulaire, où Dieu aurait équipé chaque « kind » de capacités d’adaptation contextuelles. Le critère régional (comme l’Afrique pour les Afrotheria) peut alors refléter une activation contextuelle de modules génétiques communs, sans impliquer de parenté évolutive.
Nous ne sommes pas limités créationnistes aux études moléculaires, sujettes à interprétation. Les 126 scientifiques de Nature avaient bien sûr à cœur de confirmer l’évolution. Un objectif fixé est souvent atteint. Les créationnistes savent dissocier les données brutes de la rationalisation qui s’en suit pour les harmoniser avec le modèle initial. Il est évident que les évolutionnistes se seraient bien passés de ces 15% de différences, il faut maintenant composer avec. Le fait que des créationnistes (et pour honnête des gens non créationnistes comme Buggs et Luskin) mentionnent ces différences est tout à fait attendu. Si le modèle évolutionniste est faux, ce ne sont pas les évolutionnistes qui le soulèveront mais bel et bien leur opposant.
Le témoignage oculaire de la Bible, l’acte de naissance des organismes est enregistré dans la Bible (certes sans les détails de l’ADN etc…), nous avons donc une base historique solide qui constitue tout un pan de l’argumentation. L’histoire est une composante de l’équation de la vérité, la science en est une autre.
Le Dilemme d’Haldane
En 1957, le célèbre généticien J.B.S. Haldane, pourtant défenseur de l’évolution, a voulu modéliser mathématiquement comment une mutation bénéfique pouvait se propager (ou devenir « fixée ») dans une population au fil des générations.
Le cœur du raisonnement de Haldane était:
- Une mutation bénéfique apparaît d’abord dans un individu ou très peu d’individus.
- Pour que cette mutation soit présente chez tous les membres de la population (on dit qu’elle est fixée), elle doit remplacer les gènes non-mutés par reproduction successive.
- Ce remplacement progressif se fait génération après génération, et prend du temps, surtout dans les espèces à reproduction lente comme les mammifères (ex. : humains, primates).
- Haldane a calculé que ce processus impose une limite naturelle au nombre total de mutations bénéfiques pouvant être fixées dans une période donnée — c’est ce qu’on appelle la « charge de substitution ».
Le problème découvert qu’on appelle en anglais « Haldane’s Dilemma » est que même avec des millions d’années, le nombre total de mutations bénéfiques pouvant être fixées dans une population reste très faible. En effet chez les humains (ou les grands singes), avec une reproduction lente (~20 ans/génération), on ne peut fixer qu’un petit nombre de mutations en 10 millions d’années. Pourtant, il existe des millions de différences génétiques entre le génome humain et celui du chimpanzé. Selon Haldane, la vitesse de l’évolution génétique observée dépasse ce qui est théoriquement possible, même en supposant des temps longs.
Cela signifie que le modèle néo-darwinien classique, fondé sur l’accumulation graduelle de mutations bénéfiques sélectionnées, n’explique pas la diversité génétique observée entre les espèces à reproduction lente comme l’humain et les grands singes.
Walter ReMine, dans The Biotic Message (1993), puis dans un article de 2005, a repris et approfondi ce problème. Il a montré que même avec des hypothèses favorables, le nombre de mutations fixées ne peut pas expliquer l’écart génétique humain-singe. Selon lui, ce problème est aujourd’hui ignoré par la majorité des biologistes évolutionnistes, faute de solution satisfaisante.
Le problème a empiré récemment car la quantité de différences génétiques réelles trouvées entre humains et chimpanzés est plus grande que ce que l’on pensait initialement (>10 %, selon le type de comparaison). Les nouvelles données génomiques montrent une complexité croissante du génome (épigénétique, régulation, architecture 3D du génome), ce qui accroît le nombre de modifications nécessaires pour justifier l’évolution d’un ancêtre commun vers l’homme moderne.
Conclusion
Le modèle des baramins n’a jamais prétendu se réduire à une formule fixe universelle. Il repose sur des discontinuités empiriques (morpho, génétique, hybridation, reproduction). Oui, certaines frontières sont encore débattues, comme en phylogénie. Mais ce n’est pas un défaut unique: les biologistes évolutionnistes ont eux-mêmes revu radicalement des centaines de familles, genres ou ordres depuis l’arrivée de la génétique (cf. Afrotheria, etc.). Refuser un modèle parce qu’il implique une réflexion qualitative ou pluridimensionnelle reviendrait à rejeter la cladistique des ses débuts.
La baraminologie peut être testée, si deux espèces considérées comme appartenant à des baramins différents produisaient une descendance fertile, ou si un continuum morpho-génétique venait combler les discontinuités observées, cela remettrait en cause les délimitations proposées. Inversement, des regroupements inattendus (éléphant/taupée dorée), ou des séparations nettes malgré forte ressemblance (taupe dorée/taupe classique), corroborent l’idée de groupes disjoints à design commun.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!