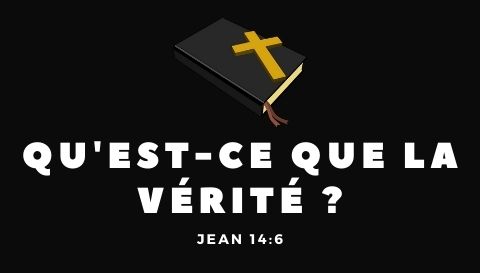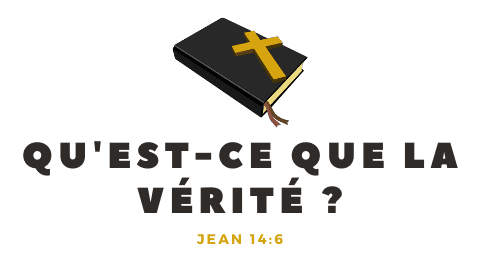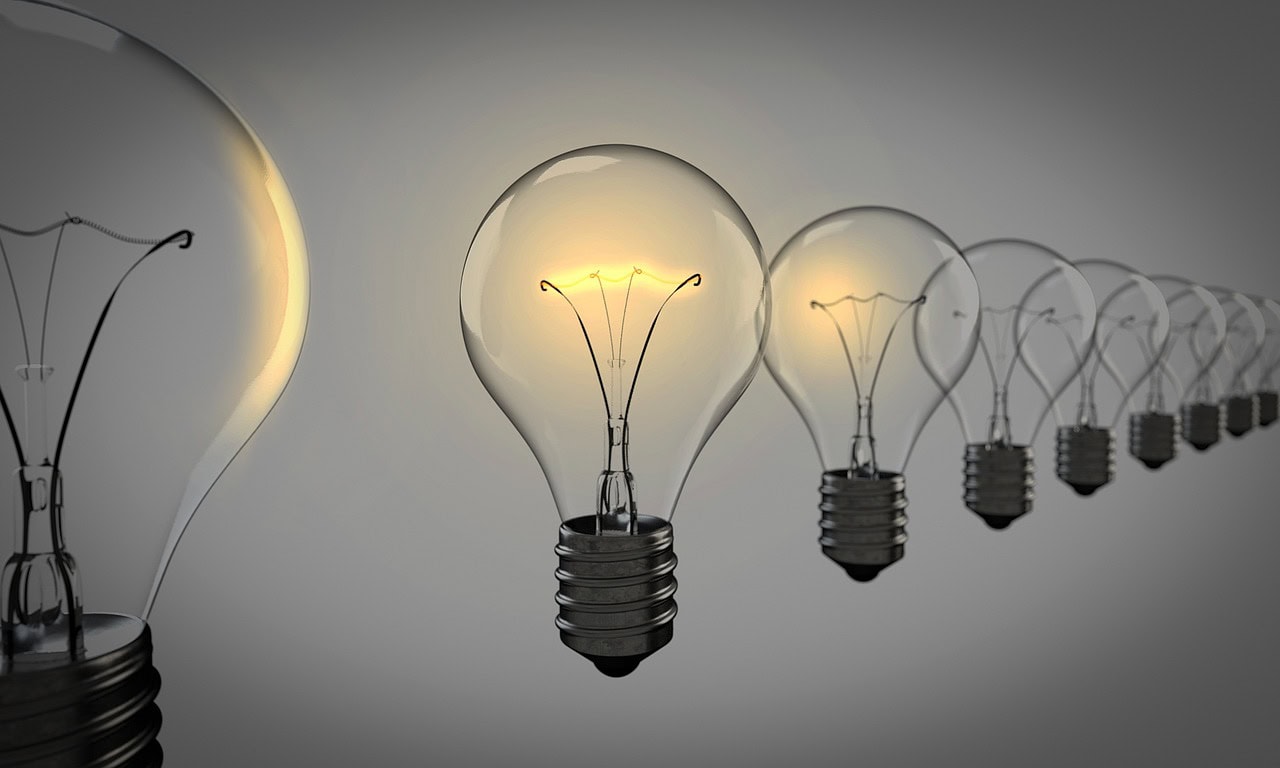La Sélection Naturelle est-elle le dieu de l’Évolution?
La sélection naturelle est un concept ambigu, intangible, et probablement fantomatique à en croire certains évolutionnistes critiques (partisans de la troisième voie) du modèle néodarwinien. Quand on étudie de près le concept, on se rend compte qu’elle a pris la place de Dieu dans le modèle créationniste. Elle représente une forme d’idolâtrie moderne, de laquelle les créationnistes doivent s’éloigner.
La sélection naturelle a été remise en question dès ses débuts
« En 1866, sept ans après la publication de L’origine des espèces, Alfred R. Wallace écrivit à Charles Darwin pour lui proposer d’éliminer le terme sélection naturelle de son œuvre…
Ses arguments étaient que… « La sélection naturelle est une expression métaphorique, et dans une certaine mesure indirecte et incorrecte, car même en personnifiant la Nature, elle ne sélectionne pas vraiment. » (Marchant, 1916, p. 144). »John O. Reiss. Not by Design: Retiring Darwin’s Watchmaker. University of California Press, 2009, pp. 4–5.
En 1866, Wallace écrit à Darwin pour lui suggérer de supprimer le terme « sélection naturelle » de ses écrits. Selon lui, ce terme était une expression métaphorique, donc pas rigoureuse scientifiquement. Elle était indirecte et incorrecte, car même en personnifiant la Nature (comme le faisait Darwin), elle ne “sélectionnait” pas réellement.
Reiss cite d’ailleurs Marchant (1916), qui appuie cette idée: même dans un usage imagé, parler de nature qui « sélectionne » est trompeur.
Wallace, pourtant cofondateur de la théorie, remet en question le cœur terminologique de la vision darwinienne. Il pointe une faiblesse souvent négligée: le terme « sélection » donne l’illusion d’un choix intentionnel, une erreur de logique si l’on considère que la nature n’a ni volonté, ni conscience.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
Wallace voulait abandonner l’expression « sélection naturelle » car elle est trompeuse. Il estimait qu’elle attribue à la nature une capacité de décision qu’elle n’a pas. Cela montre que le débat sur la validité conceptuelle du terme existait déjà du vivant de Darwin.
Andrew Moore sur l’intentionnalité et de la direction dans les processus évolutifs
« Je crois qu’une grande partie de notre difficulté à éviter l’invocation de l’intentionnalité et de la direction dans les processus évolutifs vient de notre incapacité persistante à définir la sélection naturelle en termes de lois et de processus physiques… En attendant, la terminologie anthropomorphique en évolution pourrait persister simplement parce que les scientifiques aiment l’utiliser.
Mais c’est l’une des pires choses que nous puissions faire, étant donné la grande confusion du public sur les principes fondamentaux de l’évolution. Et je parierais que cela induit même parfois les scientifiques eux-mêmes en erreur. »
Moore, Andrew. 2011. We need a new language for evolution. BioEssays 33(4): 237.
Andrew Moore tire ici la sonnette d’alarme sur un problème sémantique profondément enraciné dans le discours évolutionniste : l’usage systématique d’un langage anthropomorphique, c’est-à-dire empruntant des termes humains (comme « choix », « intention », « pression », « design », etc.) pour décrire des processus naturels dépourvus d’intelligence ou de volonté.
Il reconnaît que cette habitude conduit à projeter de la pensée et de l’intention dans un processus aveugle, ce qui est à la fois scientifiquement inexact et source de confusion, même chez les chercheurs. Cette critique rejoint celles de Stephen Jay Gould, Ford Doolittle, Jerry Fodor ou Robert Reid, qui dénoncent le caractère flou, circulaire ou métaphorique de nombreux termes évolutionnistes.
Guillaume Lecointre, dans sa conférence « qu’est-ce que l’évolution » au Jardin Botanique de Nancy, a déclaré:
Le rôle de la sélection naturelle c’est d’expliquer le changement des espèces, c’est ce que j’ai appris
Dire que certaines espèces survivent dans un environnement donné tandis que d’autres disparaissent n’explique en rien les traits spécifiques des espèces qui survivent. Le froid, par exemple, n’explique pas l’apparition d’un pelage épais: le froid ne fabrique rien. Ce sont les instructions internes, codées dans le génome, qui permettent à l’organisme de produire une fourrure adaptée. Cela montre une capacité inhérente et préprogrammée à répondre à certaines conditions environnementales.
L’analogie mécanique le rend encore plus clair: si on jette une moto, un vélo ou une voiture dans la mer, ils couleront et se dégraderont. On ne dira pas pour autant que l’environnement marin a « désélectionné » ces machines, ni qu’il a « sélectionné » un bateau ou un sous-marin. La réalité, c’est que chaque machine a été conçue pour un environnement spécifique. Le modèle créationniste CET (Continuous Environmental Tracking) suit la même logique: les organismes ne sont pas triés par leur environnement, ils sont conçus pour y prospérer.
Les mutations aléatoires n’offrent pas non plus une explication satisfaisante. Penser qu’au moment où un animal a besoin d’une fourrure plus épaisse, une mutation chanceuse surgirait exactement au bon endroit dans le génome, au bon moment, est hautement improbable — voire miraculeux. En réalité, le récit évolutionniste repose sur des dizaines de miracles aléatoires non dirigés, tandis que le modèle créationniste suppose un seul miracle initial — la création — suivi par des créatures dotées d’un système d’adaptation intelligent, comme des drones capables d’ajuster leur fonctionnement selon l’environnement.
Pourtant sur le site du Museum d’Histoire naturelle de Paris, on lit:
L’ADN d’un individu constitue son « patrimoine génétique », légué de génération en génération. Lorsque les cellules se divisent (notamment lors de la formation des cellules sexuelles), l’ADN qu’elles contiennent est copié. Mais des erreurs de copie se produisent : des mutations. Ces erreurs dans la copie de l’ADN sont à la base de l’évolution.
Les mutations interviennent au hasard dans le génome. Certaines empêchent l’organisme de fonctionner. D’autres n’ont au contraire aucune conséquence. Mais une infime part des mutations conduit à un effet bénéfique : une taille un peu plus grande, une meilleure capacité à digérer certains aliments, une couleur différente…
Parmi toutes les mutations, certaines peuvent avantager l’individu qui les porte.
Par exemple, si dans une population de lapins bruns habitant une région froide et enneigée, apparait par mutation un lapin blanc, sa couleur lui permettra de passer inaperçu et d’échapper à ses prédateurs. S’il s’accouple et a des petits, il leur transmettra sa mutation génétique et avec elle la couleur blanche. Ses descendants auront eux aussi une plus grande chance de survie et d’avoir des petits à leur tour. C’est ainsi que les mutations responsables du pelage blanc se répandront dans la population des lapins des régions polaires, conduisant à une augmentation de l’adaptation de la population à son environnement.
Ce genre d’affirmation est combattu au sein même de la communauté évolutionniste, voici ce qu’en disait l’évolutionniste Lynn Margulis interrogée par Susan Mazur:
« Elle ne voit la sélection naturelle ni comme la source de nouveauté héréditaire ni comme l’ensemble du processus évolutif et a prononcé la mort du néo-darwinisme, car il n’y a aucune preuve adéquate dans la littérature que des mutations aléatoires entraînent de nouvelles espèces.«
The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry
Elle dit par ailleurs:
« Les néo-darwiniens disent que de nouvelles espèces émergent lorsque des mutations se produisent et modifient un organisme. On m’a enseigné encore et encore que l’accumulation de mutations aléatoires menait au changement évolutif — menait à de nouvelles espèces. Je l’ai cru… jusqu’à ce que je cherche des preuves. »
Cité dans “Discover Interview: Lynn Margulis Says She’s Not Controversial, She’s Right,” Discover Magazine, p. 68 (April, 2011).
Les observations récentes d’adaptations rapides montrent que les organismes n’attendent pas passivement que le hasard fasse son œuvre. Ils ne produisent pas une multitude de variantes hasardeuses parmi lesquelles seules quelques-unes seraient triées par sélection. Au contraire, ils réagissent rapidement et efficacement, de manière ciblée, sans passer par un long processus de sélection. Ces faits soutiennent davantage une ingénierie adaptative intégrée qu’un tri aléatoire aveugle.
Andrew Moore souligne un point essentiel: la sélection naturelle n’est pas définie rigoureusement comme une force au sens des sciences physiques (comme la gravité ou l’électromagnétisme), et le vocabulaire utilisé fausse la compréhension, en donnant une fausse impression de direction ou de choix, ce qui renforce l’idée qu’un « agent » serait à l’œuvre, alors même que le paradigme naturaliste cherche justement à exclure toute forme d’intelligence.
En d’autres termes, c’est une incohérence dans le cœur du langage évolutionniste: on refuse Dieu ou le dessein, mais on continue à parler comme si un agent sélectionnait, décidait, favorisait…
L’anthropomorphisme consiste à attribuer des caractéristiques humaines, comme la volonté, l’intelligence ou le choix, à ce qui n’est pas une personne. Si certains athées reprochent aux croyants de projeter une image humaine sur Dieu, ils ne réalisent pas qu’ils commettent exactement la même erreur en parlant de la nature comme si elle « sélectionnait », « favorisait » ou « agissait » intentionnellement. En prétendant rejeter toute intelligence transcendante, ils en viennent paradoxalement à doter la nature elle-même d’attributs personnels qu’elle ne possède pas.
Lewontin – une sélection pas si naturelle?
Richard C. Lewontin, issues de sa critique « Not So Natural Selection » (2010, NY Times Book Review), soulignent un problème central de communication et de compréhension dans la biologie évolutive moderne : l’usage abusif de métaphores.
« Rien ne crée plus de confusion sur les résultats de la recherche scientifique que l’usage des métaphores par les scientifiques. Ce n’est pas seulement le grand public qu’ils induisent en erreur, mais aussi leur propre compréhension de la nature qui est détournée. L’exemple le plus célèbre et le plus influent est l’invention par Darwin du terme « sélection naturelle », qui, écrivait-il dans L’Origine des espèces, « scrute quotidiennement et à chaque instant, à travers le monde, chaque variation, même la plus minime ; rejetant ce qui est mauvais, conservant et accumulant tout ce qui est bon… » »
Not So Natural Selection » (2010, NY Times Book Review)
Lewontin pointe ici le danger d’utiliser des figures de style (comme la métaphore de la nature qui “sélectionne” activement), car cela donne l’illusion qu’un processus impersonnel agit comme une entité consciente. La citation de Darwin personnifie la nature comme une sorte de juge omniprésent, ce qui peut fausser profondément la compréhension des mécanismes biologiques chez les scientifiques eux-mêmes, et pas seulement chez le grand public.
« Malheureusement, même les biologistes évolutionnistes modernes, ainsi que les théoriciens des phénomènes sociaux et psychologiques humains qui utilisent l’évolution organique comme modèle pour des théories générales, ne sont pas toujours conscients des dangers de la métaphore. Alfred Russel Wallace, le co-inventeur de notre compréhension de l’évolution, écrivit à Darwin en juillet 1866 pour le prévenir que même des « personnes intelligentes » prenaient cette métaphore au pied de la lettre. »
Not So Natural Selection » (2010, NY Times Book Review)
Lewontin, comme John O. Reiss, rappelle ici qu’Alfred Russel Wallace, le « co-découvreur » du principe de sélection naturelle, avait lui-même exprimé des réserves importantes sur ce langage métaphorique. Wallace craignait que l’expression « sélection naturelle » donne lieu à des malentendus profonds, même chez les personnes instruites, en faisant croire que la nature « choisit » intentionnellement certains traits.
Stephan Talbot: succomber à la puissance de la métaphore
« Les biologistes évolutionnistes parlent couramment de la sélection naturelle comme s’il s’agissait d’un agent [et]… beaucoup d’entre eux assurent que l’idée d’un agent qui sélectionne n’est “qu’une métaphore” — tout en succombant eux-mêmes à la force persuasive de cette métaphore… Et nous devrions croire que la sélection naturelle, qui “n’est pas un agent, sauf métaphoriquement”, parvient à concevoir des artefacts ; et que l’organisme… n’est, au fond, ni créatif ni agent causal. »
Stephan L. Talbott, Can Darwinian Evolutionary Theory Be Taken Seriously?, 2016.
Dans ce passage, Talbott souligne une contradiction profonde dans le discours des biologistes évolutionnistes: ils affirment d’un côté que la sélection naturelle n’est qu’une métaphore, mais dans les faits, ils l’emploient comme s’il s’agissait d’une force active, intentionnelle, capable de concevoir ou d’optimiser des traits, ce qui revient à lui prêter une forme d’intelligence implicite, sans en reconnaître les implications philosophiques.
« La capacité d’agir [de l’organisme] a été transférée à une abstraction [la sélection naturelle] dont l’agentivité ou la “force” causale est, dans une confusion intellectuelle, à la fois niée et constamment sous-entendue par les biologistes. La sélection naturelle devient alors une sorte de pouvoir occulte d’un âge préscientifique… »
Stephan L. Talbott, Can Darwinian Evolutionary Theory Be Taken Seriously?, 2016.
Dans cette suite, Talbott accentue le glissement sémantique et intellectuel: ce qui était au départ un concept descriptif (un résumé de ce qui survit et se reproduit) devient dans le discours scientifique un actant abstrait, quasi-magique, capable de « forcer » des changements biologiques. Cela le rapproche des entités animées ou divines des récits anciens, comme des puissances mystiques responsables du destin des choses, ce que la science moderne est justement censée éviter.
Talbott appelle à une plus grande rigueur intellectuelle: si la sélection naturelle n’est qu’un cadre statistique ou un résumé descriptif des variations reproductives, alors il faut cesser de la personnifier comme si elle “choisissait”, “créait” ou “optimisait”. Faute de quoi, le discours scientifique glisse vers une mythologie moderne, où des entités abstraites se voient dotées de pouvoir, sans explication causale claire.
Pour les créationnistes ou critiques du naturalisme, cela montre que la sélection naturelle est traitée comme un substitut au concepteur, sans être capable d’assumer ce rôle rationnellement.
Charles Darwin et Thomas Malthus
« C’est la doctrine de Malthus, appliquée à l’ensemble des règnes animal et végétal. Comme bien plus d’individus de chaque espèce naissent qu’il n’en peut survivre, il en résulte nécessairement une lutte récurrente pour l’existence… Nous verrons alors comment la sélection naturelle provoque presque inévitablement l’extinction de nombreuses formes de vie moins perfectionnées. »
« J’ai appelé ce principe – par lequel toute variation légère, si elle est utile, est conservée – du nom de sélection naturelle, afin de marquer son rapport avec le pouvoir de sélection de l’homme. Mais l’expression souvent utilisée par M. Herbert Spencer, la survie du plus apte, est plus précise et parfois tout aussi pratique. »
Darwin, C. (2009). The Origin of Species: 150th Anniversary Edition. p. 74–75.
Darwin a appliqué la théorie de Malthus à toute la nature: puisque les espèces produisent plus d’individus que ce que l’environnement peut soutenir, il en résulte une lutte constante pour l’existence. Cela débouche sur la sélection naturelle, qui, selon lui, conduisait inévitablement à l’extinction des formes de vie « moins perfectionnées ». Il a repris ensuite l’expression de Herbert Spencer « survival of the fittest » (survie du plus apte) en la jugeant plus précise et parfois interchangeable avec « sélection naturelle ». On voit ici que la sélection naturelle, chez Darwin, est une force d’élimination et d’extinction, motivée par la rareté et la compétition, plutôt que par une quelconque amélioration téléologique.
Nous avions abordé le fait que la vision de Malthus était erronée. Les organismes s’auto-adaptent à l’environnement et il n’y a pas de surpopulation entraînant une compétition à l’intérieur de l’espèce.
Stephey Jay Gould a dit:
« En outre, la sélection naturelle, exprimée en termes humains inappropriés, est un processus remarquablement inefficace, voire cruel. La sélection façonne l’adaptation en éliminant des masses d’individus moins aptes – imposant des hécatombes de morts comme condition préalable à de faibles avancées évolutives. »
« La sélection naturelle est une théorie fondée sur l’externalisme de l’essai-erreur : les organismes proposent, via leur réservoir de variations, et les environnements éliminent presque tout – ce n’est pas un internalisme dirigé vers un but, efficace et humain (ce qui serait rapide et élégant, mais la nature n’en connaît pas la voie). »
Gould, S. J. (1994). The Power of This View of Life. Natural History, 103(6).
Gould souligne que la sélection naturelle, loin d’être une force intelligente ou bienveillante, agit de manière aléatoire et brutale. La métaphore du tri conduit à sous-estimer le caractère massif de l’échec biologique et l’absence de directionnalité réelle. Il critique ici l’utilisation de métaphores anthropomorphiques qui donnent une illusion de dessein ou de progrès là où il n’y a que tri aveugle.
Mais où est le changement génétique?
Beaucoup de créationnistes soulignent que, dans la logique darwinienne, la sélection naturelle repose sur un processus de mort massive, supposé éliminer les organismes « moins aptes ». Pourtant, aucun changement génétique réel ne se produit tant que les organismes continuent à se reproduire. Tant que tous les individus se reproduisent, la fréquence des gènes dans la population ne change pas. Ce n’est que par l’élimination des organismes dits « non adaptés » (c’est-à-dire par leur mort) que leur matériel génétique est supposément retiré du « pool » génétique, permettant ainsi, dans la vision évolutionniste, un prétendu progrès.
Cela place la mort au cœur du mécanisme évolutif, ce que Darwin ignorait au niveau génétique, mais anticipait déjà comme une « guerre pour la survie ». Ce processus, devenu quantifiable avec la génétique des populations, impose que les « gènes moins aptes » soient sacrifiés pour que les « bons gènes » se perpétuent, une vision profondément sélective, sans compassion, fondée sur des éliminations massives.
D’un point de vue créationniste, ce modèle de tri génétique brutal n’est pas nécessaire pour expliquer les fossiles: ceux-ci sont interprétés comme le résultat d’une extinction massive unique, notamment lors du Déluge de Noé, et non comme le produit de millions d’années d’évolution graduelle. En d’autres termes, 600 millions d’années d’évolution présumée seraient, dans ce cadre, le reflet d’un événement catastrophique condensé sur une seule année. L’idée même de transformation progressive n’a alors plus de support.
Enfin, certaines interprétations évolutionnistes frisent l’absurde, comme un exemple avec Bob Bakker. Ce dernier affirme que les dinosaures auraient « forcé » les plantes à évoluer en plantes à fleurs simplement parce qu’ils les consommaient trop vite. Mais comme on peut le faire remarquer ironiquement, le besoin ne suffit pas à générer une solution fonctionnelle: un besoin n’a jamais conçu un système complexe en réponse.
En somme, cette pensée revient à personnifier la nature, à lui attribuer une capacité d’ingénierie adaptative, alors qu’en réalité les besoins n’ont ni volonté, ni pouvoir de conception. Pour les créationnistes, ce genre de raisonnement relève plus de la fable que de la science rigoureuse.
Neil Thomas: la contradiction logique aveuglante de la “sélection sans intention
« La manière de penser de Darwin — selon laquelle toute sélection doit se produire sans but ni intention — passe apparemment sous silence, avec une certaine discrétion, la contradiction logique aveuglante de la “sélection sans intention” inhérente à sa pensée ! […] Il n’est guère surprenant que, dans une tentative récente de cerner précisément le statut phénoménologique de la “sélection naturelle”, David Brown ait conclu que ce terme est davantage une construction imaginative floue qu’un phénomène que l’on pourrait localiser dans le monde naturel lui-même. »
« Le terme manque d’un référent adéquatement défini, car un tel référent n’a jamais été localisé empiriquement dans la nature, ce qui fait de ce terme une sorte de fantôme sans existence matérielle. »
Neil Thomas. 2021. Natural Selection: A Conceptually Incoherent Term. Publié sur evolutionnews.org le 1er décembre 2021.
Neil Thomas commence par pointer ce qu’il considère comme une contradiction logique flagrante: Darwin parle de « sélection » tout en refusant de lui attribuer un but ou une intention. Or, dans un langage courant, sélectionner implique forcément une forme de volonté ou de choix dirigé. Pour Thomas, il est incohérent de parler de « sélection sans intention », car ce serait comme parler d’un choix sans agent qui choisit — une contradiction en termes.
Il cite ensuite David Brown, qui remarque que même en tentant de préciser ce qu’est la sélection naturelle d’un point de vue phénoménologique (c’est-à-dire en tant qu’expérience ou réalité vécue), on se rend compte que ce n’est pas un phénomène que l’on peut localiser concrètement dans la nature, mais plutôt une construction imaginative floue, autrement dit, une fiction explicative.
La conclusion de Neil Thomas est radicale: le terme « sélection naturelle » n’a pas de référent clairement défini dans le monde naturel observable. Il n’est pas empiriquement repérable, et fonctionne donc, selon lui, comme un fantôme, une entité qui n’a aucune existence matérielle directe, mais à laquelle on attribue une causalité.
Des néologismes pour désigner toute une variété d’idées vagues ou fantaisistes
« Il est courant, à toutes les époques et dans toutes les cultures, d’inventer des néologismes ou des formulations linguistiques ad hoc pour désigner toute une variété d’idées vagues ou fantaisistes. Il semble en réalité bien trop facile d’inventer des mots pour couvrir un grand nombre de notions purement abstraites, parfois même chimériques — d’autant plus efficacement (pour les esprits peu critiques) si l’on y appose le titre honorifique de “science”.
Bon nombre des termes que nous utilisons dans la vie quotidienne sont, et sont largement reconnus comme étant, des notions plus que des faits… ce que l’on appelle parfois des “chimères verbales”.
Ce sont là des termes dépourvus de fondement factuel, qui existent uniquement “sur le papier” mais sans référent concret dans le monde réel, car aucun référent de ce type n’existe. Dans la même veine, on pourrait dire, avec Charles Darwin, que le développement de la biosphère découle simplement de cette sous-variante du hasard, jamais attestée empiriquement, qu’il a choisi d’appeler “sélection naturelle”. En l’absence de toute preuve empirique pour ces conjectures, ces termes ne peuvent qu’inévitablement demeurer sans référents… ou de simples signifiants vides. »
Neil Thomas. 2022. Why Words Matter: Sense Nonsense in Science. Publié sur evolutionnews.org le 7 avril 2022.
Le titre de l’article est évocateur: « Pourquoi les mots comptent : du sens et du non-sens en science« .
Neil Thomas, professeur de littérature comparée et critique du darwinisme, met ici le doigt sur ce qu’il considère comme un abus de langage dans les sciences, en particulier dans la biologie évolutionniste. Il critique la tendance à créer des concepts abstraits comme « sélection naturelle » qui, selon lui, n’ont aucun ancrage réel ni observable dans le monde naturel. Il dénonce leur usage comme des étiquettes pseudo-scientifiques servant à masquer une absence de mécanisme tangible, comparant cela à de « vains signifiants », des mots sans fondement empirique.
Sa comparaison avec des néologismes ad hoc ou des “chimères verbales” souligne qu’une terminologie peut créer l’illusion d’un savoir, même lorsqu’elle n’a aucun ancrage expérimental, tant que le mot semble savant. En ce sens, selon Neil Thomas, “sélection naturelle” est une expression rhétorique puissante mais conceptuellement incohérente, qui n’explique rien de façon vérifiable.
Un exemple avec une étude sur des lézards
Des chercheurs ont mené une expérience naturelle où des lézards verts des Balkans (Lacerta trilineata) originellement insectivores, vivant sur une île grecque, se sont retrouvés contraints de passer à un régime majoritairement végétal. En moins de quarante ans, les lézards de l’île ont développé un cæcum fonctionnel, une petite poche digestive entre l’intestin grêle et le côlon, qui permet la fermentation des fibres végétales grâce à une flore spécifique. Ce changement anatomique, inexistant au départ, est apparu rapidement au niveau de la population.
Pour interpréter ce phénomène comme une sélection naturelle, il faudrait démontrer étape par étape qu’une variation initiale au sein de la population a été « sélectionnée »: les lézards avec une tendance à former un cæcum vivraient mieux, se reproduiraient davantage, et transmettraient progressivement cette caractéristique. Or, la rapidité de l’adaptation et l’absence de vestiges d’un tel processus suggèrent plutôt un mécanisme inné: les lézards semblent avoir des capacités internes, capteurs métaboliques ou régulateurs de développement, qui détectent le changement alimentaire et déclenchent la formation du cæcum.
En résumé les lézards passent d’un régime insectivore à herbivore et développent un cæcum en quelques décennies.
L’interprétation de la « sélection naturelle » est que ce développement serait dû à une sélection des porteurs d’un trait favorable, éliminant les autres. Sur le site du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris c’est exactement comme ça que c’est présenté.
« Les générations successives de cette population avaient donc subi des modifications importantes favorisant un changement de régime alimentaire. Cette transformation rapide et impressionnante ne relève pourtant pas de la magie mais d’un processus aujourd’hui bien connu : l’évolution.«
L’interprétation alternative est que les lézards ont activé une programme inné de plasticité adaptative, réagissant aux stimuli alimentaires sans nécessité d’un long tri générationnel.
Cela montre que la seule mention d’un cæcum nouveau ne suffit pas à prouver un processus graduel de sélection ; au contraire, cela révèle souvent une réponse intégrée, rapide et dirigée de l’organisme, liée à sa programmation interne.
« Le hasard assure le foisonnement du vivant produisant une infinité de variations différentes, puis l’environnement fait le tri: c’est la sélection naturelle. Ces deux mouvements expliquent la diversité du vivant, la capacité des populations à s’adapter au changement, mais aussi la stabilité que l’on constate au sein d’une population adaptée à son milieu.«
L’idée que « le hasard assure le foisonnement du vivant » et que l’environnement « fait le tri » par la sélection naturelle repose sur une vision datée et erronée des mécanismes biologiques. Ce modèle suppose qu’une infinité de variations aléatoires surgiraient en continu, attendant d’être tamises passivement par l’environnement. Mais de nombreuses observations récentes contredisent cette représentation.
Des cas documentés d’adaptation rapide, comme les lézards de l’île grecque qui ont développé un caecum fonctionnel en quelques décennies, montrent une réponse ciblée, rapide et coordonnée, sans qu’un « foisonnement » de variantes ait été nécessaire. Ces lézards n’ont pas « attendu » que le hasard produise l’organe, ni que le tri élimine ceux qui ne l’avaient pas. Ils ont activé un potentiel déjà présent en réponse directe au changement de régime alimentaire.
Cela correspond davantage à une capacité d’adaptation innée, pilotée par des capteurs biologiques et des modules régulant l’expression génétique. Ce ne sont ni le hasard ni la sélection naturelle qui ont opéré, mais une programmation interne intelligente, semblable à un système embarqué capable de reconfigurer certaines structures selon les besoins environnementaux.
Cette approche remet donc profondément en question le récit classique évolutionniste, qui repose sur une analogie faible avec le hasard productif et le tri naturel comme moteur du changement. Au contraire, les faits empiriques suggèrent un design intégré, prévoyant les conditions variables de l’environnement et capable de réponses adaptatives ciblées et rapides.
L’étude sur les Lézards montre une évolution digestive rapide et fonctionnelle, improbable à expliquer uniquement par la sélection naturelle graduelle. Une explication internaliste (plasticité programmée, capacités adaptatives innées) est bien plus cohérente:
Les lézards ne « fabriquent » pas un cæcum au hasard, ils l’activent rapidement. C’est un mécanisme conçu, non sélectionné.
L’étude en question a été publiée dans: The Science of Nature, vol. 102, pages 55–65, 2015.
Jerry Coyne: d’un dessein divin à un processus matérialiste
« Partout où nous regardons dans la nature, nous voyons des animaux qui semblent magnifiquement conçus pour s’adapter à leur environnement… Il n’est pas surprenant que les premiers naturalistes aient cru que les animaux étaient le produit d’un dessein céleste, créés par Dieu pour accomplir leur tâche… Darwin a dissipé cette idée dans L’Origine des espèces. En un seul chapitre, il a complètement remplacé des siècles de certitude quant au dessein divin par l’idée d’un processus matérialiste, dépourvu d’intelligence — la sélection naturelle — capable d’aboutir au même résultat. Il est difficile de surestimer l’effet que cette prise de conscience a eu, non seulement sur la biologie, mais aussi sur la vision du monde des gens. »
Jerry Coyne. Why Evolution Is True. Viking, 2009, p. 115.
Dans ce passage, Jerry Coyne reconnaît explicitement le caractère révolutionnaire et subversif de la pensée de Darwin. Darwin n’a pas seulement proposé une théorie scientifique ; il a profondément modifié la manière dont l’humanité perçoit l’ordre, le but et le rôle de Dieu dans la nature. Il a remplacé l’idée d’un Créateur bienveillant par une cause sans intelligence ni intention, la sélection naturelle, capable en apparence d’expliquer la complexité du vivant. Coyne admet que cet abandon du design divin a eu un impact majeur sur la culture, la science et la vision du monde occidentale.
En somme Darwin a offert à la pensée matérialiste un substitut au dessein intelligent, une sélection naturelle « aveugle » mais prétendument aussi efficace.
La sélection naturelle est profondément contre-intuitive
« L’idée scientifique fondamentale de l’évolution par sélection naturelle n’est pas seulement vertigineuse ; la sélection naturelle, en assumant la tâche traditionnelle de Dieu — celle de concevoir et de créer toutes les créatures, grandes et petites — semble également nier l’une des meilleures raisons que nous avons de croire en Dieu… L’idée que la sélection naturelle ait le pouvoir de générer des conceptions aussi sophistiquées est profondément contre-intuitive. »
Daniel Dennett. Show Me the Science. New York Times, 28 août 2005.
Daniel Dennett explique que la sélection naturelle est une idée révolutionnaire, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi philosophique et spirituel. Avant Darwin, les créatures vivantes étaient généralement vues comme des œuvres d’un Dieu créateur, un être intelligent, bienveillant et puissant qui avait conçu chaque être pour un but.
Darwin, avec l’idée de sélection naturelle, déplace cette fonction divine: il propose que des mécanismes inconscients et non dirigés peuvent produire des organismes aussi complexes que ceux qu’on attribuait auparavant à Dieu.
Dennett souligne que l’idée que des processus aveugles (sans intention ni conscience) puissent créer des systèmes biologiques sophistiqués est très difficile à accepter intuitivement — et ce, même pour des esprits scientifiques. Il utilise le mot « mind-boggling » (stupéfiant, vertigineux) pour exprimer ce renversement total de perspective.
Pour beaucoup, complexité = intelligence = créateur.
Darwin dit : complexité = sélection naturelle (sans intelligence ni but).
Cela bouscule a profondément basculé l’intuition et la tradition.
La sélection naturelle de Darwin a pris la place du concepteur des créationnistes
« Ce qui est le plus surprenant dans le cheminement historique qui nous a menés au désordre actuel, c’est que la sélection naturelle de Darwin a pris la place du concepteur des créationnistes, plutôt que celle du hasard antitéléologique soumis aux conditions d’existence. »
John O. Reiss. 2009. Not by Design: Retiring Darwin’s Watchmaker. University of California Press.
John O. Reiss fait ici une remarque critique sur la manière dont la sélection naturelle a été utilisée, non pas comme une simple conséquence impersonnelle du hasard (comme certains matérialistes radicaux l’auraient voulu), mais comme un substitut au Dieu-concepteur des créationnistes. En d’autres termes, la sélection naturelle a été investie d’un rôle quasi-agentif, remplissant la même fonction que le Créateur dans les théologies traditionnelles, mais sans en avoir le statut personnel ni intentionnel. Il y a donc ici une mise en lumière d’un paradoxe idéologique dans la manière dont la biologie darwinienne a été formulée.
Edward O. Wilson – La sélection naturelle a créé le monde et pas Dieu
« Si l’humanité a évolué par la sélection naturelle darwinienne, alors ce sont le hasard génétique et la nécessité environnementale, et non Dieu, qui ont façonné l’espèce. »
Edward O. Wilson résumait ici la conséquence philosophique majeure du darwinisme: la disparition de Dieu comme cause explicative. Il affirme clairement que si l’évolution darwinienne est vraie, alors l’humanité n’est pas le fruit d’un dessein divin, mais d’un processus aveugle combinant hasard et contraintes naturelles. Cette citation illustre la rupture fondamentale entre la vision théiste du monde et l’interprétation naturaliste de l’origine humaine.
Le canon central de la biologie moderne
« Les biologistes ont aujourd’hui tendance à croire profondément que la sélection naturelle est la main invisible qui façonne des formes bien conçues. Il est peut-être exagéré de dire que les biologistes considèrent la sélection comme la seule source d’ordre en biologie, mais pas de beaucoup. Si la biologie contemporaine a un canon central, vous venez de l’entendre. »
Stuart A. Kauffman. 1995. At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity. Oxford University Press.
Kauffman met ici en lumière le statut quasi-dogmatique que la sélection naturelle a acquis dans la biologie moderne. Il compare cette sélection à la « main invisible » d’Adam Smith en économie, une force non dirigée, mais supposée suffisante pour générer l’ordre et la complexité. Il reconnaît que certains biologistes pourraient nuancer cette position, mais insiste que pour beaucoup, la sélection naturelle est désormais la clé explicative suprême, voire quasi exclusive, du vivant.
Ce passage dénonce indirectement un réductionnisme excessif : réduire toute forme d’organisation biologique à un seul mécanisme (la sélection naturelle), c’est peut-être ignorer d’autres processus importants, comme l’auto-organisation, la plasticité développementale, ou les propriétés émergentes des systèmes complexes, sujets chers à Kauffman.
Hodge: la sélection naturelle, un substantif régissant un verbe
« Une source de problème était que Darwin aimait le terme « sélection naturelle » parce qu’il pouvait être « utilisé comme un substantif régissant un verbe » (F. Darwin, 1887, vol. 3, p. 46). Mais de tels usages semblaient réifier, voire déifier, la sélection naturelle comme un agent… »
— Michael J. S. Hodge, Natural Selection: Historical Perspectives, in Keywords in Evolutionary Biology, 1992.
Darwin aimait utiliser « sélection naturelle » comme si c’était une entité réelle, active, capable de faire quelque chose (« la sélection naturelle sélectionne… »).
Lorsque Darwin parle de la sélection naturelle, il l’utilise comme un substantif actif, c’est-à-dire comme si cette idée abstraite était une entité concrète capable d’agir, de « gouverner ou régir un verbe ». Normalement, seuls les agents réels (comme des personnes ou des forces tangibles) peuvent exercer une action: je peux sélectionner, choisir, agir. Mais mes pensées, elles, ne le peuvent pas. En traitant un concept abstrait comme s’il avait ce pouvoir, Darwin réifie (transforme en chose réelle) la sélection naturelle, voire la déifie (lui attribue une volonté ou un pouvoir semblable à celui d’un dieu). C’est cela que Hodge critique: cette tendance à transformer une formule linguistique en agent agissant, alors qu’elle n’a aucune consistance physique observable.
Or cette dynamique rappelle profondément l’idolâtrie décrite dans la Bible. À l’époque antique, les peuples se tournaient vers des idoles comme Moloch, Baal ou Astarté, croyant qu’ils agissaient dans le monde. Mais le vrai pouvoir de ces faux dieux n’était pas dans l’objet en bois ou en pierre: il résidait dans l’esprit des gens qui leur prêtaient une volonté et des capacités. L’idolâtrie est d’abord mentale. Aujourd’hui, cette tendance n’a pas disparu. Dans un cadre matérialiste, on donne à des notions abstraites comme la sélection naturelle une personnalité, une intention, une capacité d’action.
Ainsi, croire que la sélection naturelle « produit », « invente », « adapte », c’est lui accorder des attributs d’agent, un rôle qui, dans d’autres cultures, serait occupé par une divinité. En ce sens, Hodge a raison de dire que Darwin, en traitant la sélection naturelle comme un être agissant, a contribué à une forme moderne de superstition scientifique.
Fait notable, certains évolutionnistes eux-mêmes reconnaissent cette tendance quasi religieuse. Il arrive que l’on parle de la sélection naturelle comme d’un substitut au Dieu créateur, un principe auquel il faut « croire », qui explique tout, même en l’absence d’observation directe. Dans un article écrit par un évolutionniste, cette dimension est assumée: la sélection naturelle est l’objet d’une foi implicite, comparable à la foi que les chrétiens placent en Jésus-Christ.
La « foi » dans la sélection naturelle
« Il n’est guère étonnant que les créationnistes trouvent le sélectionnisme aussi facile à critiquer. Mais ils ont ceci en commun avec les sélectionnistes: la foi dans l’efficacité d’un mécanisme créatif sans réalité matérielle. »
Robert G. B. Reid. 2007. Biological Emergences: Evolution by Natural Experiment. MIT Press, p. 393.
Robert G. B. Reid critique ici ce qu’il appelle le sélectionnisme, c’est-à-dire la tendance à attribuer à la sélection naturelle un pouvoir créatif autonome. Il souligne que même si créationnistes et évolutionnistes s’opposent théoriquement, ils partagent paradoxalement une même faiblesse épistémologique: ils croient tous deux à un mécanisme invisible censé « produire » du nouveau, que ce soit par l’action divine (pour les uns) ou par la sélection naturelle (pour les autres).
Mais Reid va plus loin: il dénonce l’illusion matérialiste qui consiste à traiter la sélection naturelle comme une force réelle et agissante dans la nature, alors qu’elle n’est, selon lui, qu’un concept abstrait sans support tangible. Ainsi, croire que la sélection naturelle crée des structures complexes revient, à ses yeux, à avoir la foi dans une entité sans réalité physique.
Il ne défend pas ici le créationnisme, mais critique un excès dans le récit néodarwinien, où la sélection est métaphoriquement personnifiée comme un « créateur sans mains ».
Rien est créé aujourd’hui
On observe aujourd’hui des conditions favorables à la vie, température adaptée, eau, atmosphère respirable, équilibre chimique, mais ces conditions, aussi essentielles soient-elles, ne créent rien. Elles permettent la vie, mais ne la génèrent pas. En réalité, malgré tous les environnements propices que l’on connaît sur Terre (et même ceux qu’on recherche ailleurs), aucune forme de vie ne naît spontanément. Les êtres vivants que nous observons aujourd’hui proviennent tous d’autres êtres vivants. C’est le principe fondamental de la biogenèse. Aucune cellule, aucun organisme n’apparaît de rien, même dans les conditions les plus optimales. Cela met en lumière une distinction cruciale: il y a une différence entre entretenir la vie et l’expliquer. Ce n’est pas parce qu’un environnement rend la vie possible qu’il en est l’auteur.
Darwin et le statut « quasi divin » de la sélection naturelle
« Il n’est guère surprenant que l’évêque Samuel Wilberforce ait fait remarquer que Darwin attribuait implicitement à la Nature le même statut ontologique que celui que les théistes attribuent traditionnellement à Dieu. Le fait que Darwin ait tacitement élevé la nature extérieure à un statut quasi divin était, concluait Wilberforce, tout autant un article de foi que les formes plus conventionnelles de croyance théiste. »
Neil Thomas. 2021. Natural Selection: A Conceptually Incoherent Term. Publié sur evolutionnews.org le 1er décembre 2021.
Cette citation de Neil Thomas (2021) souligne une critique théologique et philosophique ancienne formulée par l’évêque Samuel Wilberforce à l’encontre de la pensée de Darwin. En substance, Wilberforce observait que Darwin, en conférant à la Nature un rôle actif de création et de sélection, lui attribuait le même statut ontologique que les théistes attribuent à Dieu, c’est-à-dire un rôle de cause première et de principe organisateur.
Autrement dit, Darwin ne se contentait pas de décrire des phénomènes naturels, mais remplaçait implicitement Dieu par une entité abstraite, la Nature, dotée de pouvoirs créateurs. Wilberforce voyait dans cette démarche une forme déguisée de foi, une crypto-religion : la nature devient l’objet de confiance ultime, une sorte de divinité sans nom. Neil Thomas conclut alors que cette élévation tacite de la nature à un rôle divin est, en réalité, un acte de foi équivalent à n’importe quelle croyance théiste.
Jerry Fodor: What Darwin Got Wrong
« Malgré les affirmations contraires, Darwin n’a jamais vraiment éliminé les causes mentales de son explication de l’évolution. Il les a simplement dissimulées derrière l’analogie non examinée entre la sélection par élevage et la sélection naturelle… Nous pouvons affirmer ce que les darwiniens ne peuvent pas: il n’y a pas de fantôme dans notre machine ; ni Dieu, ni Mère Nature, ni Gènes égoïstes, ni Esprit du Monde, ni intentions flottantes ; et il n’y a pas non plus d’éleveurs fantômes. »
« Ce qui engendre les “fantômes” dans le darwinisme, c’est son recours dissimulé à des explications biologiques intentionnelles… Darwin a tracé la voie vers une théorie foncièrement naturaliste — voire athée — de la formation des phénotypes [traits] ; mais il ne savait pas comment aller jusqu’au bout. Il a éliminé Dieu, si l’on veut, mais la “Mère Nature” et d’autres pseudo-agents [comme la sélection] s’en sont sortis indemnes. Nous pensons qu’il est temps de s’en débarrasser eux aussi. »
Fodor, Jerry & Piattelli-Palmarini, Massimo. What Darwin Got Wrong. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010, p. 161–163.
Fodor et Piattelli-Palmarini critiquent ici la base philosophique du darwinisme. Selon eux, bien que Darwin ait voulu supprimer toute cause surnaturelle en biologie, il aurait en réalité substitué une cause intentionnelle divine par une autre entité abstraite tout aussi intentionnelle : la sélection naturelle. Ils reprochent à Darwin de recycler involontairement un raisonnement finaliste, en parlant de sélection comme si elle avait une volonté, un but, ou un pouvoir causal autonome.
Fodor admet que la croyance en la sélection naturelle est basée sur la foi, c’était un remplacement pour Dieu, que lui-même veut remplacer avec d’autres mécanismes.
En d’autres termes, même si le discours darwinien se veut naturaliste, il repose encore, selon eux, sur une personnification masquée de la nature, une sorte de divin laïcisé. Pour ces auteurs, cela crée un paradoxe : on supprime Dieu du système, mais on laisse à la nature un rôle quasi divin, en lui attribuant le pouvoir d’ordonner, sélectionner et façonner la vie, ce qui revient à une idolâtrie philosophique ou scientifique.
Ils appellent donc à éliminer ces entités “fantômes”, comme la sélection naturelle, qui ne sont selon eux ni des causes réelles observables, ni des agents réels, mais seulement des raccourcis conceptuels flous, porteurs de confusion.
Sur le site du Muséum national d’Histoire naturelle, dans un article écrit, par Pauline Briand, qui a interviewé et repris les enseignements de Guillaume Lecointre on lit:
Par le passé, de nombreuses théories ont voulu expliquer la multiplicité du vivant. Aujourd’hui, une seule est considérée comme valide : la théorie darwinienne de l’évolution.
L’affirmation selon laquelle « aujourd’hui, une seule théorie est considérée comme valide : la théorie darwinienne de l’évolution » procède d’une réduction abusive du paysage scientifique. Elle passe sous silence non seulement l’existence de courants alternatifs à l’intérieur même du paradigme naturaliste (comme la Troisième Voie de l’évolution), mais aussi les modèles rivaux non darwiniens, tels que le Dessein Intelligent ou le créationnisme raisonné, qui proposent d’autres grilles de lecture de la biodiversité.
Réduire la science à un seul paradigme admis revient à confondre consensus institutionnel et vérité scientifique. L’histoire des sciences montre pourtant que les consensus peuvent être renversés, remis en cause, ou révélés comme étant incomplets. En ce sens, revendiquer le monopole de la scientificité pour une seule théorie constitue une forme d’exclusion épistémique, qui empêche un débat ouvert et critique.
Il ne s’agit pas de prétendre que toutes les théories se valent, mais de reconnaître que la science progresse justement en confrontant des modèles, et non en érigeant un paradigme dominant en dogme.
Jerry Fodor et Massimo Piattelli-Palmarini dans leur livre What Darwin Got Wrong (2010) critiquent frontalement le cœur du modèle darwinien et notamment la sélection naturelle comme mécanisme explicatif suffisant de l’évolution. Leur ouvrage ne propose pas un modèle créationniste ou un modèle du dessein intelligent, mais s’inscrit dans un courant non-darwinien naturaliste, et montre bien qu’il existe des modèles alternatifs à l’intérieur même du champ scientifique.
La damnatio memoriae: un rappel
Dans la Rome antique ou l’Égypte pharaonique, la damnation memoriae consistait à:
- effacer les noms des monuments,
- détruire les statues,
- réécrire l’histoire pour exclure certains individus ou idées.
De façon semblable, dans certains cercles académiques darwiniens dominants, on observe:
| Comportement darwinien rigide | Comparaison avec la damnatio memoriae |
|---|---|
| Marginalisation de la 3ᵉ voie ou du dessein | Exclusion des noms et idées « non orthodoxes » |
| Refus de publication dans les revues majeures | Destruction des traces dans le discours officiel |
| Présentation de l’évolution comme « unifiée » | Réécriture de l’histoire intellectuelle |
| Confusion volontaire entre science et idéologie | Propagande officielle contrôlée |
La « 3ᵉ voie » (Shapiro, Noble, Margulis…) est souvent ignorée des manuels scolaires. Fodor, Nagel, ou Behe sont souvent étiquetés comme « non scientifiques » sans engagement dans leurs arguments. Les critiques philosophiques de la sélection naturelle sont fréquemment écartées comme des « non-sens » ou « arguments religieux », même quand elles sont purement logiques ou épistémologiques.
Comme dans les régimes autoritaires, le monopole d’un paradigme empêche l’exploration d’autres pistes. Et l’effacement délibéré de certains débats ou penseurs trahit une peur de la contradiction plutôt qu’une confiance dans la vérité scientifique.
Le darwinisme dominant agit parfois comme une idéologie ayant peur de la dissidence, pratiquant une forme moderne de damnatio memoriae. C’est pourquoi il est crucial de défendre la pluralité des approches (même naturalistes non darwiniennes), pour une science réellement ouverte et honnête.
Lecointre – Comment expliquer l’évolution?
Comment expliquer l’évolution ? Le hasard et la sélection. Guillaume Lecointre écrit à ce sujet : « Si l’on s’autorise une métaphore, le hasard des mutations ou de toute autre source de variation est le carburant de l’évolution. La sélection, sorte de tamis très étroit, est le moteur de l’évolution.
La métaphore selon laquelle le hasard serait le carburant de l’évolution et la sélection naturelle le moteur est profondément trompeuse. D’un point de vue logique et scientifique, le hasard ne produit pas de complexité fonctionnelle organisée. Il est statistiquement incapable de générer, sans guidage, les arrangements précis nécessaires à la vie. Dire que les mutations aléatoires sont le carburant revient à croire qu’une explosion aléatoire dans une usine peut produire une chaîne d’assemblage.
Quant à la sélection naturelle, il faudrait qu’elle soit tangible pour être un moteur. Ce concept ne produit aucune nouveauté génétique. La mort des uns et la survie des autres ne « fabrique » rien. Dans le cadre du CET, les créatures sont dotées de mécanismes innés, intégrés, capables de détecter les conditions environnementales et d’activer, de manière dirigée, des réponses génétiques ou épigénétiques spécifiques.
Autrement dit, les adaptations observées ne sont pas des produits du hasard tamisé, mais le résultat d’une intelligence incorporée, comparable à une boîte à outils autonome qui adapte une machine à son environnement. Le discours classique, qui fait du hasard un moteur, est non seulement scientifiquement imprécis, mais aussi philosophiquement fragile: il repose sur l’illusion qu’un processus aveugle peut construire de la complexité fonctionnelle sans plan ni but.
La sélection naturelle: une sorte de « terme divin »
« Darwin a été brillant en faisant de la « sélection naturelle » une sorte de terme divin, une expression pouvant remplacer « Dieu » – celui qui a fait cela – qui a créé les formes de vie… Il a ainsi facilité à ses contemporains la manière de penser et de verbaliser « Monsieur Dieu Tout-Puissant dans le Ciel », qui sélectionne ceux qu’il veut garder. Il a été conçu comme Le Sélectionneur Naturel, et rejette les autres. »
Lynn Margulis, citée dans Suzan Mazur, The Altenburg 16: An Exposé of the Evolution Industry, 2009.
Dans cette citation percutante, Lynn Margulis, biologiste réputée et elle-même critique du darwinisme orthodoxe, souligne le caractère quasi-théologique du concept de « sélection naturelle » chez Darwin. Elle affirme que Darwin a remplacé le rôle créateur de Dieu par une force impersonnelle appelée « sélection naturelle », qui se comporte pourtant comme un dieu en choisissant quels êtres vivants survivront.
Elle critique donc l’usage anthropomorphique et quasi religieux du terme. Margulis suggère que cela a rendu la pensée darwinienne plus acceptable pour une époque encore profondément marquée par le théisme, en remplaçant Dieu par une puissance séculière agissant avec les mêmes attributs (choix, rejet, finalité).
En somme, selon elle:
- La sélection naturelle est une sorte de « divinité laïque ».
- Elle est vénérée comme une entité agissante, alors qu’elle n’est qu’un concept abstrait.
- Cela confère au darwinisme une dimension dogmatique, voire idéologique.
Greg Graffin: « Darwin était un voyou »
« Le truc, c’est : comment parler de la sélection naturelle sans impliquer la rigidité d’une loi? On l’utilise presque comme un participant actif, presque comme un dieu. En fait, on pourrait remplacer le mot “dieu” par “sélection naturelle” dans beaucoup d’écrits évolutionnistes, et on croirait entendre un théologien. C’est une routine dont on sait qu’elle n’existe pas, mais qu’on enseigne quand même: mutation génétique et une sorte de force active qui choisit la plus favorable. »
Greg Graffin, Darwin Was a Punk, Scientific American, 1er octobre 2010.
Greg Graffin (musicien et biologiste évolutionniste) exprime ici une critique lucide et ironique de la rhétorique évolutionniste. Il pointe du doigt une contradiction fréquente: la sélection naturelle est souvent présentée comme une force agissante, douée de volonté, capable de faire des choix, presque comme un dieu.
Il observe que ce langage:
- est métaphorique, mais employé comme s’il était littéral ;
- remplace Dieu dans le discours scientifique, en jouant le même rôle causal et directionnel ;
- est enseigné malgré la reconnaissance implicite de son flou conceptuel (on sait qu’il n’existe pas d’agent actif nommé « sélection naturelle », mais on continue à le décrire comme tel).
Ainsi, Graffin dénonce l’usage dogmatique ou idéologique de la sélection naturelle, au point que cela ressemble à une croyance et non à une observation rigoureusement scientifique. Graffin est un militant anti-créationniste mais il reconnait la réalité.
Peter Godfrey-Smith: « la sélection est la grande réponse«
« Le design apparent des organismes, et les relations d’adaptation entre les organismes et leur environnement, sont les grandes questions, les faits étonnants de la biologie. Expliquer ces phénomènes est la mission intellectuelle centrale de la théorie de l’évolution. La sélection naturelle est la clé pour résoudre ces problèmes ; la sélection est la grande réponse. »
— Peter Godfrey-Smith, « Three kinds of adaptationism », Cambridge Univ. Press, 2001
Cette citation illustre parfaitement l’élévation quasi-religieuse de la sélection naturelle au rang de réponse ultime — “la grande réponse”. Dans le cadre du modèle CET, cette vision est profondément inversée.
Godfrey-Smith parle de “design apparent” comme s’il fallait impérativement expliquer l’apparence de design sans réel dessein. Le modèle CET, en revanche, part du constat que les organismes sont véritablement conçus, avec des mécanismes intégrés pour détecter les changements environnementaux et y répondre activement (comme un système cybernétique). Ce n’est pas le hasard et la sélection post-hoc qui créent la forme, mais des capacités d’ingénierie internes, préprogrammées.
Dire que “la sélection est la grande réponse” revient à déifier un concept abstrait : comme le disait Greg Graffin, on pourrait remplacer le mot “sélection naturelle” par “Dieu” dans nombre de textes évolutionnistes, tant ce mécanisme est présenté comme agentif, puissant et finaliste, alors qu’il est censé être aveugle et passif.
La SN “choisit”, “agit”, “façonne” — des verbes attribués à une entité intentionnelle.
Le CET ne tombe pas dans cette personnification : les organismes eux-mêmes sont les acteurs adaptatifs. L’environnement ne sélectionne pas passivement, les créatures s’auto-adaptent activement grâce à un système anticipatoire codé dans leur ADN.
Godfrey-Smith place la mission explicative de la biologie dans la sélection, et désigne cette sélection comme la solution. Mais il définit le problème par la solution, ce qui est une pétition de principe:
“Pourquoi les organismes sont-ils si bien adaptés ? — Parce qu’ils ont été sélectionnés.”
Mais cela n’explique pas l’origine des traits ni leur ingénierie complexe. C’est comme expliquer le fonctionnement d’un avion par “la gravité a sélectionné les bons modèles qui volent”, sans mentionner les ingénieurs, ni les plans.
Peter Godfrey-Smith expose ici une vision typique du darwinisme classique où la sélection naturelle joue le rôle d’un agent sans en avoir les attributs. Cette vision est remise en cause non seulement par les créationnistes mais aussi par des auteurs critiques comme Jerry Fodor, Denis Noble, ou Greg Graffin.
Le modèle CET, lui, revient à une perspective ancienne: ce n’est pas l’environnement qui sélectionne, mais l’organisme qui s’adapte, car il a été conçu avec des modules adaptatifs activés en fonction du contexte. La solution n’est donc pas la sélection, mais le design intégré.
Conclusion
De nombreuses publications scientifiques révèlent des merveilles sur le fonctionnement du génome, des cellules ou des organismes. Pourtant, au moment d’interpréter ces découvertes, elles introduisent des notions quasi mystiques comme la « sélection naturelle », non par nécessité scientifique, mais pour éviter toute référence au Créateur. Elles font précisément ce que Greg Graffin dénonçait : remplacer Dieu par une force impersonnelle agissant comme une divinité cachée.
Le problème n’est pas simplement un mauvais usage du terme « sélection naturelle » — c’est l’usage même du concept tel que Darwin l’a formulé dès le départ. Ce n’est pas un glissement de sens, c’est sa fonction d’origine : offrir une explication naturaliste qui remplace l’action volontaire d’un Dieu créateur. Dans un univers dominé par cette vision, Dieu devient superflu, puisque la sélection naturelle est censée accomplir son rôle : créer, adapter, ordonner, éliminer.
C’est pourquoi, pour beaucoup, l’évolution est une doctrine incontournable : l’abandonner reviendrait à ouvrir la porte à l’hypothèse d’une création — et donc à l’existence d’un Dieu à qui il faudrait rendre des comptes. Mais la science, par essence, ne devrait pas exclure des hypothèses pour des raisons philosophiques. Elle devrait examiner toutes les explications possibles, sans a priori.
Or, pour un grand nombre de personnes, c’est la sélection naturelle darwinienne qui a servi de tremplin vers l’athéisme. Elle est devenue le fondement de leur rejet de la Bible, de Jésus-Christ et du créationnisme biblique. Non parce que les faits l’exigent, mais parce que le darwinisme leur offre une échappatoire intellectuelle à la souveraineté divine.
Même les meilleurs scientifiques, y compris certains créationnistes, ont été induits en erreur par la métaphore puissante mais trompeuse de la « sélection naturelle » et de l’éleveur. En ce sens, on pourrait dire que certains créationnistes eux-mêmes adoptent malgré tout une posture « sélectionniste », sans forcément le réaliser.
Aujourd’hui, la théorie de l’évolution traverse une véritable crise. Un nombre croissant de chercheurs, issus de divers horizons scientifiques, commencent à la réévaluer sérieusement, car de plus en plus de données empiriques ne correspondent pas aux prédictions du modèle darwinien. La dissonance entre les faits observés et les explications proposées devient trop grande pour être ignorée.
Le Dr Guliuzza (modèle CET) déclare:
« La théorie de l’évolution n’abandonnera jamais complètement la sélection naturelle — jamais — même si les preuves ne correspondent pas, car tout repose sur l’usage d’une métaphore fausse. C’est l’attribution à la nature d’une capacité de sélection, une projection qui leur fournit un dieu de substitution. C’était le coup de grâce de Darwin: il a introduit cette idée en douce, et nous avons été dupés et séduits par elle.
Je ne pense pas qu’ils y renonceront un jour, car c’est ainsi qu’il a réussi à faire entrer subrepticement une forme d’agence de remplacement. Même s’ils doivent modifier la théorie dans toutes les directions, sous de multiples aspects, ils reviendront toujours à ces notions où, à un moment donné, quelque chose a été favorisé, sélectionné, influencé… Et ils reviendront à ce mysticisme.
Certaines personnes suivront les preuves là où elles mènent, c’est le message d’espoir. C’est peut-être une personne sur mille, une sur dix mille, je ne sais pas, mais il y a de l’espoir. »

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!