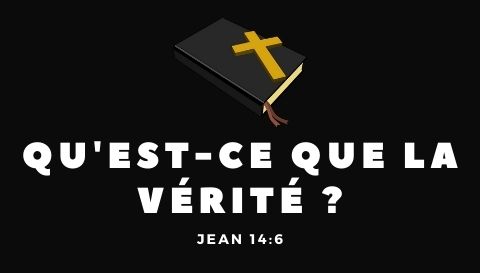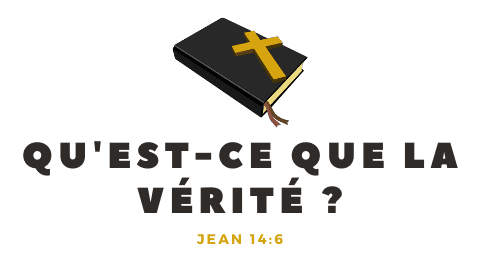La Sélection Naturelle est-elle un processus observable?
La sélection naturelle depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui a troublé ses propres partisans. Ce concept est-il « observable »? Est-il concret? Nous allons voir dans cet article que les évolutionnistes sont en difficulté pour exprimer et définir la sélection naturelle, ses contours et ce qu’elle est censée sélectionner.
Doolittle et Inkpen: rien n’a de sens en dehors du prisme de l’évolution?
« De nombreux biologistes praticiens acceptent que rien dans leur discipline n’a de sens en dehors du prisme de l’évolution, et que la sélection naturelle est le principal outil explicatif de cette vision. Mais ce que la sélection naturelle est réellement — une force réelle ou un résultat statistique, par exemple — ainsi que le niveau de la hiérarchie biologique (gène, organisme, espèce, voire écosystème) sur lequel elle agit directement,
font encore l’objet de débats actifs parmi les philosophes et biologistes théoriciens. »W. Ford Doolittle & S. A. Inkpen (2018). Processes and patterns of interaction as units of selection: An introduction to ITS-NTS thinking. PNAS 115(16): 4006–4014.
Doolittle et Inkpen posent ici trois constats majeurs.
Le dogme évolutif est accepté par défaut
Les biologistes considèrent généralement que rien n’a de sens sans l’évolution (fameuse formule de Dobzhansky). La sélection naturelle est vue comme le moteur principal de cette compréhension.
Mais personne ne sait ce qu’est vraiment la sélection naturelle
- Est-ce une force causale (comme la gravité)?
- Ou bien un résultat statistique passif, qu’on observe a posteriori?
- La définition de base est toujours floue, même après 150+ ans.
On ne sait même pas à quel niveau elle opère
Elle agit:
- sur les gènes?
- les organismes individuels?
- les espèces?
- ou même sur les écosystèmes entiers?
- Il n’y a pas de consensus dans la littérature scientifique.
Même dans les publications les plus prestigieuses, l’ambiguïté conceptuelle de la sélection naturelle est reconnue. Et cela affaiblit fortement son statut de “pilier” explicatif dans la biologie moderne.
Doolittle, un évolutionniste chevronné, admet qu’on parle de sélection naturelle comme d’un axiome fondamental tout en étant incapable d’en cerner les contours conceptuels.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
La sélection naturelle est le moteur de l’évolution… mais on ne sait pas ce que c’est, ni sur quoi elle agit vraiment…
Dawkins – le gène comme unité de sélection
« Un gène est défini comme toute portion de matériel chromosomique qui peut potentiellement durer assez longtemps au fil des générations pour servir d’unité de sélection naturelle. »
tirée de son célèbre ouvrage The Selfish Gene (1976), p. 28.
Dans cette citation, Dawkins exprime une idée clé de sa théorie du gène égoïste: il propose de redéfinir le gène non pas en termes classiques (une séquence codant une protéine, par ex.), mais en fonction de son rôle dans la sélection naturelle. En clair un gène, pour Dawkins, est ce qui est suffisamment stable et reproductible pour être « sélectionné » par la nature. Ce n’est donc pas une définition structurelle, mais fonctionnelle et téléologique.
Dawkins définit le gène par la sélection naturelle, mais la sélection naturelle agit sur des gènes, selon lui. On tourne en rond: la sélection explique les gènes, et les gènes définissent ce sur quoi agit la sélection. Dawkins réduit l’évolution à une lutte entre réplicateurs génétiques, où l’individu (l’organisme) est un simple véhicule (« survival machine »).
Dawkins redéfinit le gène comme ce qui dure assez longtemps pour être sélectionné, mais ce faisant:
- il fait de la sélection naturelle le critère premier,
- il remplace l’organisme par le gène comme acteur principal,
- et il transforme une notion biologique claire en une abstraction floue.
Un gène devient ce qui est sélectionné. Et ce qui est sélectionné devient ce qui est un gène. C’est circulaire.
Dennis Noble – l’organisme comme unité de sélection
« Nous devons déplacer notre attention du gène comme unité de sélection vers celle de l’organisme entier (Tautz 1992). »
Genes and Causation. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 366:3001–3015.
Dennis Noble, physiologiste et critique du réductionnisme génétique, appelle à abandonner la vision néo-darwinienne centrée sur le gène (notamment véhiculée par Dawkins) au profit d’une vision holistique, où l’organisme complet, avec ses systèmes intégrés (physiologie, comportement, environnement, etc.), est l’unité réelle sur laquelle agit la sélection.
Noble rejoint ici des approches plus « organismocentrées », en opposition au généticisme qui voit les gènes comme les seuls acteurs de l’évolution.
Scott F. Gilbert & David Epel – les équipes comme unité de sélection
« Cela pourrait permettre à la sélection naturelle de favoriser des ‘équipes’ plutôt que des individus particuliers, et même de privilégier les ‘relations’ comme unité de sélection. »
Ecological Developmental Biology: Integrating Epigenetics, Medicine, and Evolution, p. 370.
Gilbert et Epel, figures de la biologie du développement, évoquent ici l’idée que la sélection naturelle ne s’exerce pas forcément sur des entités isolées (comme les gènes ou les individus), mais sur des interactions complexes:
- des groupes coopérants (ex. : fourmis, colonies, meutes),
- ou des réseaux écologiques, symbioses, relations mère-enfant, etc.
Cela reflète la montée du paradigme évo-dévo (évolution du développement), où l’environnement, l’épigénétique et les interactions sont vus comme des forces co-déterminantes.
Ces deux citations expriment un rejet du modèle strictement génétique et individualiste de la sélection naturelle :
- Noble veut recentrer le débat sur l’organisme entier,
- Gilbert & Epel vont encore plus loin en évoquant des unités relationnelles (écosystèmes, groupes, symbioses).
Cela montre que même au sein du paradigme évolutionniste, il y a une grande instabilité conceptuelle sur la question de “qui ou quoi” est sélectionné, ce qui renforce les critiques du modèle classique basé uniquement sur des “gènes égoïstes”.
Andy Gardner – les « superorganismes » comme unité de sélection
Andy Gardner est un biologiste évolutionniste britannique, spécialiste de la théorie de la sélection de parentèle, de l’évolution sociale et des conflits d’intérêts biologiques. Il enseigne à l’Université de St Andrews. Son travail s’inscrit dans la tradition de W.D. Hamilton, mais il pousse plus loin certaines idées concernant la sélection au niveau du groupe.
Andy Gardner ne rejette pas la sélection naturelle, mais il la recontextualise. Il propose que dans certaines conditions, ce ne sont pas les gènes ou les individus qui sont les vraies unités de sélection, mais les groupes entiers, appelés « superorganismes ».
Un superorganisme est un groupe d’individus si étroitement intégrés et coordonnés dans leurs comportements (comme dans une fourmilière ou une ruche) qu’on peut les considérer comme un seul organisme à grande échelle.
Par exemple, dans une ruche:
- Les abeilles ouvrières ne se reproduisent pas,
- Elles nourrissent la reine, protègent la colonie, et communiquent de façon très sophistiquée,
- L’ensemble de la colonie fonctionne comme un seul corps, avec une « reine » pour système reproducteur, des « ouvrières » pour système digestif/protecteur, etc.
Pour Gardner, la sélection naturelle peut agir sur l’ensemble du groupe dans ce cas, et favoriser les traits qui profitent à la survie du collectif, même si certains individus s’autosacrifient.
Le darwinisme classique met l’accent sur la compétition entre individus (ou même entre gènes, cf. Dawkins). Gardner et d’autres élargissent le cadre : dans certaines structures sociales extrêmement intégrées, la coopération devient la cible même de la sélection. Cela remet en question l’idée que la nature est uniquement une “lutte pour la vie” individuelle.
Ce type de théorie reconnaît l’organisation incroyablement fine et coordonnée de certaines espèces (insectes sociaux, bactéries, etc.). Il pose implicitement la question du design : comment une telle intégration fonctionnelle peut-elle émerger sans plan global?
Gardner a écrit plusieurs articles sur le sujet, par exemple:
- Gardner, A. & Grafen, A. (2009). Capturing the superorganism: a formal theory of group adaptation. Journal of Evolutionary Biology, 22(4), 659–671.
La sélection naturelle pour le bien de l’espèce?
« Les adaptations augmentent toujours la condition physique (fitness) de l’individu, pas nécessairement celle du groupe ou de l’espèce. L’idée que la sélection naturelle agit ‘pour le bien de l’espèce’, bien que courante, est erronée. »
tirée de son livre Why Evolution Is True (2009, p. 121)
Coyne affirme ici un principe fondamental du darwinisme moderne:
- Les adaptations sont sélectionnées parce qu’elles augmentent les chances de survie et de reproduction de l’individu qui les porte.
- Il rejette l’idée selon laquelle la sélection naturelle agirait au profit de l’espèce ou du groupe dans son ensemble, ce qu’on appelle parfois sélection de groupe.
Ce que Coyne veut corriger Beaucoup de gens croient à tort que la nature « fait ce qui est bon pour l’espèce ». Par exemple les lions tuent les petits d’un autre mâle pour éviter la surpopulation mais ce genre de raisonnement téléologique (finaliste) suppose que la nature a une intention ce que Coyne rejette. Pour Coyne, le moteur réel est l’avantage reproductif individuel, même si cela nuit au groupe ou à l’espèce.
C’est frappant car même des créationnistes disent que Dieu a mis en place la sélection naturelle pour le bien de l’espèce, pour préserver la pureté génétique du troupeau, mais l’évolutionniste Jerry Coine nous dit que ce n’est pas le cas.
Lecointre – au niveau de l’espèce comme au niveau de l’individu
« La sélection naturelle explique autant la stabilité des structures du vivant que leur changement. On considère aujourd’hui que ce mécanisme du changement s’applique aussi bien à l’individu qu’à l’espèce.«
Lecointre intervertit souvent les termes « sélection naturelle » et « évolution », ce qui montre à quel point la théorie darwinienne repose entièrement (ou presque) sur la sélection naturelle:
L’évolution est source de changement mais aussi de régularité.
Cette phrase illustre un paradoxe fondamental du discours évolutionniste moderne.
Comment un même mécanisme pourrait-il simultanément expliquer des phénomènes opposés, à la fois la stabilité et le changement, l’invariance morphologique comme la diversification des espèces? Cette élasticité du concept donne l’impression que la sélection naturelle n’est pas un principe rigoureux, mais une grille interprétative universelle, malléable à volonté.
Ce flou est accentué par le fait que les évolutionnistes eux-mêmes ne s’accordent pas sur ce qui est réellement « sélectionné »:
- pour certains, ce sont les individus (Darwin, Dawkins avec le « selfish gene ») ;
- pour d’autres, ce sont les groupes, les espèces, les gènes, les phénotypes, voire même les interactions environnementales.
Un processus réellement observable devrait produire une définition stable, avec un consensus expérimental sur son action. Le fait qu’il soit invoqué pour justifier à la fois des cas de conservation (stase morphologique, « fossiles vivants ») et d’innovation (apparition de nouvelles structures complexes) montre qu’on est davantage dans une narration ad hoc que dans une explication prédictive rigoureuse.
En réalité, la stabilité morphologique, par exemple chez les « fossiles vivants » comme le cœlacanthe ou le ginkgo, s’explique bien mieux par la robustesse des instructions génétiques : un programme héréditaire bien conservé, résistant aux mutations, qui maintient l’organisme dans un état fonctionnel stable au fil des générations.
Quant au changement, il ne vient pas d’une sélection extérieure qui « ajuste » passivement des organismes, mais d’un potentiel interne : un système adaptatif conçu pour répondre activement à des stimuli environnementaux. Les changements observés — qu’ils soient morphologiques, comportementaux ou physiologiques — peuvent être interprétés comme des réponses programmées, déclenchées par des capteurs, des réseaux de régulation, des voies de signalisation, etc.
Ainsi, au lieu d’attribuer à un principe flou comme la « sélection naturelle » à la fois le maintien du statu quo et l’origine de l’innovation, il est plus cohérent d’attribuer:
- la stabilité aux instructions héréditaires codées,
- le changement aux capacités adaptatives intégrées dans l’organisme, un design orienté, non un tri aveugle.
Mayr: les gamètes comme unité de sélection
« Toutefois, en plus de l’individu, un groupe peut aussi être la cible de la sélection s’il s’agit d’un groupe social et si la coopération au sein de ce groupe améliore sa survie. Enfin, les gamètes sont également directement exposés à la sélection, et les différents gamètes produits par un même individu peuvent différer dans leur capacité à assurer la fécondation. »
provient de son ouvrage What Evolution Is (2001, p. 280)
Ernst Mayr souligne ici la complexité du concept de sélection naturelle, en élargissant le spectre des unités de sélection:
L’individu comme unité classique de sélection
C’est le modèle darwinien standard les traits bénéfiques pour la survie ou la reproduction d’un individu sont sélectionnés.
Le groupe comme cible secondaire
Mayr admet que la sélection de groupe est possible si un groupe social coopératif améliore la survie collective. Cela rejoint des idées développées plus tard par Edward O. Wilson et Andy Gardner (voir le passage précédent sur les superorganismes). Mais cela reste une position minoritaire chez les néo-darwiniens classiques, dont Coyne (voir passage précédent).
3Les gamètes comme cible microscopique
Même au niveau cellulaire, la sélection peut s’exercer: certains spermatozoïdes d’un même individu peuvent être plus compétitifs que d’autres pour féconder un ovule. Cela souligne selon Mayr que la sélection peut agir à différents niveaux biologiques: gènes, cellules, individus, groupes.
Ernst Mayr n’est ni exclusivement individualiste, ni radicalement pluraliste comme ses collègues, il reconnaît la pertinence de plusieurs niveaux de sélection, selon les circonstances. Cela complexifie le tableau évolutionniste et montre que la sélection naturelle n’est pas une entité univoque, mais un concept aux contours flous et contextuels.
New scientist – les relations comme unité de sélection
« Le livre The Selfish Gene de Richard Dawkins a popularisé l’idée que le gène, et non l’individu, était la véritable unité d’évolution. Cette vision a largement dominé la génétique évolutionnaire. Mais les biologistes Itai Yanai et Martin Lercher, dans The Society of Genes, proposent de remplacer cette métaphore du gène égoïste par une vision plus centrée sur les relations. »
[Source : New Scientist, article de 2016 – lien : https://www.newscientist.com/article/mg22930561-000-the-society-of-genes-time-for-a-subtler-picture-of-evolution/]
Le modèle du « gène égoïste » (Dawkins, 1976) présente chaque gène comme agissant pour sa propre reproduction, même si cela nuit à l’organisme ou à l’espèce. L’organisme est vu comme un « véhicule » temporaire, un simple porteur de gènes. Ce modèle a influencé des décennies de biologie évolutive (en particulier la sociobiologie, la génétique comportementale…).
Yanai et Lercher jugent cette métaphore trop individualiste, simpliste et réductrice. Ils proposent une nouvelle image : celle de la société des gènes. Les gènes n’agissent pas isolément. Ils coopèrent dans des réseaux dynamiques, à l’intérieur d’un contexte cellulaire, épigénétique, et environnemental. On passe donc d’une biologie fondée sur des entités isolées et concurrentes à une biologie des relations, des interactions et des contextes.
Cette citation illustre que même dans les cercles évolutionnistes, les anciennes explications simplistes (comme celle du gène égoïste ou de la sélection naturelle omnipotente) sont remises en question. Le paradigme se déplace vers une vision plus intégrée, parfois plus proche de conceptions internalistes ou structuralistes.
Cela offre un point d’appui stratégique pour des modèles comme le Continuous Environmental Tracking (CET) ou des visions créationnistes plus systémiques, centrées sur la programmation interne et la coopération entre composants biologiques.
Doolittle et Inkpen – des processus comme unité de sélection
« [La sélection naturelle] permet de concevoir l’évolution de façon à ce que non seulement des objets mais aussi des processus puissent être des « unités de sélection », sélectionnés pour leur persistance et leur reproduction — mais sans être eux-mêmes des entités reproductrices. »
W. Ford Doolittle et S. Andrew Inkpen (2018). Processes and patterns of interaction as units of selection: An introduction to ITSNTS. PNAS. 115 (16): 4006-4014
Traditionnellement, une unité de sélection est un organisme, un gène, voire un groupe qui se reproduit, et sur lequel la sélection naturelle agit en favorisant ceux qui réussissent à laisser plus de descendants.
Mais ici, Doolittle et Inkpen élargissent le concept: la sélection ne s’appliquerait pas uniquement à des « choses » matérielles (comme un gène ou un individu), mais aussi à des processus, comme des interactions, des symbioses, ou des réseaux écologiques.
Sélectionnés pour persister et être reproduits, mais sans se reproduire eux-mêmes » :
Cela signifie que certaines structures ou systèmes ne se reproduisent pas comme des gènes ou des individus, mais sont maintenus parce qu’ils fonctionnent efficacement, parce qu’ils soutiennent la survie d’autres entités, ou parce qu’ils sont copiés/imités/transmis indirectement (comme un comportement, un écosystème, une organisation cellulaire…).
Cette citation montre que le concept même de sélection naturelle est devenu si large qu’il englobe aujourd’hui des éléments non matériels et non reproductifs. Cela pose des questions fondamentales sur la cohérence du modèle darwinien: si on peut appeler « sélection » ce qui concerne des processus, des structures non génétiques ou même des interactions abstraites… alors le concept perd en précision scientifique.
Arthur Lander – des objectifs d’ingénierie comme unité de sélection
« Nous acceptons que des objectifs d’ingénierie comme la robustesse, et pas seulement les phénotypes, soient l’objet de la sélection naturelle. »
Arthur Lander. 2016. What Have the Principles of Engineering Taught Us about Biological Systems? Cell Systems, 2(1): 5–7.
Lander propose que la sélection naturelle ne se limite plus seulement à la forme visible ou à la fonction d’un organisme (le phénotype), mais qu’elle sélectionne aussi des caractéristiques abstraites, comme :
- la robustesse (capacité à résister aux perturbations),
- la résilience (capacité à se rétablir après un stress),
- ou l’efficacité (capacité à accomplir une fonction avec un coût minimal).
Ces propriétés sont typiquement issues du vocabulaire de l’ingénierie ou des systèmes dynamiques, et ne sont pas observables directement dans l’organisme comme des plumes ou des dents, ce sont des concepts fonctionnels ou comportementaux complexes.
Cela reflète le flou croissant autour du concept de sélection naturelle. Plus le terme englobe des éléments abstraits, moins il est scientifiquement rigoureux ou testable. C’est aussi révélateur de l’anthropomorphisme implicite: on parle d’objectifs comme si la nature poursuivait des fins (ce qui est précisément ce que Darwin voulait éviter dans une science sans dessein).
La sélection naturelle se mesure au nombre de variation produite?
La sélection naturelle se mesure au nombre de descendants que produit une variation. S’ils sont héritables, les traits qui auront le plus de chances d’être représentés à la génération suivante sont ceux qui permettent de:
- capter des ressources
- échapper à ses prédateurs
- attirer le sexe opposé
- tirer parti d’une association entre espèces
- tirer parti d’associations au sein même de l’espèce
- générer de la variation
L’idée selon laquelle le nombre de descendants produits par un organisme porteur d’une variation constituerait une preuve de « sélection naturelle » est trompeuse. Ce constat, que certains survivent et d’autres non, n’explique en rien l’origine des caractéristiques de ceux qui survivent.
En réalité, les organismes sont déjà pourvus des outils nécessaires pour capter des ressources, échapper à leurs prédateurs ou se reproduire. Ce sont des capacités intégrées et fonctionnelles. Le fait que certains individus possèdent une variation légère (probablement délétère) n’implique pas que cette variation ait été produite par sélection ou désélection naturelle. Si c’est une variation positive, elle peut simplement résulter d’un mécanisme de plasticité génétique ou d’un processus de régulation environnementale anticipée.
Les auteurs qui parlent d’adaptation rapide ces dernières décennies, ne documentent pas de sélection naturelle, il n’y a pas d’observation d’individus « non adaptés » mourant sans descendance. Il n’y a pas eu de processus de tri visible sur des milliers d’individus, mais une réorganisation rapide de traits physiologiques et comportementaux. Les modifications sont constatées de manière généralisée dans la population.
Affirmer que ceux qui survivent ont été « sélectionnés » revient à déduire la cause du résultat, sans en démontrer le mécanisme. C’est une inférence circulaire. Que certains organismes meurent et d’autres vivent ne permet pas d’expliquer comment les traits présents chez les survivants, et chez les décédés, sont apparus en premier lieu. Par exemple, un pelage épais ne surgit pas parce qu’il fait froid, le froid ne code pas le génome. Il révèle seulement une capacité déjà présente.
L’autre affirmation selon laquelle certains traits seraient sélectionnés parce qu’ils « génèrent plus de variation » est incohérente. Les traits eux-mêmes n’ont pas pour fonction de générer de la variation, ils sont le produit de l’expression génétique, pas son moteur.
Les organismes ne possèdent pas un « gène de la variation » qui rendrait leur descendance plus diverse de génération en génération. En réalité, la variation est limitée, encadrée par des mécanismes régulés (ex. recombinaison, plasticité phénotypique, épigénétique). Aucun organisme ne semble produire plus de variation que son ancêtre d’une génération antérieure, la variabilité reste constante ou se dégrade, selon l’entropie génétique.
La sélection naturelle, en tant que simple constat que certains survivent et d’autres non, n’est pas une explication causale de l’origine des traits. Elle n’explique ni l’apparition des caractéristiques fonctionnelles, ni leur complexité, ni leur ajustement fin à un environnement. Quant aux mutations, loin de générer de nouveaux programmes complexes, elles tendent à dégrader des fonctions existantes ou à activer des mécanismes déjà codés.
Ce que nous observons, ce ne sont pas des mécanismes aveugles et chaotiques de « tri », mais des capacités adaptatives ciblées, rapides, et intégrées dès le départ dans l’organisme, ce qui correspond davantage à une conception programmée, intentionnelle, conçue.
La nature sélectionne t-elle quoi que ce soit?
Les évolutionnistes eux-mêmes sont loin d’être unanimes sur ce que la sélection naturelle est censée « sélectionner ». Selon les auteurs, elle peut viser les gènes (comme dans la vision du « gène égoïste » de Dawkins), les individus, les groupes sociaux, les gamètes, voire même des relations ou des processus abstraits comme la coopération ou la robustesse. Cette diversité de points de vue révèle un flou conceptuel profond: il n’existe pas de consensus clair sur l’unité réelle de sélection, ni même sur la nature précise de cette force invoquée.
Mais cela soulève une question plus fondamentale: la nature sélectionne-t-elle réellement quelque chose ? Le terme même de « sélection » implique une forme de choix, une intention, une évaluation comparative. Or, la nature n’est pas un agent conscient capable de prendre des décisions. Parler de la nature comme d’un éleveur ou d’un juge revient à projeter une capacité décisionnelle sur un ensemble de processus aveugles et non dirigés. C’est une analogie trompeuse, qui donne l’illusion d’un mécanisme organisé là où il n’y a qu’un jeu de variations et d’éliminations postérieures. La « sélection » est une abstraction statistique, non une cause active.
En réalité, c’est l’organisme qui agit, s’ajuste, s’adapte ou échoue et non un pouvoir caché de la nature. La perspective créationniste ou internaliste (comme celle défendue par le modèle CET – Continuous Environmental Tracking) recentre le regard sur l’ingénierie interne, la capacité intrinsèque des êtres vivants à réagir selon des programmes et des capteurs prévus à cet effet. Cela redonne la place au design biologique, et non à une nature personnifiée à tort.
Gould: « tout » comme unité de sélection?
« Mais, après avoir légitimement défini le problème, il [Emerson] se lance ensuite dans une affirmation presque lyrique, et tout simplement illogique, selon laquelle presque tout ce qui possède des limites définissables peut être reconnu comme une unité de sélection naturelle :
“La sélection naturelle opère à chaque niveau d’intégration, du gène et des caractères polygéniques complexes à l’intérieur de l’individu, à l’individu dans son ensemble, et à divers niveaux de systèmes de population intraspécifiques et de systèmes communautaires interspécifiques inter-adaptés, ainsi qu’aux écosystèmes.” »
« … il [Emerson] n’a jamais compris pleinement la logique et les implications de cette question, et il s’est aventuré sans discernement de haut en bas parmi les niveaux possibles [par exemple, gène, organisme, populations], sans saisir les problèmes théoriques impliqués par de telles excursions. »
Stephen Jay Gould. 2002. The Structure of Evolutionary Theory. Cambridge, Massachusetts : Belknap Press of Harvard University Press, pp. 544–545.
Stephen Jay Gould critiquait fortement une tentative d’étendre le concept de sélection naturelle à pratiquement tous les niveaux d’organisation biologique, des gènes aux écosystèmes entiers. Il reproche à Emerson (un biologiste) d’avoir d’abord correctement identifié un problème réel, à savoir, la difficulté de définir précisément ce qu’est une « unité de sélection », puis d’avoir glissé vers une affirmation excessive et incohérente selon laquelle toute entité délimitée pourrait être considérée comme une unité de sélection naturelle.
Gould souligne le danger d’une telle généralisation: en voulant faire de la sélection naturelle une explication universelle, on perd toute rigueur conceptuelle. Il déplore que certains auteurs naviguent indistinctement entre différents niveaux d’analyse (gène, individu, population, communauté), sans se soucier des implications théoriques complexes de ces déplacements. Pour lui, cette approche affaiblit la théorie au lieu de l’éclairer, car elle transforme un concept censé être opératoire en une catégorie floue et omniprésente.
Gould met en garde contre une utilisation inflationniste du concept de sélection naturelle, qui perdrait en précision ce qu’elle gagne en généralité. C’est une critique lucide d’une dérive fréquente dans le discours évolutionniste: expliquer trop de choses avec un concept mal défini.
La sélection de naturelle: de la poudre de perlimpinpin?
On peut comparer la sélection naturelle à de la poudre de perlimpinpin: ses partisans lui prêtent toutes les vertus possibles, comme si elle pouvait résoudre tous les mystères de la biologie. Peu importe le problème: apparition d’une aile, d’un œil, d’un organe, d’un comportement, la sélection naturelle serait la solution. C’est précisément ce qui rend le concept suspect : un principe censé tout expliquer devient, en réalité, un écran de fumée.
À la différence des processus bien définis qu’on retrouve dans l’ingénierie, par exemple une chaîne de production où l’on peut observer un processus de sélection concret, avec un agent identifiable qui choisit ou élimine des pièces, la sélection naturelle, elle, ne montre aucun agent réel, aucune mécanique observable claire. Ce que les biologistes évolutionnistes prétendent « voir » dépend souvent de leurs propres présupposés. Ils ne perçoivent pas un phénomène tangible, mais projettent une interprétation.
Certains poussent même l’analogie jusqu’à proposer une « sélection naturelle cosmologique », censée s’appliquer à l’univers lui-même, aux galaxies, voire aux lois physiques… Ce genre de dérive montre à quel point certains sont prêts à élargir indéfiniment un concept flou pour éviter toute référence à un Créateur. Ce n’est plus de la science observable, c’est une construction intellectuelle, une explication fourre-tout, qui finit par ressembler davantage à une croyance philosophique qu’à une démarche rigoureuse.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!