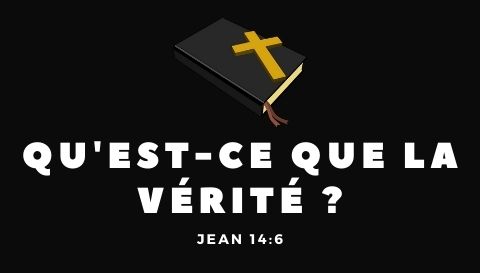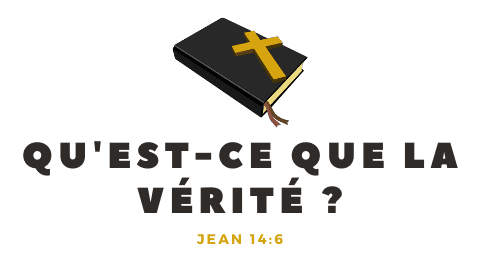Le Paradoxe de la Formation des Premières Étoiles dans le Modèle Standard
Une citation intéressante de Marcus Chown (consultant en cosmologie pour le magazine New Scientist) nous explique l’impasse du modèle séculier concernant la formation des premières étoiles:
« D’une manière générale, une étoile se forme lorsqu’un nuage de gaz s’effondre par gravité. Cependant, si le nuage est trop chaud, la pression combattra l’effet de la gravité et empêchera le nuage de s’effondrer. Donc, pour former une étoile, le nuage de gaz doit avoir un moyen de se refroidir.
Ce n’est pas aussi simple que cela puisse paraître. Dans l’Univers d’aujourd’hui, cela est accompli par une vaste gamme de molécules qui entrent en collision et rayonnent de la chaleur.
Cependant, les atomes nécessaires à la fabrication de toutes les molécules sauf les plus simples – l’hydrogène moléculaire – doivent être fabriqués à l’intérieur des étoiles. C’est la situation de l’œuf et la poule.« 1
En théorie, une nébuleuse de gaz (principalement de l’hydrogène) s’effondre sous sa propre gravité, formant une étoile mais cet effondrement n’est pas automatique car si le gaz est trop chaud, la pression thermique empêche l’effondrement. Pour que le gaz s’effondre, il doit perdre de l’énergie, autrement dit, se refroidir. Ce refroidissement serait assuré par des collisions de molécules qui émettent des photons, dissipant l’énergie thermique.
Dans l’univers actuel, des molécules complexes (eau, CO, CH4, etc.) sont censées rayonner efficacement la chaleur. Ces molécules aideraient le gaz à se refroidir ce qui favoriserait la formation d’étoiles mais ces molécules refroidissantes (comme H₂O, CO…) nécessitent du carbone, de l’oxygène, de l’azote… or, ces éléments sont produits dans les étoiles, via la nucléosynthèse stellaire. Mais s’il faut des étoiles pour fabriquer ces molécules… comment les premières étoiles ont-elles pu se former sans elles?
Aujourd’hui, selon les évolutionnistes, les étoiles se forment grâce à un refroidissement efficace dû à des molécules contenant des métaux (éléments lourds). Mais au début, il n’y avait pas encore de métaux, donc comment les premières étoiles ont-elles pu se former?
C’est un paradoxe non résolu, qui questionne la cohérence du scénario standard de formation des étoiles de population III.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
Le modèle naturaliste de formation stellaire implique une boucle causale non expliquée, tandis qu’un univers créé avec maturité ou ordonné dès le début n’a pas besoin de « faire naître les étoiles » progressivement.
Les paradoxes sont nombreux chez les évolutionnistes:
« L’origine du carbone est moins claire ; certaines études situent sa naissance dans des étoiles plus massives qui ont explosé, tandis que d’autres études affirment exactement l’inverse. »
— Lea, R., Astronomy.com, 4 août 2020

John G. Hartnett, dans l’article intitulé “Stars just don’t form naturally—‘dark matter’ the ‘god of the gaps’ affirme que les étoiles ne peuvent pas se former naturellement en respectant les lois connues de la physique.
Pour surmonter cet obstacle, les cosmologistes postulent l’existence de la matière noire, une entité jamais observée directement, ce qui revient à invoquer une divinité imaginaire pour combler une lacune du modèle matérialiste (un peu comme la sélection naturelle).
La matière noire est invisible, inobservable, non détectée en laboratoire après 40 ans de recherche. Elle est inventée pour rendre les modèles cosmologiques cohérents avec les observations (ex. : vitesses de rotation des galaxies). Selon Hartnett, elle est utilisée comme substitut à Dieu dans une vision matérialiste: c’est une « entité magique » qui fournit de la gravité sans interaction physique connue.
Lorsqu’un nuage de gaz (essentiellement hydrogène) commence à se contracter par gravité, il chauffe, ce qui génère une pression vers l’extérieur. À un moment donné, cette pression équilibre la gravité, et l’effondrement s’arrête et aucune étoile ne peut se former sans intervention extérieure.
Pour surmonter ce blocage, les modèles proposent:
- Un refroidissement lent du nuage (souvent irréaliste ou trop lent).
- Une compression externe, par exemple via une onde de choc d’une supernova (mais cela pose un problème circulaire: qui a créé la première étoile pour produire la première supernova ?).
- Une majorité de matière noire, qui ajoute de la gravité sans ajouter de chaleur, permettant de dépasser le seuil de blocage.
Aucune de ces solutions n’est satisfaisante sans “tricher” en amont dans les simulations. Les simulations informatiques trichent. Elles commencent avec un nuage déjà dense, ce qui contourne le problème du seuil de Jeans2. Elles ajoutent arbitrairement de la matière noire dès le départ pour permettre la formation d’étoiles ou de galaxies. Cela revient à écrire l’histoire avec les conclusions déjà décidées.
Si la masse du nuage est supérieure au seuil de Jeans, l’effondrement peut avoir lieu.
Hartnett conteste l’idée que nous observons aujourd’hui la formation d’étoiles. Ce que les astronomes identifient comme “régions de formation stellaire” sont selon lui des interprétations d’émissions lumineuses, pas des preuves directes d’effondrement gravitationnel en cours. La spirale galactique (ex. : bras de Bode) est aussi expliquée par des hypothèses nécessitant de la matière noire, mais cela n’est pas observé.
Les astronomes n’observent pas directement un nuage en train de devenir une étoile, mais déduisent qu’il s’en forme à partir de signaux lumineux forts (ex. : nébuleuses avec émission H-alpha). Les mécanismes invoqués pour compresser les nuages (supernova, ondes de densité, champs magnétiques) n’expliquent rien de manière satisfaisante. La matière noire est encore invoquée pour justifier la dynamique galactique actuelle (spirales, gravité supplémentaire).

Les étoiles que l’on observe dans les nébuleuses aujourd’hui sont jeunes, certes, mais ont été créées telles quelles. Les régions dites « pouponnières d’étoiles » sont des environnements dynamiques, mais pas des sites de formation réelle. Ce que les astronomes identifient comme des régions de formation stellaire sont des inférences, pas des observations d’étoiles en cours de formation. Les nébuleuses sont des environnements actifs, pas des lieux de création.
Jason Lisle dans l’article « Blue Stars Confirm Recent Creation » affirme que la formation naturelle des étoiles n’a jamais été observée directement, malgré ce que laissent entendre certains manuels ou articles populaires. Les images de nébuleuses appelées « pouponnières d’étoiles » ne prouvent pas que des étoiles se forment, mais sont interprétées ainsi sur la base de présupposés naturalistes. Selon lui, aucun astronome n’a vu un nuage de gaz passer de l’état diffus à une étoile complète.
Sur Terre, un gaz occupe tout l’espace disponible. Dans l’espace, sans conteneur, le gaz tend à se diluer, pas à se concentrer. La gravité d’un nuage diffus est trop faible pour compenser cette expansion. Et même un faible champ magnétique devient très intense lors de la compression d’un nuage. Cela agit comme une force de répulsion, empêchant le nuage de continuer à se contracter.
Les nuages tournent toujours un peu. En se contractant, cette rotation augmente fortement (loi de conservation du moment angulaire). Cela génère une force centrifuge qui s’oppose à l’effondrement gravitationnel.

NASA’s James Webb Space Telescope from Greenbelt, MD, USA – nébuleuse de la Carène
Lisle insiste sur les obstacles physiques majeurs à la formation stellaire. Les nuages de gaz tendent naturellement à se dilater, et non à se contracter. De plus, la pression magnétique, la rotation (moment angulaire) et la pression thermique s’opposent toutes à l’effondrement gravitationnel nécessaire à la naissance d’une étoile. Même si le gaz pouvait se comprimer, ces forces rendraient le processus instable ou le bloqueraient totalement.
Face à cela, les cosmologistes invoquent des déclencheurs externes comme des supernovæ, mais cela pose un problème circulaire pour la première étoile. Ces difficultés physiques rendent la formation naturelle très improbable, voire invraisemblable. Les étoiles ont été créées surnaturellement par Dieu il y a quelques milliers d’années, comme l’enseigne la Genèse, ce qui correspond mieux aux observations actuelles, notamment l’existence d’étoiles jeunes et massives.
La Genèse affirme que Dieu a créé les étoiles le 4e jour. Ainsi la formation des étoiles est un acte surnaturel ponctuel, non reproductible. Le fait que la physique naturelle empêche la formation d’étoiles soutient le modèle créationniste: les étoiles ne se forment pas naturellement… elles ont été créées.
Il est impossible de former des étoiles sans enfreindre les lois de la physique connues, à moins d’inventer une entité invisible, la matière noire, dotée des propriétés nécessaires. Cela démontre la faillite du matérialisme, qui doit être remplacé par une vision biblique surnaturelle de l’origine de l’univers.

La formation naturelle d’étoiles est contredite par la physique. L’univers regorge d’étoiles jeunes (comme les étoiles bleues, très massives et de courte durée de vie: moins d’1 million d’années), ce qui suggère un univers jeune.
« Nous partons d’une fondation fragile », explique le cosmologiste Carlos Frenk de l’Université de Durham, au Royaume-Uni.
« Nous ne comprenons pas comment une seule étoile se forme, mais nous voulons comprendre comment 10 milliards d’étoiles se forment. »
Son collègue théoricien Simon White de l’Institut Max Planck d’astrophysique à Garching, en Allemagne, est d’accord: «Les recettes simples des modèles publiés ne reproduisent pas la formation d’étoiles que nous voyons. Les théoriciens doivent maintenant grandir. »
Robert Irion (Director, Science Communication Program, UC Santa Cruz), Surveys scour the cosmic deep, Science 303(5665):1750–1752, 2004.”
Voici une citation rigolote:
Parmi les problèmes en suspens, citons comment et quand l’univers a commencé, comment les galaxies se sont formées et ont atteint leur éventail observé de formes et de tailles, comment les étoiles sont nées et comment les planètes et la vie ont évolué.
Silk,J., The Big Bang, Freeman & Co, San Francisco, 1980, p1.
- Marcus Chown (astronomer) “Let there be light” New Scientist, 7 Feb 1998, p.30.
- Le seuil de Jeans est la masse minimale qu’un nuage de gaz doit atteindre pour que la gravité l’emporte sur la pression du gaz (qui tend à faire le nuage s’étendre). Si elle est inférieure, la pression interne est trop forte, et le nuage ne s’effondrera pas.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!