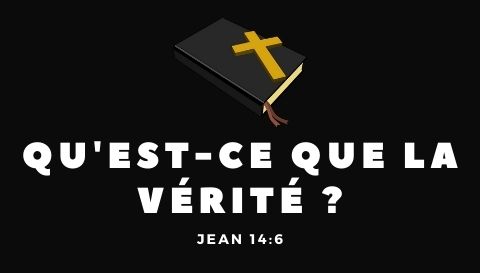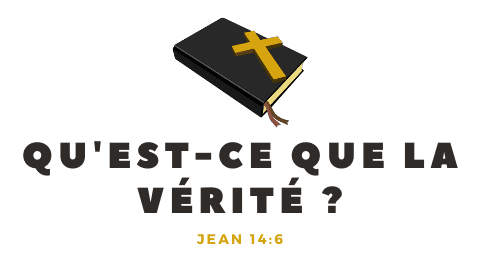Malthus, Darwin et la Logique Externaliste de l’Évolution
Dans le monde de Darwin, on parle de « sélection naturelle » comme d’une force qui choisit, trie, optimise mais sans volonté, sans intelligence, sans direction. C’est là une contradiction majeure: on attribue à un processus inconscient une capacité créatrice semblable à celle d’un artisan ou d’un ingénieur. La nature devient une sorte de « démiurge aveugle » capable de bâtir des merveilles fonctionnelles sans intention.
À l’ICR, au contraire, l’approche est résolument centrée sur l’organisme lui-même: on observe ses capteurs internes, ses mécanismes de traitement de l’information, ses réponses ciblées et coordonnées, en somme, un véritable système intégré, autonome et préprogrammé pour s’adapter. Ce ne sont pas des mutations aléatoires triées de l’extérieur qui produisent ces capacités, mais un design interne, orienté, orientable, dynamique.
Là où le darwinisme déplace la cause vers un environnement abstrait, le modèle biblique et le modèle CET redonne à l’organisme son rôle d’acteur adaptatif, ce qui pointe naturellement vers un Créateur intelligent, non vers un hasard créatif.
Internalisme vs Externalisme (selon Marta Linde Medina)
« Le terme “internaliste” fait référence à la nature du principe organisateur originel de la forme biologique.
(Dans le véritable “externalisme”, le principe organisateur originel est imposé de l’extérieur, peu importe la manière dont il peut ensuite s’inscrire dans l’organisme).Plus précisément, lorsqu’on affirme que la forme doit être expliquée en termes fonctionnels, le principe organisateur est externe. »
Marta Linde Medina. 2011. Reply to the Comments on “Natural Selection and Self-Organization: A Deep Dichotomy in the Study of Organic Form”. Ludus Vitalis, 19(36) : 387.
Internalisme
La forme biologique vient de l’intérieur: elle est guidée par des principes intégrés à l’organisme (développement, auto-organisation, design interne).
Externalisme
La forme est imposée de l’extérieur: elle résulte de pressions de l’environnement (fonction, utilité, sélection naturelle).
Si on explique la forme par sa fonction, on adopte une cause externe.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
- Le darwinisme est externaliste: l’environnement façonne.
- Le modèle CET est internaliste: l’organisme est conçu pour s’adapter par lui-même.
Dieu est le potier. L’environnement ne crée rien.
La logique externaliste du darwinisme
« Darwin considérait que l’environnement disait à l’organisme comment varier, et il proposait un mécanisme pour hériter de ces changements. L’organisme était comme de l’argile à modeler, et chaque petit grain pouvait se déplacer légèrement dans n’importe quelle direction pour produire une nouvelle forme.«
Tirées de Marc W. Kirschner et John C. Gerhart, The Plausibility of Life, 2005. Yale University Press: New Haven, Connecticut, p. 3, 31.
Cette citation expose de manière frappante la vision darwinienne classique:
- L’organisme est passif, comme de l’argile.
- L’environnement dicte les changements, informe la variation, oriente ce qui est possible.
- Il n’y a ni but, ni direction interne, seulement des réponses modelées de l’extérieur.
Cela illustre l’externalisme pur: l’environnement agit comme un sculpteur aveugle, qui « façonne » des formes biologiques au fil du temps, sans que l’organisme n’ait de mécanismes internes de pilotage ou d’intention.
« Si un organisme avait besoin d’une aile, d’un pouce opposable, de jambes plus longues, de pieds palmés ou d’un placenta…Chacune de ces structures finirait par émerger sous des conditions sélectives appropriées avec le temps.«
Tirées de Marc W. Kirschner et John C. Gerhart, The Plausibility of Life, 2005. Yale University Press: New Haven, Connecticut, p. 3, 31.
Cette citation va encore plus loin: elle donne à la sélection naturelle un pouvoir presque magique. Peu importe le type de structure nécessaire (aile, main humaine, placenta), elle apparaîtra si l’environnement « l’exige ». C’est une vision presque téléologique sans intention, comme si la nature produisait ce qui est nécessaire, simplement par besoin, sans designer.
Cela revient à dire: « Donnez assez de temps et assez de pression environnementale, et tout peut apparaître. »
Mais ce que cela occulte totalement, c’est:
- l’origine de l’information génétique,
- la coordination de multiples systèmes intégrés,
- les limites biologiques internes réelles.
Le modèle CET (Continuous Environmental Tracking) réfute précisément ce type de raisonnement. Il montre que:
- Les organismes sont conçus avec des capacités d’adaptation intégrées.
- Ils ne subissent pas passivement leur environnement, ils le détectent et y répondent activement.
- L’information nécessaire à l’ajustement est déjà présente dans leur design.
Contrairement à la vision où « tout peut émerger avec le temps », le modèle CET insiste sur le fait que l’information ne peut venir que d’une source intelligente.
Ces deux citations montrent la pensée darwinienne poussée à l’extrême:
l’environnement comme sculpteur tout-puissant,
l’organisme comme argile sans volonté ni structure,
et la forme biologique comme fruit de la nécessité aveugle.
Le modèle créationniste, et en particulier CET, redonne à l’organisme son rôle de système conçu, avec des limites, des fonctions, des capacités préprogrammées et reconnaît en cela la main d’un Créateur intelligent.
L’externalisme (ou “environnementalisme”) selon Gould
« Les externalistes… identifiaient l’agent du changement non pas à l’intérieur des organismes eux-mêmes, mais dans un environnement externe fluctuant, et [soutenaient] que l’évolution progressait lorsque des changements dans l’environnement physique établissaient des pressions sélectives en faveur de nouvelles adaptations. »
« J’appellerai la croyance dans un contrôle externe “environnementaliste”, et les théories affirmant une cause intrinsèque du changement “internalistes”. »
Stephen J. Gould, 1977. Eternal Metaphors of Paleontology. In: Developments in Palaeontology and Stratigraphy, vol. 5, p. 1–26.
Gould explique ici la distinction fondamentale entre deux approches de l’évolution. L’externalisme (ou “environnementalisme”). C’est la vision darwinienne classique, la sélection naturelle agit comme un sculpteur. L’environnement est la source du changement évolutif. Il agit sur l’organisme depuis l’extérieur, en générant des pressions sélectives. L’organisme est passif, il subit des ajustements au gré des conditions extérieures.
La deuxième approche est l’internalisme. Le changement vient de l’intérieur de l’organisme: propriétés intrinsèques, auto-organisation, développement, etc. L’environnement déclenche ou influence, mais ne crée pas. C’est la vision que l’on retrouve dans:
- les modèles structuralistes,
- les théories du développement (évo-dévo),
- et aujourd’hui, dans des modèles comme le CET.
La nature est vue comme un “éleveur” – Dembski
« Ainsi, selon Darwin, la nature elle-même constitue l’éleveur suprême qui façonne le parcours de la vie.
Plus précisément, la nécessité, sous la forme de la sélection naturelle, et le hasard, sous la forme des variations aléatoires, sont censés rendre compte de toute la complexité et de toute la diversité biologique. »William A. Dembski, The Design Revolution. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004, p. 80.
Dembski, théoricien du design intelligent, résume ici la vision darwinienne du monde naturel en utilisant une métaphore forte: la nature est vue comme un “éleveur” (comme un sélectionneur de bétail), elle utilise deux “outils”:
- Le hasard qui produit les mutations aléatoires (variations),
- La nécessité de la sélection naturelle (filtrage adaptatif).
Cette combinaison hasard + sélection est, pour Darwin et ses successeurs, suffisante pour expliquer:
- La diversité des formes de vie,
- Leur complexité structurelle et fonctionnelle,
- Leur ajustement à l’environnement.
Dembski critique ce cadre en montrant que la nature est personnifiée, presque divinisée: on lui prête un rôle actif, intelligent, alors qu’elle est censée être aveugle et sans intention.
Dembski rejoint ici une critique fondamentale aussi portée par Guliuzza (ICR): dire que la nature agit comme un éleveur revient à attribuer un pouvoir créateur à un processus inconscient. Cela brouille la distinction entre Créateur et création, en faisant de l’environnement le moteur du vivant. Le modèle CET revient à cette perspective internaliste:
Ce n’est pas la nature qui façonne les organismes,
Ce sont les organismes, conçus intelligemment, qui répondent à l’environnement grâce à des mécanismes internes prévus à cet effet.
| Darwinisme | Modèle CET / créationniste |
|---|---|
| La nature est un « éleveur aveugle » | Dieu est le Créateur et l’Ingénieur |
| Sélection naturelle + hasard | Détection + adaptation préprogrammée |
| La cause est externe | La cause est interne (design intégré) |
| Personnification de la nature | Glorification du Créateur |
Sur la sélection naturelle comme puissance supérieure – Darwin
« J’ai appelé ce principe, selon lequel chaque variation légère, si elle est utile, est conservée, du nom de sélection naturelle, afin de souligner son lien avec le pouvoir de sélection de l’homme… Mais la sélection naturelle… est une puissance constamment prête à agir, et est infiniment supérieure aux faibles efforts de l’homme. »
Darwin, Charles. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London: John Murray, 1859, 1st edition, p. 80.
Darwin compare ici la sélection naturelle à l’élevage artificiel (la sélection humaine). Mais il affirme que la nature, bien que sans intelligence, est une force plus puissante et plus constante, capable de produire des résultats plus vastes que ceux de l’homme. Il personnifie la nature comme une sorte d’éleveur suprême.
La sélection naturelle fondée sur Malthus – Darwin
« C’est la doctrine de Malthus appliquée aux règnes animal et végétal.
Comme bien plus d’individus naissent qu’il ne peut en survivre… nous verrons alors comment la sélection naturelle cause presque inévitablement l’extinction des formes de vie les moins “améliorées”. »Darwin, Charles. On the Origin of Species, 1st ed., p. 63.
Darwin s’inspire ici directement de Malthus, qui avait expliqué que la population augmente plus vite que les ressources, cela engendre une lutte pour l’existence. Darwin applique cela à la nature: la sélection naturelle agit par élimination, tuant les formes « moins adaptées ».
C’est l’idée d’un monde brutal, où la survie dépend de l’utilité, non de la dignité ou de la valeur.
La nature comme moteur inconscient des formes
« …réfléchir au fait que ces formes si minutieusement construites ont toutes été produites par des lois agissant autour de nous — [croissance, reproduction, hérédité] — par l’action indirecte et directe des conditions extérieures de la vie, et comme conséquence de la sélection naturelle, entraînant l’extinction des formes les moins améliorées. Ainsi, de la guerre de la nature, de la famine et de la mort, résulte directement la production des formes animales supérieures.
Il y a de la grandeur dans cette vision de la vie… »
Darwin, Charles. On the Origin of Species, 1st ed., p. 491.
Dans cette phrase finale (souvent citée comme « poétique »), Darwin résume sa vision. Les formes complexes ne sont pas issues d’un plan intelligent, elles sont le résultat indirect de:
- lois naturelles automatiques,
- conditions extérieures,
- sélection naturelle, et
- extinction massive causée par lutte, famine, mort.
Il y a ici une vision matérialiste complète de la vie, où le progrès vient de la souffrance, et où le moteur est impersonnel : pas de Créateur, seulement une loi de tri aveugle.
Guillaume Lecointre commence sa présentation au Jardin Botanique de Nancy en disant:
La matière change, nous changeons. Pourquoi ça change pas alors que ça devrait changer? Pourquoi ça se maintient alors que ça change tout le temps?
Il poursuit en disant qu’on pourrait donner un nom différent à une personne quand elle a 15 ans, un autre quand elle a 35 ans et ainsi de suite, parce que cette personne « change ». Nous avons ici l’argument darwinien couramment utilisé mais il est faux. C’est précisément l’argument de Darwin. Il avait, comme Guillaume Lecointre, comparé la croissance humaine (1) ou d’un animal avec l’évolution (2). Les deux sont des choses complètement différentes.
Darwin parle des « lois » de la nature, il les voit comme des principes généraux régissant la vie. Mais en disant qu’elles « agissent autour de nous », il donne l’impression que la croissance, la reproduction et l’hérédité sont externes, ce qui est biologiquement inexact, les processus ont lieu à « l’intérieur de nous »:
- Ces processus sont intrinsèques aux organismes vivants,
- Ils sont régulés par des mécanismes internes (ex. ADN, mitose, méiose, hormones, régulation cellulaire, etc.),
- Même leur interaction avec l’environnement (phénotype plastique, épigénétique) est interne dans son traitement.
Dire que la croissance, la reproduction et l’hérédité sont causées par des lois « autour de nous » est scientifiquement incorrect. Ce sont des processus internes aux êtres vivants, gouvernés par des mécanismes biologiques. Darwin confond ici les lois générales de la nature avec les fonctions endogènes, ce qui montre une limite conceptuelle de son modèle. Malheureusement, de nombreux scientifiques modernes, sont toujours captifs des erreurs de Darwin.
La croissance est un phénomène biologique individuel: elle concerne le développement d’un seul organisme à partir d’un embryon jusqu’à l’âge adulte.
L’évolution, en revanche, est théoriquement censée être un changement des fréquences alléliques dans une population au fil des générations, elle ne s’applique pas à un individu unique, mais à des lignées successives.
Assimiler les lois de l’évolution à la croissance revient donc à confondre l’ontogenèse (développement d’un individu) avec la phylogenèse (histoire évolutive d’une espèce) ce qui est une erreur de catégorie.
- Darwin parle de lois « agissant autour de nous », comme si les mécanismes du vivant étaient exogènes, imposés par l’environnement.
- En réalité, la croissance, la reproduction et l’hérédité sont des processus endogènes: ils proviennent de programmes biologiques internes, encodés dans l’ADN et régulés par l’épigénétique et les réseaux cellulaires.
Présenter ces lois comme extérieures revient à réifier l’environnement comme moteur de l’organisation interne, ce qui contredit les découvertes modernes sur l’auto-organisation, la régulation génétique, ou la plasticité développementale.
En somme, Darwin établit une analogie inadéquate entre la croissance individuelle et l’évolution des espèces, et attribue à des « lois extérieures » des processus qui sont, de fait, internes et actifs dans les organismes. Cette confusion a contribué à une vision erronée, encore répandue aujourd’hui, selon laquelle l’environnement façonnerait passivement les organismes, sans prendre en compte leur capacité propre d’adaptation et d’organisation.
Lecointre, via le site du Museum de l’Histoire naturelle dit encore:
« L’hérédité est le phénomène qui permet la transmission des caractères des parents à leur descendance. À ce stade, le hasard est encore à l’œuvre. Il détermine, comme dans une immense loterie, quels traits seront passés à la génération suivante. Ces traits ont alors la propriété d’héritabilité.«
La citation affirme que l’hérédité fonctionne « comme une immense loterie » dans laquelle le hasard déterminerait les traits transmis à la génération suivante. Cette image, si elle peut sembler pédagogique, est profondément trompeuse à plusieurs niveaux.
Premièrement, l’hérédité ne dépend pas de lois « agissant autour de nous », comme le supposait Darwin à son époque, mais de mécanismes internes extrêmement sophistiqués: recombinaison génétique, ségrégation chromosomique, épigénétique, régulation transcriptionnelle, etc. Ce sont des lois biochimiques codées dans les cellules, non pas des forces externes.
Deuxièmement, présenter la transmission génétique comme une immense loterie laisse entendre qu’il y a une infinité de combinaisons ou de nouveautés possibles, alors qu’en réalité:
- la variabilité génétique est finie,
- elle est contrainte par le patrimoine génétique des deux parents,
- et la majorité des variations possibles restent dans des marges bien définies.
Cela surestime le pouvoir du « hasard » dans le processus héréditaire. Même les mutations, souvent évoquées comme source de nouveauté, sont majoritairement délétères, neutres ou redondantes.
Enfin, parler de « traits héritables » comme s’ils apparaissaient spontanément dans une loterie biologique masque une réalité bien plus précise: ces traits sont encodés, régulés, et transmis selon un système d’information hautement ordonné. Le concept même de « loterie génétique » dérive d’une métaphore floue qui ne reflète ni la précision ni les limites du système héréditaire.
La ressemblance entre différentes espèces
Guillaume Lecointre dit encore:
La filiation explique la ressemblance entre espèces
Dans la perspective évolutionniste, la ressemblance entre espèces (morphologique, génétique…) est interprétée comme la preuve d’une ascendance commune. Les espèces actuelles sont censées descendre d’un ancêtre commun par un processus de divergence progressive sur de longues périodes. La filiation (lignée évolutive) explique la ressemblance : deux espèces similaires le sont parce qu’elles partagent un ancêtre commun récent.
Dans la perspective créationniste (modèle avec concepteur commun), la ressemblance entre espèces est vue comme le résultat d’un design commun. Un créateur intelligent aurait utilisé des schémas fonctionnels similaires pour des organismes ayant des besoins ou environnements comparables. La ressemblance ne prouve pas une filiation mais un architecte commun, tout comme différents modèles de voitures peuvent partager des pièces sans avoir une « lignée évolutive ».
Dans la grande majorité des universités et institutions scientifiques occidentales, la seule explication autorisée pour l’origine et la diversité des formes de vie est l’évolution darwinienne (ou néo-darwinienne), souvent enseignée comme un fait établi, plutôt qu’une interprétation parmi d’autres des observations biologiques.
Cela donne l’illusion qu’il n’y a pas de débat, ni de faiblesse dans le modèle darwinien. Cela exclut toute pensée alternative (créationnisme, design intelligent, baraminologie…), non pas toujours pour des raisons scientifiques, mais souvent philosophiques ou idéologiques.
Cela contredit le principe même de la science, qui devrait explorer toutes les hypothèses explicatives, tant qu’elles sont cohérentes, testables ou falsifiables dans leur domaine.
Cela contribue à une forme de dogmatisme scientifique, où certains concepts (comme la sélection naturelle) deviennent intouchables, même lorsqu’ils sont critiqués par des scientifiques eux-mêmes (y compris des non-créationnistes, comme Lynn Margulis, James Shapiro, Denis Noble…).
La ressemblance entre espèces est présentée uniquement comme une preuve de filiation (héritage évolutif), alors qu’une autre interprétation tout aussi rationnelle est :
« Les organismes se ressemblent parce qu’un même Créateur les a conçus avec des structures communes optimisées. »
Mais cette interprétation est écartée a priori, souvent non pour des raisons scientifiques mais métaphysiques (rejet de toute cause surnaturelle).
Ce n’est pas la science qui rejette Dieu ou la création, c’est une philosophie naturaliste qui s’est imposée dans le domaine scientifique et qui filtre les données selon ce qu’elle veut voir ou croire.
Darwin + Malthus = évolution
On entend rarement parler de Malthus lorsqu’il est question de Darwin, ni même du rôle central que joue l’extinction dans sa théorie. On évoque peu le fait que Darwin comparait la nature à un éleveur humain, ce qui constitue pourtant un pilier de sa vision.
Mais posons une question simple: quand un animal grandit, est-ce l’environnement qui le force à grandir ? Bien sûr que non. Il est programmé pour cela. Il en va de même pour la reproduction et l’hérédité: ces fonctions sont internes à l’organisme, pas imposées de l’extérieur. Nous n’avons pas reçu nos caractéristiques biologiques de l’univers, comme si elles nous avaient été soufflées par le vent!
Et pourtant, dans les discours évolutionnistes, un tour de passe-passe subtil opère. On nous dit qu’un organisme produit une caractéristique interne (par exemple une mutation ou un trait favorable), que cette caractéristique résout un problème dans l’environnement, que cette solution est transmise par reproduction… et soudain, on affirme que c’est la nature qui a sélectionné. Toute la mécanique décrite est interne, mais on finit par attribuer l’origine du changement à l’environnement externe. C’est une glissade conceptuelle qui passe inaperçue si on ne lit pas avec attention.
Darwin a eu recours à Malthus pour une bonne raison: il savait que l’analogie avec l’éleveur humain, bien que utile, était insuffisante. L’homme, en tant qu’éleveur, est conscient, il fait des choix intentionnels. Mais la nature n’a ni volonté, ni intelligence. Pour expliquer la trajectoire évolutive du simple vers le complexe, Darwin devait introduire une force directionnelle. C’est ce que lui offrait Malthus.
Selon Malthus, chaque génération produit plus de descendants que la nature ne peut en nourrir, ce qui engendre une lutte pour la survie. Darwin a repris cette idée: dans chaque espèce, les progénitures se concurrencent entre elles, non pas guépard contre gazelle, mais guépard contre guépard, gazelle contre gazelle. Cette compétition constante, génération après génération, provoquerait l’élimination des moins aptes et la préservation des mieux adaptés, ce qui créerait une trajectoire ascendante.
Mais biologiquement, cette idée est contestable. On observe plutôt que les organismes s’adaptent activement aux conditions environnementales: ils régulent par exemple leur taux de fertilité en fonction des ressources disponibles. Chez certaines espèces d’oiseaux, le sexe des petits peut même varier en réponse à l’environnement. Les œufs d’alligator, par exemple, sont équipés de capteurs thermiques: selon la température, ils produiront davantage de mâles ou de femelles. Des mammifères comme les rongeurs arrêtent de se reproduire en cas de stress environnemental. Ce sont des ajustements programmés, internes, déclenchés par l’environnement, mais non causés par lui. La reproduction n’est pas incontrôlée, mais finement régulée, programmée pour éviter le surpeuplement.
Ce que Darwin imagine (inspiré de Malthus), c’est une compétition brutale entre individus (ex. : guépard vs guépard). Mais dans la réalité les espèces coexistent souvent sans extinctions massives, il existe des coopérations, régulations sociales, et des systèmes d’évitement, l’environnement n’est pas toujours limité au point de déclencher des luttes mortelles.
Malthus s’est trompé en supposant que la croissance démographique non régulée était une loi universelle de la biologie. Il ignorait l’existence de mécanismes intégrés d’autorégulation chez les êtres vivants. Pourtant, Darwin en a fait le socle de la sélection naturelle.
En résumé, Darwin a utilisé Malthus pour donner à l’évolution un sens directionnel, un chemin du poisson au philosophe, sans recourir à un Créateur. Mais pour cela, il a dû personnifier la nature comme un agent de tri, une sorte d’éleveur inconscient, capable de guider la vie sans pensée ni plan. Ce glissement conceptuel reste, encore aujourd’hui, au cœur de la vision darwinienne, et mérite d’être interrogé.
Critique du terme sélection naturelle
« Il est regrettable que Darwin ait introduit le terme “sélection naturelle”, car cela a entraîné beaucoup de confusion dans les esprits… L’action de l’homme dans la sélection artificielle n’est pas analogue à celle de la “sélection naturelle”, mais en est presque l’exact opposé, comme Woltereck (1931) l’a particulièrement souligné. »
Edward Stuart Russell, 1962. The Diversity of Animals: An Evolutionary Study. Leiden: E.J. Brill, p. 124.
Russell critique ici l’analogie centrale sur laquelle Darwin a construit sa théorie:
- Darwin a observé la sélection artificielle (faite par l’homme : élevage, culture, etc.), où l’on choisit volontairement des traits à reproduire.
- Il a ensuite proposé que la nature agit comme un éleveur inconscient, sélectionnant des traits « utiles » par un tri aveugle, c’est la sélection naturelle.
Mais Russell (et Woltereck avant lui) explique que cette analogie est profondément trompeuse, pour deux raisons principales:
1. La sélection humaine est intentionnelle, dirigée par un but.
L’homme sait ce qu’il veut produire (ex. : une vache plus laitière, un chien de chasse plus endurant),
il choisit activement les reproducteurs en fonction de critères précis.
2. La “sélection naturelle” est inconsciente, sans but ni plan.
Elle ne choisit pas: elle élimine, selon des circonstances variables, sans direction, sans objectif évolutif à long terme.
L’usage du mot “sélection” dans les deux cas suggère à tort une équivalence:
- comme si la nature faisait ce que fait l’homme, mais sans cerveau.
- comme si un mécanisme aveugle pouvait produire de la complexité comme le ferait un esprit ordonné.
Cette confusion de langage est au cœur du “tour de passe-passe” conceptuel que critiquent aussi Guliuzza (ICR) et Dembski (ID): On attribue à la nature des effets de design en lui prêtant un rôle de sélectionneur qu’elle n’a pas.
Avant Darwin, personne n’imaginait que la “sélection” pouvait exister dans la nature.
« …personne ne serait spontanément ou par inadvertance amené à parler de la nature comme d’un domaine dans lequel on pourrait localiser quelque chose comme une “sélection” ; et, en effet, nous trouvons peu d’auteurs avant Darwin ayant effectué cette transition. »
Michael J. S. Hodge. 1992. Natural Selection: Historical Perspectives, in: Keywords in Evolutionary Biology, Harvard University Press, Cambridge (MA), p. 213.
Michael Hodge souligne ici une chose fondamentale et souvent ignorée: avant Darwin, personne n’imaginait que la “sélection” pouvait exister dans la nature. La sélection était toujours considérée comme un acte volontaire, propre à l’homme (élevage, agriculture). Attribuer à la nature un pouvoir de sélection était donc une rupture conceptuelle majeure et Darwin a été l’un des seuls à opérer cette transition.
Autrement dit, la nature n’avait jamais été vue comme une “entité qui choisit” avant Darwin. Cela aurait semblé absurde ou incohérent à ses prédécesseurs. Darwin a donc créé une nouvelle manière de parler de la nature, en lui prêtant un rôle actif, quasi intentionnel, sans intention réelle ce qui, comme le disait Edward Stuart Russell, a introduit beaucoup de confusion.
Ce glissement que décrit Hodge est exactement ce que Guliuzza ou Dembski dénoncent:
- On est passé d’un monde conçu, dirigé, intelligible…
- …à une nature personnifiée, déifiée, qui trie, façonne, choisit — sans être un sujet réel.
C’est ce que certains appellent une illusion rhétorique: donner un rôle d’éleveur à la nature alors qu’elle ne possède aucune volonté, aucune intelligence, aucun programme.
La sélection artificielle ne crée rien de nouveau
Même dans un modèle créationniste, la sélection artificielle (faite par l’homme) ne permet pas d’expliquer l’origine des espèces car elle n’invente rien, elle opère sur des variations déjà présentes dans les créatures créées.
L’homme ne fait que trier, accentuer, ou combiner des traits déjà existants dans les baramins (les « genres » créés).
Même si Darwin commence son raisonnement en disant:
« L’homme sélectionne, donc la nature pourrait le faire aussi »…
… cela ne justifie en rien l’idée que cette sélection, humaine ou naturelle, puisse expliquer l’apparition de nouveaux types fondamentaux.
Un éleveur peut produire une grande variété de chiens (du chihuahua au Saint-Bernard),
mais il ne peut pas, par sélection, faire sortir un chien du genre canin.
Dans une perspective biblique:
- Dieu a créé des types fondamentaux d’êtres vivants,
- Ces types (baramins) sont dotés d’une variabilité génétique riche,
- L’homme ou l’environnement peuvent sélectionner ce qui est déjà là, mais pas créer de nouveaux types ou ajouter de l’information génétique de complexité supérieure.
Même la sélection artificielle ne fait que manipuler l’existant. Elle ne produit pas l’origine des espèces, elle modifie la forme sans toucher au fond. Et donc, dans une perspective créationniste, la sélection artificielle ne prouve rien quant à l’origine ou à l’apparition des grandes catégories biologiques. Elle illustre plutôt la flexibilité du design originel, pas la capacité du hasard et de la sélection à créer.
La sélection artificielle (comme naturelle) fonctionne un peu comme un peintre qui mélange des couleurs sur une palette. Il peut produire une grande variété de nuances, de tons, de dégradés… Mais il ne crée pas les couleurs primaires. Le rouge, le bleu et le jaune doivent déjà être là. Sans ces bases, aucune combinaison n’est possible.
Mélanger des couleurs n’est pas créer la lumière. Sélectionner des chiens n’est pas expliquer l’origine des canidés. Ce qui permet la sélection artificielle, c’est la variabilité déjà présente dans un design d’origine. La sélection naturelle, elle, n’existe pas, elle ne peut même pas faire ce que fait la sélection artificielle limitée.
Le tournant Darwinien – Dembski
« Avant Darwin, la capacité de choisir était presque exclusivement attribuée à des intelligences conceptrices, c’est-à-dire à des agents conscients capables de réfléchir délibérément aux conséquences possibles de leurs choix. »
William A. Dembski, The Design Revolution, Downers Grove (IL) : InterVarsity Press, 2004, p. 263.
Dans la pensée classique (théologie naturelle, philosophie), choisir impliquait toujours une volonté consciente : Dieu, l’homme, les animaux doués d’intention. Les phénomènes naturels étaient décrits par des lois (gravité, chimie), non par des « décisions » de la nature.
Darwin introduit l’expression « sélection naturelle » et, par métaphore, attribue à la nature une capacité de choix (sélectionner, éliminer, conserver). Cette personnification brouille la frontière entre processus inconscients et agents intelligents : la nature devient un « éleveur » sans esprit mais censé produire des innovations complexes.
Dembski souligne la confusion conceptuelle : employer le vocabulaire du choix pour un processus aveugle masque l’absence réelle d’intelligence derrière la sélection naturelle. Il rappelle qu’aucun auteur majeur avant Darwin n’avait « localisé » l’acte de choisir dans la nature elle-même (thème que confirme l’historien Michael Hodge).
Pour une approche créationniste, choix, but et plan demeurent l’apanage d’un Créateur ou d’agents conscients. Parler de la nature comme d’un agent sélecteur revient à camoufler du téléologique sans téléologie réelle, un « tour de passe-passe » rhétorique souvent dénoncé (Guliuzza, Russell, Hodge).
La sélection naturelle: l’opposée de la sélection humaine
La sélection naturelle, telle que l’a définie Darwin, est en réalité l’opposé de la sélection humaine, et ce pour une bonne raison. Chez Darwin, il ne s’agit pas d’un choix intentionnel, mais d’un processus d’essai-erreur aveugle, comparable à tirer une boule au hasard dans une loterie. À l’inverse, un éleveur humain sait ce qu’il veut obtenir et sélectionne activement les individus selon un objectif. Tout le principe de la sélection naturelle repose donc sur un processus non dirigé, ce qui est à l’opposé de la sélection artificielle, intentionnelle et guidée.
Certaines personnes ont accusé Darwin de s’être inspiré, voire d’avoir « plagié » des penseurs antérieurs comme Edward Blyth, qui avaient observé que l’environnement pouvait influencer la survie des individus. Mais cette idée était rudimentaire et non structurée. Avant Darwin, personne n’attribuait à la nature elle-même une capacité de sélection. Les savants n’adoptaient pas de lecture externaliste, ils n’appliquaient pas Malthus à la biologie, et ne supposaient pas que l’extinction était le moteur du progrès biologique.
Dire que Darwin n’a fait que reprendre les idées d’autres est donc erroné: c’est lui qui a synthétisé une théorie entièrement nouvelle, fondée sur l’externalisme, la pression environnementale, les extinctions massives, et la “sélection” sans volonté. C’est pourquoi on parle aujourd’hui de Darwin et non de ses prédécesseurs.
Fait intéressant, même des chercheurs évolutionnistes séculiers comme Michael Lynch ou Eugene Koonin reconnaissent que la sélection naturelle, dans sa forme classique, ne fonctionne pas. Ils n’en concluent pas qu’un Créateur est à l’œuvre, mais pensent que plus de données ou de recherches finiront par résoudre les impasses actuelles.
En réalité, une portion croissante de la communauté scientifique évolutionniste rejette partiellement ou totalement le modèle néodarwinien fondé sur la sélection naturelle. Ces chercheurs, souvent regroupés sous le label “Third Way of Evolution” (troisième voie de l’évolution) tiennent régulièrement des conférences pour discuter d’alternatives. Comme ils remettent en question la sélection naturelle, ils sont fréquemment marginalisés ou harcelés par leurs pairs. Cela les pousse à avancer prudemment, même lorsqu’ils constatent que la majorité des découvertes récentes pointent vers des mécanismes internes d’adaptation. Confrontés à ces contradictions, ils plaident pour une extension de la théorie de l’évolution, mais sans pour autant admettre l’échec du paradigme actuel.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!