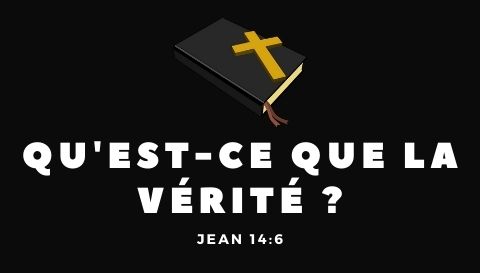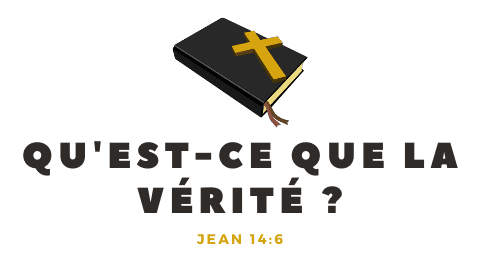Que sont l’Hadès, la Géhenne et le Tartare dans le Nouveau Testament?
Dans certaines traductions de la Bible, les mots grecs Hadès (ᾅδης), Géhenne (γέεννα), et Tartare (ταρταρόω) sont traduits de manière confuse ou uniforme par le mot « enfer ». Cela a tendance à effacer leurs différences cruciales de sens et leur origine culturelle et linguistique. De plus, les discussions à l’orale et les sermons de responsables religieux utilisent le terme « enfer » sans qu’il ne soit réellement corrélé aux enseignements bibliques. Cela est en grande partie dû à l’imagerie de l’enfer qui nous provient du Moyen-Âge. La perte des nuances du Nouveau Testament a provoqué des erreurs théologiques importantes que nous allons ici essayer de dénouer.
Le mot « enfer » à l’origine
Le mot « enfer » en français ne vient pas de la Bible à l’origine, ni du grec, mais a une évolution linguistique propre issue du latin, avec une histoire préchrétienne liée à la conception du monde souterrain. Ce mot vient du latin « infernus », qui signie « ce qui est en dessous », « inférieur », « souterrain ». Il est lié au mot « inferus » (« en bas »), d’où vient aussi le mot « inférieur ».
Chez les Romains, les « inferi » ou « inferna » désignaient le monde souterrain c’est à dire le Royaume des morts en général (sans jugement moral fort), il était associé parfois à des divinités souterraines (Pluton, Dis Pater) et comprenait parfois des zones spécifiques comme le Tartare (lieu de châtiment) et les Champs Élysées (lieu de paix). Le mot ne désignait pas un lieu de feu éternel, mais le domaine des morts, au sens neutre ou mythologique.
Au fil du temps, les chrétiens latins ont utilisé « infernus » ou « inferna » pour traduire plusieurs mots bibliques:

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
| Terme biblique | Traduction latine (Vulgate) | Français |
|---|---|---|
| Sheol (hébreu) | infernus | enfer / séjour des morts |
| Hadès (grec) | infernus | enfer / séjour des morts |
| Géhenne (grec) | gehenna parfois remplacé par infernus | enfer |
| Tartare (grec) | tartarus ou intégré à inferna | (rarement traduit) |
Ainsi, le mot français « enfer » est devenu un fourre-tout dans la tradition chrétienne latine, pour désigner à la fois le séjour des morts, le lieu du châtiment éternel, et même parfois la tombe.
Au Moyen Âge le mot « enfer » désignait clairement le lieu de châtiment éternel des damnés, sous l’influence des visions de l’enfer (Dante, l’iconographie). Cependant, dans la Bible, les réalités derrière « l’enfer » sont multiples:
- L’Hadès est un lieu ou un état temporaire.
- La Géhenne est le jugement final.
- Le Shéol est la même chose que l’Hadès.
- Le Tartare est réservé aux anges.
Le mot « enfer », en français, est donc un mot d’origine pagano-latine, qui a été utilisé par les traducteurs chrétiens pour désigner plusieurs concepts bibliques non équivalents. Il signifiait simplement « souterrain » ou « inférieur », sans notion de feu ou de damnation mais a ensuite été adapté dans la Bible latine (Vulgate) pour traduire Shéol, Hadès, Géhenne, et Tartare, ce qui a introduit une grande confusion dans la théologie populaire.
Hadès dans la culture grecque
Hadès désignait chez les grecs à la fois le dieu des morts (dieu des Enfers), qui était frère de Zeus et de Poséidon, et le royaume souterrain où vont tous les morts. Tous les morts y allaient, sans distinction morale forte. Ce royaume était divisé en zones:
- L’Érèbe qui était la partie supérieure des Enfers, où les âmes erraient après la mort.
- Le Styx, le fleuve que les morts devaient traverser, guidés par Charon, le passeur, qui exige une obole (pièce) pour le voyage.
- Les Champs Élysées était un paradis réservé aux héros, aux justes et aux initiés (comme les mystères d’Éleusis).
- Le Tartare était une prison profonde et sombre où étaient punis les grands criminels (comme Tantale, Sisyphe, Ixion) et où les Titans ont été emprisonnés (Pierre réutilise de manière parlante ce concept pour les anges déchus).
- Les Champs Asphodèles étaient une plaine grise et monotone où erraient les âmes des morts ordinaires.
Hadès était donc le monde des morts, universel, mais avec des sections moralisées en fonction du comportement. Il y avait une tentative de dispenser des peines et des récompenses différentes en fonction du mérite, ce qui contraste avec le modèle binaire proposé par le Christ dans Matthieu 25 (à sa droite ou à sa gauche). La proportionnalité des peines est en effet une difficulté tenace pour les partisans traditionnalistes de l’enfer car la Bible ne décrit que deux destins.
Voici pour information quelques divinités et figures associées aux Enfers Grecs:
- Hadès (Pluton chez les Romains) était le Roi des Enfers.
- Perséphone (Proserpine) était la Reine des Enfers, enlevée par Hadès et forcée d’y passer une partie de l’année (symbolisant l’hiver).
- Thanatos était la personnification de la Mort.
- Hypnos était le dieu du Sommeil, frère de Thanatos.
- Les Juges des Morts étaient Éaque, Minos et Rhadamanthe, ils décidaient du sort des âmes.
- Cerbère était le chien à trois têtes gardant l’entrée des Enfers.
Inferi / Infernus / Inferna dans la culture romaine
Les Romains ont largement repris la conception grecque des Enfers, mais avec quelques différences de noms et d’emphase. Le mot latin infernus ou inferna (n. pl.) désignait le monde souterrain, le royaume des morts et parfois les dieux infernaux (di inferi, ex : Pluton = Hadès, Proserpine = Perséphone).
À l’époque hellénistique puis impériale romaine les Grecs et les Romains ont adopté mutuellement leurs dieux (Hadès = Pluton). Les mythes se sont mélangés, et le mot Hadès continuait à désigner le monde des morts en grec, pendant que les Latins employaient le mot « infernus ». Fonctionnellement, les deux mots désignent le même lieu: le monde souterrain des morts. La principale différence est linguistique et religieuse, non conceptuelle.
L’organisation du monde des morts chez les Romains était similaire aux Grecs. Le monde des morts est divisé:
- Le Champ des Asphodèles (région grise, neutre pour les âmes ordinaires)
- L’Elysium pour les bienheureux
- Le Tartarus pour les criminels
- Le Limbus pour les enfants et les âmes sans baptême (création de la théologie chrétienne médiévale latine, et non une composante du paganisme romain.)
« Infernus » désignait le lieu global des morts, parfois très proche du grec Hadès dans son usage courant. Les théologiens médiévaux ont repris la structure tripartite gréco-romaine du monde des morts et y ont ajouté le limbus chrétien, pour traiter les cas « non classables » (les justes de l’AT qui ne connaissaient pas le Christ, les enfants morts sans baptêmes).
Voici quelques différences notables entre les Enfers Grecs et Romains:
- Pluton (l’équivalent romain d’Hadès) était moins craint et plus associé à la richesse (d’où son nom lié à « ploutos », la richesse).
- Orcus était un autre nom pour les Enfers ou un dieu de la mort punissant les parjures.
- Les Mânes étaient les Esprits des ancêtres, parfois vénérés comme divinités protectrices.
- Les Lémures/Larves étaient des âmes malfaisantes des morts non apaisés.
Les Romains accordaient une grande importance aux rites funéraires pour que l’âme du défunt ne devienne pas un Lare (esprit errant). Le mundus, une fosse rituelle, était considéré comme une porte vers le monde souterrain. L’Élysée (version romaine des Champs Élysées) était un lieu de félicité pour les âmes vertueuses. L’Averne était un lac volcanique en Italie, considéré comme une entrée vers les Enfers (Virgile y place l’entrée dans L’Énéide).
Ainsi, le Shéol, Hadès, Infernus puis l’Enfer sont 4 étapes parlant de la même chose, même si chacune de ces étapes a ajouté des couches culturelles:
- Le Shéol est le lieu des morts sans conscience
- L’Hadès est le monde des morts, parfois moralisé
- L’Infernus est le monde souterrain selon la théologie latine
- L’Enfer est devenu un lieu de châtiment éternel dans le christianisme médiéval
Hadès et Infernus / Enfer désignaient à l’origine le même concept général: le monde souterrain des morts. Le mot Hadès était utilisé en grec, Infernus en latin. Tous deux désignaient un royaume pluriel, avec des zones pour les justes (Élysée) et pour les coupables (Tartare). Cette vision a influencé la pensée chrétienne, où enfer a fini par absorber le Tartare (châtiment) et oublier l’Élysée (réconfort).
Le mot « enfer » en français vient du latin « infernus », mais sa signification chrétienne (lieu de damnation) a éclipsé le sens antique (simple séjour des morts).
Les Enfers grecs et romains étaient des royaumes complexes, mêlant neutralité (pour la plupart des morts) et punitions (pour les criminels). Ils reflétaient les croyances sur la mort, la justice divine et le voyage de l’âme. Hadès/Pluton règnait sur ce domaine, tandis que des figures comme Cerbère et Charon en gardaient les frontières. Ce n’était pas synonyme de « punition éternelle » comme dans le christianisme médiéval, mais simplement le royaume souterrain où résidaient les âmes des défunts. On en a un exemple avec l’expression « Ad Inferos descendere » = « descendre chez les morts ».
Hadès dans le Nouveau Testament
Le mot grec ᾅδης (Hadès) apparaît 10 fois dans le Nouveau Testament. Il est généralement traduit par séjour des morts. Voici les principales occurrences:
Matthieu 11:23 et Luc 10:15
Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts
Ici nous avons la direction « descendante ». Les gens qui meurt se couchent, ils sont abaissés. On ne note aucun détails techniques sur sa nature. Il est dans la lignée du Shéol de l’AT qui représente l’état des morts, allongés, inconscients.
Matthieu 16:18
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Ici il est question que l’Église du Christ ne mourra jamais ni ne sera détruite, mais persistera jusqu’au retour du Christ. On voit que Jésus utilise l’imagerie grecque « les portes du séjour des morts ». Ce n’est pas qu’il y a de vraies portes mais cela permet de s’adresser de manière percutante aux populations de l’époque, qui connaissaient l’Hadès grec.
Luc 16:23 (parabole du riche et de Lazare)
Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu’il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.
Ici on voit que l’histoire du riche et de Lazare ne se situe pas en « enfer » au sens populaire mais dans le séjour des morts. C’est important de le noter car pour les traditionnalistes, l’enfer correspondrait plutôt à la Géhenne, un lieu dans lequel atterrissent les non repentis, après le jugement final. Le séjour des morts biblique est lui temporaire, car il est vidé et détruit lors du jugement final (voir plus bas). Dans tous les cas de figure, l’Hadès de Luc 16 est une chose différente de la Géhenne ou de l’Etang de Feu.
Actes 2:27 et 31 (prophétie de David)
Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption.
c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.
David parlait de la résurrection: le messie ne devait pas resté mort mais ressuscité.
Apocalypse 1:18
Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.
Ici Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts.
Apocalypse 6:8
Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.
Le cheval à la couleur pâle (un symbole de l’Apocalypse) va provoquer la mort de nombreuses personnes.
Apocalypse 20:13-14
La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu.
Le séjour des morts rend les morts, il se vide, c’est à dire que les morts ressuscitent et sont jugés. Ce « séjour » est ensuite détruit dans l’étang de feu, qui n’est pas un étang de feu littéral, mais la seconde mort.
On note que le séjour des morts est temporaire. La mort ne sera plus. C’est pourquoi l’Hadès est un lieu ou un état temporaire selon les interprétations. Cela indique que l’histoire du riche et de Lazare, qui se déroulait dans l’Hadès, n’est pas une description du lieu de jugement définitif (concept rattaché au mot Géhenne). Il faut, à tout le moins, le considérer comme un endroit intermédiaire (alors même que les destins des deux personnages semblent scellés dans le récit). Un problème théologique conséquent est que récompense et punition sont dispensés lors du jugement dernier, pas avant (on ne peut pas être jugé avant le jugement).
L’histoire du riche et de Lazare
La plupart des théologiens pensent que cette histoire est une parabole, même des traditionnalistes qui croient que l’enfer est un lieu réel. Il y a de nombreuses raisons à cela:
- Les détails fantaisistes de l’histoire (Lazare qui parle alors qu’il est dans les flammes, communication entre un racheté et un réprouvé malgré un grand abîme qui les sépare, le riche qui de l’Hadès peut voir quelqu’un dans le sein d’Abraham…).
- L’emprunt probable à des contes courants de l’époque.
- La logique des « premiers qui deviennent les derniers » et inversement (thème récurrent dans Luc).
- La résurrection du Christ annoncé à la fin de la parabole qui annonce que les pharisiens ne changeraient pas d’avis même lorsque Jésus serait revenu à la vie.
- La position de ce récit dans une section dédiée au parabole.
- Récompense et châtiment qui serait dispensés avant les deux résurrections et le jugement final.
- Le séjour des morts est actif contrairement à ce qui est enseigné dans les autres passages de l’AT et du NT.
De loin pour moi le meilleur argument qui montre que la description est à visée pédagogique, et ne décrit pas techniquement l’au-delà, est que l’Hadès, selon les autres occurrences des mots Hadès et Shéol dans la Bible, est un lieu de silence, d’oubli, d’inactivité, d’inconscience où les morts sont allongés. Le seul passage qui montrerait une conscience active dans l’Hadès, avec dialogue, souffrance, mémoire etc… se trouve dans le récit du riche et de Lazare de Luc 16. Cela n’est jamais étayé ailleurs, ça et d’autres éléments comme la communication entre rachetés et réprouvés.
En fait, sur les 10 passages du NT où le mot Hadès apparaît, il n’y a que celui de Luc 16, qui montre la conscience du mort, les 9 autres, qui ne sont pas suspectés d’être paraboliques, ne transmettent pas cette idée. Jésus semble plutôt confirmer que les morts « dorment » (Jean 11:11-14) comme ce qui est enseigné dans l’Ancien Testament et que l’espoir est la résurrection au dernier jour (Jean 6:40) et non un endroit temporaire. Paul aussi enseigne que les morts « dorment » (1 Thessaloniciens 4:13-16). Il ne rassure pas les croyants sur le fait que leurs proches sont déjà en train de profiter de la récompense.
Un passage classique cité dans l’AT qui montre que le séjour des morts est inactif se trouve dans Ecclésiastes 9:5,10:
Les morts ne savent rien… Il n’y a ni œuvre, ni pensée… dans le séjour des morts.
Le Shéol dans l’Ancien Testament
Le Shéol est le séjour des morts, où vont tous les défunts, justes comme injustes. Il est généralement décrit comme:
- Souterrain (Nb 16:30, Job 11:8)
- Lieu d’ombre, de silence, sans souvenir de Dieu (Ps 6:6 ; 88:6 ; Eccl 9:5-10)
- Sans distinction morale: les bons et les méchants y descendent (Gn 37:35, Job 3:11–19)
Il n’y a pas de punition ou de récompense, ni conscience claire, c’est un état d’attente ou d’oubli.
La Septante, traduction grecque de l’Ancien Testament, rend Shéol par Hades (ᾅδης) dans la majorité des cas. Comme dans Psaume 16:10 (LXX 15:10): « Tu ne livreras pas mon âme au Hadès » (hébreu : Sheol). Cette équivalence montre que, pour les traducteurs juifs du IIIe siècle av. J.-C., Hadès était la même chose que le Shéol, en tant que lieu général des morts.
Au fil du temps, sous l’influence des Perses (zoroastrisme), puis des Grecs (philosophie dualiste), le Shéol/Hadès est devenu plus complexe dans la pensée juive post-biblique:
| Élément | Avant (Shéol classique) | Après (litt. intertestamentaire) |
|---|---|---|
| Conscience ? | Non | Parfois oui |
| Jugement ? | Non (indistinct) | Oui (séparation justes/méchants) |
| Division interne ? | Non | Oui (ex: 1 Hénoch, 4 Esdras) |
Par exemple, 1 Hénoch 22 décrit le Shéol comme divisé en quatre compartiments selon la moralité. Sagesse 3-5 introduit la vie après la mort pour les justes. Certains se posent la question de pourquoi certains livres intertestamentaires n’ont pas été insérés dans le canon hébreu. L’un des problèmes a à voir avec les enseignements non conforme aux livres canoniques. Un autre souci est que ces livres, souvent, ne revendiquent pas l’inspiration divine, on n’y trouve pas de « Ainsi parle l’Éternel ». C’est un fait qui doit éveiller notre curiosité que les catholiques doivent faire appel à des textes apocryphes pour argumenter nombreuse de leurs positions.
Le Nouveau Testament hérite de cette vision développée, mais sans toujours clarifier. Hadès est le séjour des morts temporaire, avant le jugement final. Il coexiste avec deux autres notions que sont la Géhenne (destruction finale, la seconde mort) et le Paradis (seconde Terre que Dieu va créer dans Apocalypse 21).
Le Paradis (littéralement jardin ou enclos de la Genèse) est un lieu terrestre, non céleste. Il n’existe pas encore aujourd’hui. Selon Jésus, le Paradis sera sur la seconde Terre car dans Apocalypse 2:7 il dit « A celui qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Cet arbre de vie, on le retrouve dans Apocalypse 22:2, dans la Nouvelle Jérusalem qui était descendu du ciel, après que Dieu ait créé le nouveau ciel et la nouvelle Terre (Ap 21:1). Si l’arbre de vie et la Nouvelle Jérusalem sont sur la seconde Terre, alors le paradis (peut-être un nouveau jardin) y est tout logiquement.
Si on prenait Luc 16:19–31 de manière littérale, alors la description d’Hadès serait effectivement en tension, voire en contradiction directe avec la conception classique du Shéol hébreu dans l’Ancien Testament. Dans Luc 16:23–26 le riche est conscient, en souffrance, voit à distance, parle, se souvient. Lazare est dans le sein d’Abraham, consolé, séparé par un gouffre infranchissable. Il y aurait donc:
- Mémoire
- Dialogue
- Souffrance physique
- Séparation éthique/morale entre justes et injustes
Ce Hadès, si littéral, est hiérarchisé, actif, moralisé, conscient, en somme très différent du Shéol biblique. Je ne pense pas que Jésus ait validé la conception grecque de l’Hadès, il avait probablement une visée pédagogique, la morale étant plus importante que l’histoire elle-même. Il faut être prêt avant le jugement et se convertir quand on peut encore le faire.
On peut expliquer cette contradiction en comprenant que ce récit du riche et de Lazare n’enseigne pas une doctrine sur l’au-delà, mais sert d’avertissement moral. Le Hadès décrit est une construction pédagogique, influencée par des idées populaires juives.
L’autre manière populaire d’expliquer est de proposer l’évolution du Shéol vers un Hadès moralisé (vue patristique/catholique). La Bible montrerait une progression dans la révélation: Du Shéol neutre (Job, Psaumes) vers une vision différenciée dans des textes tardifs (1 Hénoch, etc.) jusqu’au Hadès de Luc 16. L’inconvénient est que le changement est radical et peu explicite dans la Bible elle-même, en particulier dans le Nouveau Testament où Jésus et Paul continuent de parler du sommeil des morts dans l’attente de la résurrection, en lien notamment avec Daniel 12. La Bible ne parle jamais d’un endroit intermédiaire actif, si ce n’est dans une interprétation littérale et non parabolique de Luc 16.
Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront [résurrection], les uns pour la vie éternelle, les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle [jugement final].
Pour être au moins cohérent, la vue que le riche et Lazare décrit une réalité de l’au-delà, aurait dû se produire dans la Géhenne ou l’Etang de Feu, qui sont le jugement final. La prophétie de Daniel 12 montre clairement que les morts se « réveilleront » pour le jugement final. Or l’histoire du riche et de Lazare se déroule dans le lieu temporaire de l’Hadès, pourtant un lieu d’oubli et de silence (voir article sur l’annihilation où j’entre dans les détails). Il faut donc privilégier l’interprétation parabolique et se concentrer sur la morale de l’histoire, et non sur ses détails qui ont une fonction pédagogique.
Le Shéol dans la Torah et les premiers livres historiques est amoral: tout le monde y va. Daniel 12 introduit une résurrection différenciée: certains pour la vie, d’autres pour la honte. Cela marque une transition majeure: le Shéol n’est plus seulement un lieu d’attente, mais devient le lieu dont les morts sortiront pour être jugés.
Luc a souvent utilisé des paraboles à forte charge sociale et spirituelle (cf. Bon Samaritain, Fils prodigue, Festin refusé…). Le récit de Lazare et du riche suit immédiatement des avertissements aux pharisiens riches (Luc 16:14) et sert un message moral de renversement: les riches indifférents seront humiliés, les pauvres seront exaltés. Beaucoup de chercheurs considèrent donc que Luc utilise un cadre connu (Hadès moralisé) pour porter un message éthique, pas nécessairement une doctrine de l’au-delà.
Il y a 66 occurrences du mot Shéol dans l’Ancien Testament (sans compter les autres expressions qui s’y réfèrent comme Daniel 12:2 par exemple). Voici quelques exemples:
1 Samuel 2:6
L’Éternel fait mourir et il fait vivre ; il fait descendre au Shéol et en fait remonter.
Ce verset montre que Dieu a pouvoir sur la vie et la mort. C’est une allusion précoce à la résurrection. C’est la louange d’Anne après la naissance de Samuel. Le Shéol est le lieu de mort, mais Dieu peut sauver de la mort. C’est l’un des rares versets qui présente la victoire divine sur le Shéol. Ce Shéol hébreu n’est jamais détaillé comme dans les mythologies païennes.
Psaume 6:5 (6:6)
Car celui qui meurt n’a plus souvenir de toi ; qui te louera dans le Shéol ?
Le Shéol est vu comme un lieu de silence, sans adoration, sans relation avec Dieu.
Job 14:10–13
L’homme meurt… Où est-il ? […] Qu’il se cache au Shéol jusqu’à ce que ta colère passe.
Le Shéol est le destin général des morts, sans récompense ni punition. Job espère une sortie après un certain temps.
Ésaïe 38:10
Je disais : dans le calme de mes jours, je vais aux portes du Shéol…
C’est la prière d’Ézéchias malade. Le Shéol est la fin de l’espérance et de la relation avec Dieu.
Osée 13:14
Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, Je les délivrerai de la mort. O mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction?
Il s’agit du jugement et de l’espérance. C’est un défi lancé au Shéol, semblable à 1 Corinthiens 15:55. Dieu peut racheter de la puissance du Shéol.
Genèse 37:35 (Jacob parlant de Joseph présumé mort)
Je descendrai en pleurant vers mon fils au Shéol.
Le Shéol est lieu où va tout défunt, même un juste. Il n’y a pas de connotation punitive. Cela bien sûr ne cadre pas avec une interprétation littérale du riche et de Lazare où Lazare ne descend pas dans le Shéol.
Genèse 42:38
S’il lui arrivait malheur, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au Shéol.
Jacob exprime à nouveau sa douleur et sa proximité avec la mort.
La Géhenne
De manière à surprendre plus d’un chrétien, le mot « enfer », à l’origine, représente le Shéol ou Hadès mais pas la Géhenne, qui elle, au moins, est associée au feu, contrairement au Shéol hébraïque et au Hadès néotestamentaire qui sont des états temporaires neutres où tout le monde doit aller. D’ailleurs le dieu Hadès était appelé « dieu des Enfers ».
Dans le NT, le mot « Géhenne », qui apparaît 12 fois, désigne un lieu après le jugement final, réservé aux méchants non repentis. Il est décrit comme un feu éternel, un lieu de destruction ou de souffrance irréversible selon les interprétations. Ce concept est très différent du Shéol ou de l’Hadès, qui sont temporairement occupés par les morts avant la résurrection et le jugement.
Le mot Géhenne vient de l’expression hébraïque « Gé Hinnom », qui signifie la vallée de Hinnom. Cette vallée est située juste à l’extérieur des murs de Jérusalem et a une histoire associée à des pratiques païennes et idolâtres:
- Dans l’Ancien Testament, la vallée de Hinnom était un lieu où certains rois d’Israël, tels que le roi Achaz et le roi Manassé, ont sacrifié leurs enfants par le feu à des dieux païens, notamment Moloch (2 Chroniques 28:3, 2 Chroniques 33:6, Jérémie 7:31).
- En raison de ces pratiques abominables, la vallée a été maudite par les prophètes et est devenue un symbole de la corruption et de la condamnation divine.
À l’époque de Jésus, la Géhenne avait évolué d’un lieu géographique à une métaphore puissante représentant la punition divine et le jugement final :
- Les rabbins du Judaïsme intertestamentaire (probablement influencés par les courants de pensée gréco-romains) et les écrits juifs post-bibliques ont développé l’idée de la Géhenne comme un lieu de châtiment pour les âmes des méchants après la mort.
- Cette conception a influencé l’enseignement de Jésus, qui utilisait le terme Géhenne pour désigner un lieu de destruction et de jugement, distinct du Shéol et de l’Hadès.
Il n’est pas question de souffrir éternellement dans la Géhenne mais d’y périr (Matthieu 10:28):
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne.
Le texte n’enseigne pas une immortalité naturelle de l’âme, mais souligne la capacité de Dieu à supprimer entièrement une existence humaine. Les traditionnalistes font appels à deux versets de l’Apocalypse pour contrer cette logique (Ap 14:11 et 20:10) mais encore une fois faire appel à des textes symboliques pour annuler ou relativiser un texte littéral est rarement une bonne idée.
Apocalypse 14:11
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
Apocalypse 20:10
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
| Élément clé | Texte grec | Traduction littérale |
|---|---|---|
| « fumée de leur tourment » | ho kapnos tou basanismou autōn | fumée de leur torture |
| « monte aux siècles des siècles » | anabainei eis aiōnas aiōnōn | monte pour toujours et à jamais |
| « ils n’ont de repos ni jour ni nuit » | ouk echousin anapausin hēmeras kai nyktos | pas de repos jour et nuit |
Le langage est puissant, solennel et effrayant, mais aussi hautement apocalyptique et symbolique, ce qui est central dans l’interprétation. Apocalypse 14:11 reprend textuellement le style et les images d’Ésaïe 34:9-10, qui décrit la destruction d’Édom:
Elle ne s’éteindra ni jour ni nuit, la fumée s’en élèvera éternellement […] Elle sera un désert à perpétuité.
Édom n’existe plus aujourd’hui, aucune fumée ne s’élève d’elle, donc ce langage n’implique pas une souffrance éternelle consciente ou un feu éternel littéral, mais une destruction avec des conséquences éternelles. La fumée éternelle est spirituellement le souvenir ou la preuve visible d’un jugement définitif et pas d’un tourment éternel. Comme un incendie dont la fumée reste, même quand tout est déjà brûlé.
L’expression « aux siècles des siècles » peut désigner soit une durée sans fin (Dieu règne éternellement), soit une conséquence éternelle d’un acte ponctuel (ex : destruction éternelle). Le feu éternel est aussi mentionné pour Sodome et Gomorrhe (Jude 7), or ces villes ont été détruites, réduites à néant et pas conservées dans le feu jusqu’à aujourd’hui. C’est cela l’exemple pour « les impies à venir ».
Il est important de s’imprégner du style hébraïque qui n’est pas le style rigide gréco-romain (qui nous imprègne beaucoup plus dans la culture occidental). Il faut être capable de saisir le langage symbolique. Nous sommes obligés de discerner le langage spirituel du langage littéral autrement nous créons des contradictions. Il faut considérer la logique globale. Insister que les deux textes d’Apocalypse 14:11 et 20:10 sont à prendre littéralement créé une difficulté d’ampleur car dès lors on est obligé d’aller symboliser ou de relativiser d’autres versets littéraux comme Matthieu 10:28 ou Ezéchiel 28:19 (sur le destin du diable):
Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais!
La Divine Comédie de Dante Alighieri
La Divine Comédie de Dante Alighieri est l’œuvre la plus influente de toute la littérature occidentale sur la vision de l’enfer. C’est un poème épique italien médiéval écrit par Dante Alighieri entre 1307 et 1321. Il s’agit d’une œuvre monumentale, composée de 3 parties, chacune contenant 33 chants (+1 prologue), en vers.
En résumé
Le Shéol/Hadès représente l’état temporaire des morts avant la résurrection et le jugement. C’est le fait d’être dans le sol et d’être inanimé.
La Géhenne représente le sort final des méchants après le jugement, elle est associée à la destruction définitive des non repentis.
Le Tartare est mentionné seulement une fois dans 2 Pierre 2:4, il est décrit comme un lieu où certains anges déchus sont gardés enchaînés en attendant le jugement. C’est un terme emprunté à la mythologie grecque et distinct de la Géhenne.
Pourquoi l’utilisation de termes païens gréco-romains par Jésus et les Apôtres?
Jésus, les apôtres et les premiers chrétiens du NT s’adressaient à un public gréco-romain et juif hellénisé. Utiliser des termes connus (Hadès, Tartare) permettait de faire comprendre des réalités spirituelles nouvelles. On y voit une subversion théologique: L’Hadès n’était plus un royaume souterrain immuable, mais un lieu vaincu par Christ (Apocalypse 20:13-14 : « La mort et l’Hadès furent jetés dans l’étang de feu »). Le Tartare n’était plus mythologique, mais un espace de jugement divin. L’utilisation de ces termes touche à la fois à la linguistique, la culture hellénistique, et à la stratégie pédagogique de Jésus et des apôtres dans le Nouveau Testament.
Le grec koinè (grec commun) était la langue internationale dans tout le monde méditerranéen au Ier siècle (comme l’anglais aujourd’hui). Le Nouveau Testament est rédigé en grec, même si Jésus parlait probablement l’araméen. En utilisant Hadès ou Tartare, Jésus et les apôtres employaient des mots connus, tout en reconfigurant leur sens à la lumière de la révélation biblique.
Dans tous ces cas, le mot Hadès du NT ne signifie pas exactement la vision grecque, mais le séjour temporaire des morts, l’équivalent du Shéol biblique. 2 Pierre 2:4 où on lit « Dieu a précipité les anges rebelles dans les abîmes du Tartare » reprend le mot grec du lieu le plus bas et infernal, mais l’applique aux anges déchus, pas aux hommes. Pierre rejette la mythologie, mais utilise un mot fort pour évoquer la profondeur du jugement divin. C’est un cas d’emprunt de vocabulaire sans adhésion à la théologie païenne.
Jésus et les apôtres ont utilisé les mots Hadès et Tartare parce qu’ils étaient compréhensibles pour leurs auditeurs grecs et romains, mais ils leur ont donné un sens biblique, distinct de leur origine mythologique. Ce n’était pas un syncrétisme, mais une pédagogie: parler le langage du monde pour y semer la vérité révélée.
La Bible (comme Paul à l’Aréopage, Actes 17) montre souvent ce principe. On réutilise des concepts du monde grec ou romain, mais en les détournant ou en les remplissant d’un sens biblique nouveau. De même que Paul cite les poètes païens (Actes 17:28), Jude cite des traditions extra-bibliques (1 Hénoch), Jean parle du Logos (Jean 1:1, mot chargé de sens philosophique grec), ainsi les auteurs du NT ont utilisé Hadès et Tartare dans un but didactique, pas doctrinalement païen. Le jugement final est lui rattaché à la Géhenne ou à l’étang de feu, lesquels sont des symboles indiquant « la seconde mort ».
Qu’est-ce que la seconde mort?
Il est assez simple de comprendre ce qu’est la seconde mort, elle est comme la première qui emmenait les défunts dans le séjour des morts, inactif et silencieux par nature, la différence est qu’il n’y a plus de résurrection de prévue après la seconde mort.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!