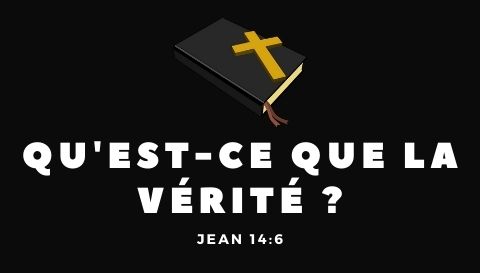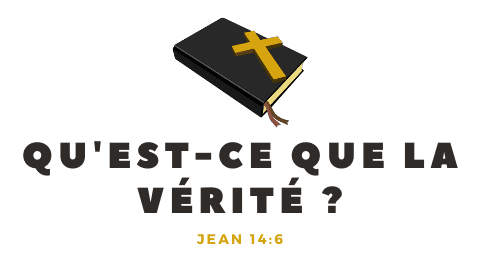Création ex nihilo : une lecture cohérente de la Genèse
L’un des aspects les plus controversés de la vision créationniste du monde est la brièveté du temps pendant lequel la Création aurait eu lieu, selon le récit de la Genèse. Contrairement à la conception évolutionniste qui postule des milliards d’années, la Bible décrit une création en six jours. Cette perspective, souvent qualifiée de « création jeune », est parfois mal comprise, notamment parce qu’elle suppose un univers créé en état de maturité.
La création d’Adam : une nécessité de fonctionnalité immédiate
La Genèse rapporte qu’Adam a été formé à partir de la poussière de la terre et que Dieu a insufflé en lui un souffle de vie (Genèse 2:7). Selon la logique biologique, un être humain ne peut survivre que si l’ensemble de ses systèmes vitaux sont déjà en fonctionnement. Le cœur doit battre, le sang doit circuler, le cerveau doit être irrigué en oxygène, et les organes doivent être opérationnels simultanément.
Il serait biologiquement impossible de créer d’abord un cœur isolé, puis les poumons, puis le cerveau, en espérant que chacun reste fonctionnel sans les autres. En effet, en l’absence d’oxygène, les cellules cérébrales commencent à se détériorer en moins de trois minutes. Ainsi, la seule explication cohérente est que Dieu a créé Adam dans un état complet, mature et pleinement fonctionnel, ex nihilo.
Une apparence d’âge : le cas d’Adam, Ève et des arbres
Ce concept de « création avec apparence d’âge » signifie que bien que la création soit récente, elle semble ancienne, car elle a été créée mature. Adam n’était pas un nourrisson, mais un adulte, capable de parler, de penser, de nommer les animaux (Genèse 2:19), et de reconnaître son Créateur. Cela implique aussi que son cerveau possédait déjà des schémas de pensée, une mémoire fonctionnelle, une langue, et une conscience morale.

Inscrivez vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
De même, les arbres dans le jardin d’Éden portaient des fruits mûrs dès le départ (Genèse 1:11-12), ce qui implique qu’ils avaient l’apparence d’un certain âge, malgré leur création instantanée. Cela s’étend aussi aux animaux : les oiseaux volaient immédiatement, les poissons nageaient, le félin originel Panthera rugissait – tous créés dans leur forme adulte.
Extension cosmique : une création mature à l’échelle de l’univers
Ce concept n’est pas limité à la biologie. Il peut aussi s’appliquer à l’univers entier. Le soleil, la lune et les étoiles ont été créés au quatrième jour (Genèse 1:14-19). Pourtant, leur lumière atteignait déjà la Terre. Cela signifie que l’univers a été créé dans un état mature, permettant à l’homme d’observer immédiatement les cieux et de les utiliser pour « marquer les temps » comme dit le texte biblique.
Les planètes, les anneaux de Saturne, les galaxies lointaines et les comètes montrent des signes d’ancienneté, mais selon cette vue, ce sont des caractéristiques intégrées à une création achevée dès le début, conçues pour remplir une fonction.
Les critiques objectent souvent que ce concept serait trompeur : pourquoi Dieu créerait-il un univers avec une apparence d’âge s’il ne l’a pas réellement ? Mais cette objection repose sur une mauvaise compréhension de la fonction de la création. L’apparence d’âge n’est pas un mensonge, mais une nécessité fonctionnelle. Un arbre doit avoir des cernes pour être solide. Un être humain doit avoir un système immunitaire formé. Le cosmos doit être structuré pour soutenir la vie terrestre.
Une tradition ancienne, pas une invention moderne
Il est à noter que cette lecture de la Genèse comme une création mature n’est pas une invention moderne. De nombreux commentateurs bibliques anciens – bien avant l’avènement de la théorie de l’évolution – comprenaient déjà que Dieu avait créé un univers pleinement formé. Les Pères de l’Église comme Augustin, même s’ils n’étaient pas toujours littéralistes, affirmaient que Dieu avait la puissance de créer instantanément ce qu’Il voulait. Les Réformateurs comme Calvin et Luther acceptaient une lecture littérale des jours de la Genèse.
Comme l’expliquait Philon d’Alexandrie (vers 20 av. J.-C. – 50 ap. J.-C.) :
« Mais lors de la première création de l’univers… Dieu fit sortir de la terre toute l’espèce des arbres dans une perfection totale, portant leurs fruits non pas à un stade incomplet, mais dans un état de pleine maturité, prêts pour une utilisation et un plaisir immédiats, sans délai, pour les animaux. »
(Yonge, 1993, p. 7)
Cette citation de Philon est tirée de son interprétation allégorique de la Genèse. Elle soutient la thèse selon laquelle Dieu a créé non seulement l’homme, mais aussi la nature dans un état de maturité fonctionnelle, prêt à être utilisé immédiatement. C’est un des fondements anciens de la vision créationniste selon laquelle la Création fut achevée produisant une « apparence d’histoire » ou de temps écoulé. Alors qu’Adam avait quelques minutes, il paraissait avoir 30 ou 40 ans. Dieu, pour une raison ou pour une autre, a décidé de créer les premiers organismes à l’état mature. La poule vient avant l’œuf (du moins l’oiseau galliforme originel).
Qu’est-ce que la baraminologie ?
La baraminologie est une branche de la biologie créationniste qui cherche à identifier et classifier les « types créés » originels mentionnés dans la Bible, en particulier dans le livre de la Genèse (Genèse 1). Le mot vient de deux termes hébreux :
- « bara » (בָּרָא) = créer,
- « min » (מִין) = espèce, genre ou type.
La baraminologie vise à comprendre quels groupes d’organismes descendent d’un même ancêtre créé directement par Dieu au cours des six jours de la Création.
Les types créés (ou created kinds) sont des groupes biologiques d’êtres vivants qui :
- ont été créés directement par Dieu,
- sont distincts les uns des autres (discontinuité génétique),
- peuvent se reproduire entre eux ou ont une descendance commune évidente.
Ce concept est plus large que l’espèce moderne : par exemple, le « type canin » incluait probablement loups, chiens, chacals et coyotes — qui seraient tous issus d’un ancêtre canin commun créé par Dieu.
Les baraminologistes utilisent :
- des données morphologiques (forme, structure),
- des données génétiques,
- des tests de continuité/discontinuité (Baraminic Distance Correlation, etc.),
- des observations de capacité de reproduction.
Le but est de délimiter les frontières naturelles entre types créés, en opposition à l’idée évolutionniste d’un arbre de vie unique.
La baraminologie cherche à retracer les groupes d’organismes créés directement par Dieu au commencement, qui ont ensuite varié et se sont adaptés au fil du temps sans changer de « type » fondamental.
L’apparence de l’âge : un principe divin récurrent
Si Adam, fraîchement créé, avait été examiné par un médecin moderne, ce dernier aurait conclu, sans l’ombre d’un doute, qu’il s’agissait d’un adulte en parfaite santé, probablement âgé d’une vingtaine d’années. Et pourtant, selon le récit biblique, Adam n’avait que quelques heures. Ce paradoxe apparent confirme une réalité fondamentale : Adam avait l’apparence de l’âge, sans en porter les conséquences physiologiques.
Il ne présentait aucun des signes courants du vieillissement : pas de plaque artérielle, pas de rides, pas de taches pigmentaires liées à l’âge, ni de déclin cellulaire. Son système cardiovasculaire était entièrement fonctionnel, sans accumulation de cholestérol, phénomène pourtant inévitable chez les humains après plusieurs décennies. Son corps, tout entier, reflétait la perfection d’une création directe, sans passé évolutif, sans usure.
Des miracles cohérents avec la création mature
Ce principe de l’apparence d’une histoire non vécue ne se limite pas à la Genèse. Il trouve également un écho profond dans le ministère terrestre de Jésus-Christ. Un exemple frappant se trouve au début de l’Évangile selon Jean (Jean 2:1-11), lors des noces de Cana. Jésus transforme l’eau en vin, et pas n’importe quel vin : un vin de grande qualité, jugé meilleur que celui servi au début du repas. Ce vin, pourtant créé en un instant, avait l’apparence d’un vin ancien, mûri, raffiné, normalement obtenu après des mois, voire des années de fermentation et de vieillissement.
Il en va de même lors des multiplications miraculeuses des pains et des poissons (Matthieu 14:13-21 ; 15:32-39). Jésus crée de la nourriture qui, à la dégustation, avait toutes les caractéristiques d’aliments cultivés, récoltés, préparés et cuisinés dans le respect du processus naturel. Pourtant, cette nourriture était d’une fraîcheur miraculeuse, produite en quelques secondes, sans culture agricole, sans pêche préalable, sans cuisson progressive.
Un Dieu de fonctionnalité immédiate
Ce que ces événements démontrent, c’est la constance de l’action divine : Dieu ne crée pas de manière incomplète ou progressive, mais avec un but fonctionnel immédiat. Lorsqu’Il agit, que ce soit dans la création initiale ou dans les miracles du Christ, Il produit un résultat achevé, adapté à son usage, et capable de remplir son rôle immédiatement.
Cette logique s’accorde parfaitement avec l’idée que l’univers lui-même a été créé avec une apparence d’histoire. Les étoiles brillaient, les saisons fonctionnaient, les cycles lunaires étaient en place – non parce qu’ils avaient évolué durant des milliards d’années, mais parce qu’ils ont été mis en place de manière fonctionnelle dès l’origine.
Une création cohérente avec le caractère de Dieu
La création mature est non seulement logique du point de vue biologique et cosmique, mais aussi théologiquement cohérente. Dieu est un Créateur d’ordre, de beauté, de fonctionnalité. Il n’a pas besoin d’un processus évolutif pour aboutir à la complexité : Il parle, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe (Psaume 33:9).
Cette vision honore aussi le caractère de Dieu comme un Dieu de provision immédiate : Il crée Adam capable de respirer, parler, aimer, et cultiver le jardin ; Il crée Ève comme aide et compagne, dans une relation pleinement humaine dès l’instant de sa création ; Il crée un monde où les besoins de l’homme sont déjà satisfaits, où le fruit est mûr, l’air respirable, et les jours rythmés.
Une création rapide : une nécessité fonctionnelle
Selon la perspective créationniste, une création rapide n’est pas simplement une option théologique ou une préférence doctrinale, elle est une nécessité logique et pratique. Pourquoi ? Parce qu’une création lente, progressive – telle qu’imaginée dans les modèles naturalistes ou évolutionnistes – suppose que les différents éléments de la nature ont pu exister de façon indépendante, en attendant que les autres apparaissent. Or, cette idée pose plusieurs problèmes cruciaux :
1. L’interdépendance des systèmes vivants
Un être humain, comme tout organisme complexe, est un système hautement intégré. Le cœur ne sert à rien sans les vaisseaux sanguins ; les poumons ne servent à rien sans le sang pour transporter l’oxygène ; le cerveau ne peut pas fonctionner sans oxygène, glucose, neurotransmetteurs, etc.
Créer ces éléments séparément et progressivement poserait un grave problème : ils ne pourraient pas survivre isolément en attendant que les autres parties soient prêtes. Cela revient à vouloir faire voler un avion en construisant les ailes, puis plus tard les moteurs, puis plus tard le cockpit…
2. La non-fonctionnalité en cours de développement
Même à l’échelle cosmique, ce principe s’applique. Une planète comme la Terre ne peut pas soutenir la vie sans :
- une distance précise par rapport au soleil,
- une atmosphère protectrice,
- un champ magnétique,
- de l’eau à l’état liquide,
- une lune stabilisatrice,
- une gravité équilibrée…
Tous ces éléments doivent exister et être opérationnels en même temps. Les obtenir progressivement signifierait que la planète resterait invivable pendant une période indéfinie.
3. La survie impossible des organismes partiellement formés
Dans le cadre d’une création lente, on devrait imaginer qu’un œil a commencé à se former sur des générations, puis une lentille, puis un nerf optique, etc. Mais aucun de ces éléments, pris isolément, ne peut fournir un quelconque avantage évolutif ou fonctionnel. Un œil à moitié formé ne voit pas. Il ne confère donc aucun bénéfice, et serait même un handicap (coûts énergétiques sans utilité). Cela s’applique aussi à la digestion, à la reproduction, à l’immunité…
Le système de coagulation du sang est un processus biochimique d’une extrême précision. Lorsqu’une blessure survient, il faut que :
- le sang forme rapidement un caillot pour arrêter l’hémorragie,
- ce caillot se stabilise,
- puis se dégrade une fois la guérison amorcée.
Ce mécanisme repose sur plus d’une douzaine de facteurs de coagulation qui doivent s’activer dans un ordre précis. Si l’un manque ou est défectueux, le système ne fonctionne pas du tout. Un exemple classique : l’hémophilie, où l’absence d’un seul facteur empêche la coagulation, mettant la vie en danger.
Un système comme celui-ci ne peut pas fonctionner à moitié. Un organisme avec seulement une partie de ces facteurs saignerait à mort à la moindre blessure, bien avant que le système ait pu « évoluer » vers sa forme complète. C’est l’exemple parfait d’un système tout ou rien.
Souvent cité également, l’œil possède des éléments hautement intégrés :
- cornée, pupille, cristallin pour la focalisation,
- rétine avec ses cellules photoréceptrices (cônes et bâtonnets),
- nerf optique pour la transmission du signal au cerveau,
- traitement visuel dans le cortex occipital.
Sans coordination parfaite entre ces parties, la vision ne fonctionne pas. Une lentille sans rétine n’est d’aucune utilité. Une rétine sans cristallin donne une image floue. Un nerf optique sans cerveau ne sert à rien. Il s’agit d’un système qui ne peut exister que complet.
Le système immunitaire adaptatif est un autre exemple de complexité : lymphocytes T et B, anticorps, mémoire immunitaire, cytokines de signalisation… Chaque élément a besoin des autres pour assurer la protection de l’organisme.
Une défense immunitaire partielle ne protégerait pas des infections : le premier microbe tuerait l’organisme. Là encore, le tout doit exister simultanément, ou l’organisme meurt.
Ces exemples montrent que la création rapide et complète n’est pas seulement une option théologique : elle est biologiquement incontournable. De nombreux systèmes vivants ne fonctionnent que lorsqu’ils sont entiers et opérationnels. Cela remet sérieusement en question tout scénario d’évolution lente par ajouts successifs, et appuie fortement la vision biblique d’un Créateur qui fait toute chose « bonne » et « achevée » dès le commencement (Genèse 1:31).
L’interdépendance entre la vie « supérieure » et les micro-organismes
Le molybdène est un oligo-élément essentiel pour de nombreuses enzymes humaines et animales. Il intervient dans :
- la détoxification des sulfites,
- le métabolisme de l’azote,
- le fonctionnement de certaines oxydases.
Or, le molybdène bio-assimilable ne se trouve pas directement dans l’environnement sous forme utilisable. Il est libéré et activé par des bactéries spécifiques du sol, capables de transformer ses formes minérales en formes bioactives.
Sans ces micro-organismes, les êtres vivants complexes n’auraient jamais accès à cet élément crucial. Attendre que la vie animale évolue avant que ces bactéries soient là n’a aucun sens fonctionnel.
L’azote constitue 78 % de l’air que nous respirons, mais sous sa forme gazeuse (N₂), il est inutilisable pour les plantes et les animaux. C’est grâce à des bactéries spécialisées — notamment les bactéries fixatrices d’azote comme celles du genre Rhizobium — que cet azote est transformé en nitrates, forme que les plantes peuvent absorber. Ensuite :
- les animaux mangent les plantes et obtiennent les protéines azotées,
- d’autres microbes décomposent les déchets azotés pour recycler l’azote dans l’environnement.
Sans ces bactéries, aucun cycle de l’azote n’existe, donc aucune protéine, aucun ADN, aucune vie complexe. Ce système devait être opérationnel dès le début.
Même chez l’homme, la microbiote intestinale (plus de 100 000 milliards de micro-organismes) joue un rôle essentiel :
- digestion de certains sucres et fibres,
- synthèse de vitamines (notamment K et B12),
- modulation de l’immunité,
- protection contre les pathogènes.
Un bébé humain ne peut pas survivre correctement sans une flore intestinale fonctionnelle, laquelle est transmise dès la naissance, voire in utero selon des études récentes. Encore une fois, cela signifie co-création simultanée, et non apparition progressive.
Tous ces exemples renforcent l’idée d’un univers créé en harmonie, avec toutes ses pièces en place dès le commencement. Dieu n’a pas seulement créé l’homme et les animaux « visibles », mais aussi les micro-organismes invisibles mais essentiels, dans une logique de complémentarité et d’interdépendance.
Cela rejoint le témoignage biblique de Genèse 1:31 :
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici, cela était très bon. »
Le mot « tout » inclut le visible et l’invisible, le grand et le microscopique.
L’analogie de la voiture : une machine qui dépend de composants invisibles
Imaginons une voiture flambant neuve, parfaitement conçue. Elle a :
- un moteur puissant,
- une carrosserie brillante,
- des pneus neufs,
- un tableau de bord électronique.
Mais… si on n’a pas d’huile dans le moteur, de liquide de frein, ou de carburant, elle ne démarre pas. Ces éléments sont souvent invisibles, mais essentiels au bon fonctionnement du tout. De la même manière, les micro-organismes ne sont pas visibles à l’œil nu, mais ils sont comme les fluides vitaux de l’organisme ou de l’écosystème. Sans eux, le système semble complet mais ne fonctionne pas.
L’analogie du jardinier et de la graine
Une graine peut contenir toute l’information génétique pour devenir un arbre. Mais si elle est plantée dans un sol sans les bonnes bactéries ou champignons, elle ne germera pas, ou très mal. Le jardinier aura beau l’arroser et l’exposer à la lumière, sans le bon écosystème microbien, la croissance est impossible.
Les plantes, comme les êtres humains, dépendent d’un monde invisible qui prépare le terrain, transforme les nutriments, équilibre le sol, protège les racines. Le mutualisme entre les racines et les microbes du sol est aussi vital que la lumière du soleil.
L’analogie de l’horloge mécanique : chaque pièce compte
Imaginons une horloge ancienne, faite d’engrenages finement ajustés. Retirons une seule dent sur une roue, ou un ressort de tension minuscule, et tout le système s’arrête. On pourrait penser que c’est une petite pièce sans importance — jusqu’à ce qu’on réalise que le bon fonctionnement de l’ensemble dépend d’elle.
Les microbes du sol, de l’intestin ou de l’atmosphère sont ces petites dents cachées : si on les remplace par rien, la « machine vivante » cesse de fonctionner.
Le mutualisme : une coopération indispensable dès le début
Le mutualisme désigne une relation où deux organismes dépendent l’un de l’autre pour survivre. Par exemple :
- Les bactéries fixatrices d’azote permettent aux plantes de pousser.
- Les plantes produisent de l’oxygène pour les animaux.
- Les animaux libèrent du CO₂ que les plantes utilisent.
Dans une évolution graduelle, ces partenaires seraient apparus à des époques différentes, or sans l’un, l’autre ne peut vivre. Si une plante apparaît avant les bactéries fixatrices d’azote, elle ne pourra jamais croître. Si les micro-organismes intestinaux apparaissent après l’homme, celui-ci ne pourra pas digérer, ni synthétiser certaines vitamines.
Le mutualisme ne peut fonctionner que si les partenaires apparaissent ensemble. Cela est beaucoup plus cohérent avec une création simultanée.
Un organisme est constitué de systèmes interconnectés :
- circulatoire,
- respiratoire,
- digestif,
- nerveux…
Ces systèmes ne peuvent pas évoluer l’un après l’autre, car ils ne sont pas viables de manière autonome. Par exemple, les poumons ne servent à rien sans système circulatoire, et le cerveau ne peut fonctionner sans oxygène.
Une évolution lente impliquerait des millions d’années pendant lesquelles ces systèmes non fonctionnels auraient dû persister, ce qui est biologiquement invivable. Un système partiellement développé n’offre aucun avantage sélectif, donc il n’est pas « retenu » par la sélection naturelle.
Beaucoup de systèmes biologiques sont dits irréductiblement complexes, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être simplifiés sans perdre leur fonction. Exemples :
- Le système de coagulation du sang (déjà évoqué),
- Le flagelle bactérien,
- Le système immunitaire adaptatif,
- L’œil,
- Le cycle de l’azote,
- Les enzymes digestives,
- La synthèse de l’ADN…
Si ces systèmes sont incomplets, ils ne servent à rien et deviennent même un handicap. L’évolution graduelle, qui fonctionne théoriquement par petites modifications successives, ne peut expliquer l’apparition d’un système entier qui ne fonctionne que complet.
Le facteur temps : la vie ne peut pas « attendre »
Un modèle évolutif suppose que les systèmes se mettent en place petit à petit, sur des millions d’années. Or, la vie ne peut pas survivre en « mode attente » :
- Un foie à moitié formé ne détoxifie pas.
- Un œil sans nerf optique ne voit pas.
- Une plante sans nitrates ne pousse pas.
Chaque système ou symbiose doit être opérationnel dès l’origine, sinon l’organisme meurt avant même d’avoir la chance d’évoluer.
Un monde prêt à être habité
C’est pourquoi la Genèse insiste sur le fait que le monde a été créé en six jours, avec l’homme placé dans un environnement pleinement fonctionnel dès le début. La lumière était là avant même le soleil (Genèse 1:3, puis Genèse 1:14-19), illustrant que la source d’énergie première était Dieu Lui-même. Le jardin d’Éden contenait des arbres porteurs de fruits mûrs (Genèse 1:11-12), les animaux étaient prêts à être nommés (Genèse 2:19-20), et Adam prêt à cultiver et à garder le jardin (Genèse 2:15).
En résumé :
Une création lente implique des composants non fonctionnels, des systèmes incomplets et une absence de vie viable. Une création rapide garantit une fonctionnalité immédiate, une interdépendance cohérente et un monde prêt à accueillir la vie.
L’univers vivant n’est pas un assemblage progressif de pièces, mais un système entier, intégré, interconnecté, et cohérent dès le début. Ce constat :
- soutient la thèse d’une création rapide et complète,
- rend l’évolution graduelle invraisemblable dans de nombreux cas,
- et correspond à la vision biblique où tout fut créé « bon », « achevé » et « fonctionnel » dès l’origine (Genèse 1:31).
Cet article est en partie inspiré de la publication intitulé « Does the Mature Creation Concept
Explain the Solar System’s Creation? » de Jerry Bergman dans Creation Research Society Quarterly 2025 61:213–220.

Inscrivez-vous sur QQLV!
Pour soutenir l’effort du ministère et la création de contenus:
RECEVEZ DU CONTENU par email
Recevez du contenu biblique, archéologique et scientifique dans votre boîte mail!